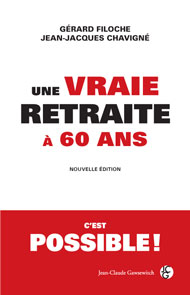On prend la ruelle juste en face, d’abord à pic, terriblement descendante, puis on dévale par tournants successifs, vers le Bosphore. Vieilles maisons vides et cassées, petits immeubles avec du linge aux fenêtres, façades délabrées, petit cimetière caché, (il y en a partout niché dans la ville), petites échoppes, trottoir avec des marches tortueuses, sols glissants, des chats partout, obligé de se tasser sur les murs lorsqu’un taxi passe, on plonge depuis les hauteurs d’Istiklal jusqu’à Kabatas où la sirène du bateau nous appelle et nous presse. C’est dimanche 8 novembre, mais il fait si beau qu’en bras de chemise, en dépit du vent léger, on peut se chauffer au soleil sur le pont au milieu de plusieurs centaines de stambouliotes entassés qui profitent de la balade. Les vues successives au fur et à mesure de la traversée du Bosphore, par un si beau soleil sur les hauteurs de Pera, puis sur l’entrée de la Corne d’or, sur les grandes mosquées, sur Topkapi, puis sur la Tour de la fille, puis sur Karakoï sont fabuleuses.
Les yeux miroitent d’une telle succession d’images de légende. Les hauteurs des quartiers branchés de Cihangir laissent place au port, ses grands bâtiments, ses portiques, avec ses dizaines de bateaux de toutes tailles, simples transbordeurs, barques de pêches, caboteurs, et énormes navires de croisière plus hauts que les maisons des quais où ils sont amarrés.
Le moment où l’on voit à la fois Sainte Sophie et la Mosquée bleue, juste derrière les jardins de Topkapi est magique : minarets blancs et bleutés du matin, dômes ôcres et gris, murailles rouges et sombres, jardins aux couleurs d’automne.
C’est un décor fin et fouillé, ciselé et épuré, qui s’affiche au loin sous les rayons vifs du soleil entre les deux bleus de la mer et du ciel. On fait halte au port en Asie, à Karakoï, au pied d’une grosse montgolfière jaune attachée qui descend et monte pour permettre aux touristes de contempler toute la baie : un court moment le globe rond nous fait même une éclipse de soleil.
On repart caboter dans la mer de Marmara vers les quatre plus grandes îles « aux Princes ». De Kinaliada à Burgazada, de Heybeliada à Büyükada, on prend le temps, serrés les uns contre les autres, de boire des thés, de feuilleter des guides, de faire des signes aux passagers des autres bateaux, et même pour certains, de nourrir les mouettes qui attrapent le pain au vol ou dans la main. Il faut plus d’une heure pour qu’on arrive à la quatrième île, la plus accueillante et celle où nous voulons à la fois déjeuner et voir la maison de Trotski puisque c’est là qu’il subit son premier exil imposé, lors de la terrible contre-révolution stalinienne en URSS.
Franchement l’arrivée dans un petit port avec un vieux café décoré de faïences, des boutiques et des tables partout, vous rend pleinement touristes au cas où vous ne l’auriez pas été. Mais, c’est une atmosphère bon enfant, une impression de doux farniente, quelques pas suffisent à rejoindre une allée de restos, là, juste en bord de mer, les tables légèrement surélevées donnent sur l’eau, avec le clapot des vagues, on mange avec vue sur l’Asie, mouettes et poissons se chargeant de débarrasser vos miettes de pain. Raki, vin blanc, bière, mezzés, puis, pour quatre, un grand poisson choisi par nos soins à l’étal, grillé juste à point, débarrassé avec art de ses arêtes, que demander de plus un chaud dimanche midi tranquille ? Reste à faire la balade pendant une heure en calèche, le « grand tour », vers les collines et les pins, entre les centaines de villas secondaires luxueuses des riches stambouliotes.
Ce n’est pas du premier coup qu’on réussit à se faire comprendre quand on demande la maison de Trotski mais un voiturier est bien au courant et explique à notre conducteur. C’est à droite après le port, on monte assez longtemps, puis il y a une impasse raide à droite. Les deux chevaux sauront aller jusqu’au bord et, dans la pente, au n° 4, on tombe sur une grille qui était fermée, on longe le mur (on a fait cela sur les indications de notre ami Pierre Ruscassie qui nous avait précédé, il y a plusieurs années) et… il n’y a rien !
Rien, sinon une ruine inapprochable à ciel ouvert, emmurée, envahie par la végétation, dont on devine qu’elle fut une belle et assez grande demeure, de briques rouges, avec, à l’étage une vue sur la mer proche. On s’est acharné à prendre des photos pittoresques de ce qui devrait, quand même, être traité comme un musée : mais le proscrit de Staline ne l’a pas seulement été, de son vivant, sur toute la planète, il l’est encore et aussi, après son assassinat, dans l’histoire de son siècle. Des ignares le méprisent sans le connaître et sans jamais l’avoir lu.
Restaient le tour par les collines encore vertes, avec les cahots bruyants des calèches, les cris du cocher pour faire grimper ses deux pauvres chevaux, les aboiements des nombreux chiens, les rayons du soleil couchant à travers les pins, et, revenus au port, l’embarcadère pour le cabotage retour après d’ultimes cafés turcs et thés brûlants. Revenus sur Istiklal, on prend le rite du soir de fête, la balade à nouveau dans la foule immense puis l’envie d’un bon plat d’agneau sauté en ragoût et d’un poisson grillé au pied de la tour de Galata.