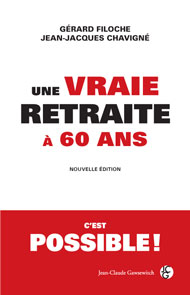En face de Macron, un salariat majoritaire et puissant va gagner :
Cela fait déjà des décennies que nous ne disons plus « prolétariat » ni classe ouvrière », mais « salariat ».
Non seulement le salariat s’est imposé numériquement et proportionnellement au travers du siècle écoulé, mais il s’est homogénéisé, de façon relative mais réelle. Le temps de l’immédiat après esclavage, tâcherons, journaliers, loueurs de bras a peu à peu laissé place au contrat de travail mensualisé. Un contrat impliquant des garanties horaires et salariales, emploi et conditions de travail. Du Dr Villermé à la révolution de 1848, de la Commune de Paris a la loi Waldeck-Rousseau de 1884, de la création de l’inspection du travail de 1892 au code du travail en 1910, de la journée de 10 h à la journée de 8 h, de la semaine de 40 à la semaine de 35 h, le capitalisme a été obligé de lâcher du lest pendant 170 ans.
La distinction entre « cols bleus » et « cols blancs », entre ouvriers et employés, qui semblait fondamentale au début du xxe siècle, s’est incontestablement estompée. Le « col bleu » avait les mains dans le cambouis, en bas, à l’atelier ; le « col blanc » avait des manches de lustrine, en haut, dans les bureaux : le premier semblait défavorisé par rapport au second. Ce clivage si net tout au long du siècle précédent dans l’imagerie populaire, syndicale et politique, s’est révélé artificiel et il a laissé place à un brassage des conditions de travail, de l’hygiène et de la sécurité, des conventions collectives, des salaires et des statuts : aujourd’hui, l’ouvrier peut encore porter des bleus de travail mais œuvrer dans un environnement aseptisé de machines informatisées dont la maîtrise exige un haut niveau de qualification, tandis que l’employé peut effectuer des services sales, déqualifiés et mal payés, notamment dans l’entretien ou l’aide aux personnes.
Une longue montée en puissance
Des années 50 aux années 80, la France a vécu une tendance nette au resserrement des inégalités de revenus, et même si cette tendance renversée dans les années 80, s’est stabilisée à la fin des années 90, puis a reculé à partir de 2002, les conditions de vie se sont, un temps, relativement homogénéisées entre cadres, ouvriers et employés, dans tout le salariat. (Jean-François Dortier, « Vers l’homogénéisation de la société ? » Sciences humaines, hors-série n°10, 1995).
Jacques Généreux décrit un « cercle vertueux égalité croissance » qui s’explique par les effets de la distribution des revenus sur la demande et explique : « Plus on partage le gâteau, plus il devient gros ». De nombreuses études ont évoqué une « moyennisation » du salariat au cours du 20° siècle (selon Simon Kunetz, 1901-1985, prix Nobel en 1971, qui dessine une courbe de réduction relative des inégalités qui ne se retournera que vers les années 95).
Ouvriers et employés sont deux catégories salariées aussi indispensables l’une que l’autre, à produire de la plus value : l’ouvrier l’extrait directement dans l’industrie, mais il ne peut la réaliser sans l’aide de l’employé. L’un est davantage dans la sphère directe de la production de la plus value, l’autre est davantage dans la sphère de la réalisation de la plus value, mais ces deux sphères sont non seulement complémentaires mais indissociables. Le salarié coiffeur est indispensable aux ouvriers et employés : il les aide, en les entretenant, en leur coupant les cheveux, à réaliser la plus-value (le patron coiffeur, lui, en détourne un peu aussi).
Le brassage entre ouvriers et employés, anciens et nouveaux métiers, est une tendance lourde qui prend tous les aspects : la mécanisation des bureaux, l’informatisation des postes d’usine ou la qualification des postes d’entretien et de ceux des soins aux personnes. Même travail, exploitation différente : le même geste, servir un verre d’eau, n’est pas payé pareil, selon qu’on sera hôtesse de l’air, ou aide soignante dans une maison de retraite. Le travail des champs est mécanisé, les ouvriers d’entretien des espaces verts dans les villes n’ont rien de cultivateurs. Le travail manuel exige des hauts niveaux de culture, le travail intellectuel exige des applications intégrées, les différenciations ne sont plus évidentes. La féminisation du travail puis des emplois a été massive depuis les années 70. Les statuts du privé et du public se suivent et se rapprochent, dans le progrès d’abord puis dans la déréglementation.
Les statuts de la Fonction publique, issus de l’après-guerre, revus et renforcés après le retour de la gauche au pouvoir en 1981, visaient non seulement à garantir l’emploi mais aussi la dignité et les conditions de travail des fonctionnaires dans les trois fonctions publiques, d’état, territoriales et hospitalières. Ils ont aidé, en tant que modèle, à « tirer vers le haut » le statut des autres salariés du privé. Mais ils ont été rognés, contestés, usés, et les reculs enregistrés ont permis, récemment, ceux du privé. Finalement, l’évolution des statuts du secteur public et du privé sont historiquement plus liés que ne le prétendent ceux qui veulent à tout prix les opposer.
Les fonctionnaires ne sont ni des nantis, ni des privilégiés : ils produisent plus que ce qu’ils gagnent. Sans fonctionnaire aucune entreprise ne fonctionnerait. C’est ce que ne veulent pas admettre ceux qui disent « qu’un emploi public n’est pas un emploi ». Catégorie par catégorie les fonctionnaires gagnent moins que dans le secteur prive. Quand la fonction publique, le service public et les fonctionnaires reculent, les salariés du privé reculent, quand ils résistent et gagnent, ils défendent aussi les droits et acquis du privé. Il ne leur reste qu’un seul avantage, la garantie de l’emploi, mais même celle-ci est menacée : des « double statuts » cohabitent dorénavant dans de grandes ex-entreprises publiques.
Lorsque la situation politique et économique se retourne, le brassage de toutes les catégories du salariat n’est pas moindre, même si les femmes, les jeunes et les immigrés en souffrent davantage : le risque de chômage existe dans toutes les catégories. En 2002, 3,8 % des cadres et « professions intellectuelles supérieures », 5,4 % des professions dites intermédiaires, 10,5 % des employés, et 11, 4 % des ouvriers étaient au chômage, le taux de chômage étant inversement proportionnel au niveau du diplôme. Cette proportion est inchangée en 2017.
Il y a deux fois plus de temps partiel subi chez les employés (13 %) que chez les ouvriers (6 %), il y a davantage de CDD chez les ouvriers (17 %) que chez les employés (13 %). Les employés ont en partie des salaires plus bas, ont plus de tensions avec le public, ont moins de pauses-repas, un rythme imposé par la demande plus élevé, moins de repos hebdomadaire de 48 h ou dominical que les ouvriers. Mais les ouvriers sont souvent moins formés, ont des rythmes imposés par les normes ou les cadences plus élevés, des risques plus grands, davantage de travail de nuit, d’efforts physiques, d’accidents et de bruits que les employés, mais un sentiment de responsabilité plus important. (Source Cereq-Dares-Insee, Enquêtes formation continue 2000, 1998, 1997)
« Avec le développement de la soumission réelle du travail au capital ou mode de production spécifiquement capitaliste, le véritable agent du procès de travail total n’est plus le travailleur individuel, mais une force de travail se combinant toujours plus socialement. Dans ces conditions, les nombreuses forces de travail qui coopèrent et forment la machine productive totale, participent de la manière la plus diverse au procès immédiat de création des marchandises, ou mieux des produits ; les uns travaillant intellectuellement, les autres manuellement, les uns comme directeur, ingénieur, technicien, ou comme surveillant, les autres enfin comme ouvrier manuel voire simple auxiliaire. Un nombre croissant de fonctions de la force de travail prennent le caractère immédiat de travail productif, ceux qui les exécutent étant des ouvriers productifs, directement exploités par le capital et soumis à son procès de production et de valorisation. » (Karl Marx, premier tome du Capital, chapitre inédit paru en 1933, cité par Ernest Mandel p. 99 dans « Les étudiants, les intellectuels et la lutte des classes » Ed. La Brèche, 1979)
Une longue homogénéisation du salariat :
George Orwell écrivit « le quai de Wigan » en 1934, publie à Londres en 1937. (Les éditions Ivréa l’ont republié en 1995 en français (Champ livre, 260 p. 18 euros). L’auteur y racontait le pays minier du nord de l’Angleterre. Il vit dans les logements insalubres et descend dans la mine : « La plupart des traits qu’on associe d’ordinaire au royaume de Satan sont présents au rendez vous : la chaleur, le bruit, le tohu bohu, l’atmosphère fétide, l’air vicié et surtout, l’espace compté à un point insupportable » « Il faut être au fond et voir les mineurs à moitié nus pour se rendre compte des splendides types d’humanité qu’ils représentent ». Ils y descendent serrés dans une cage projetée à 100 km heure jusqu’à 400 m sous terre. Ils rampent dans des boyaux souterrains dangereux sur des longueurs de un à cinq kilomètres. Leur temps de travail n’est décompté qu’à pied d’oeuvre. Ils taillent la houille dans des positions torturantes de travail, un vacarme assourdissant, une poussière irrespirable : sur le front de taille, pendant 7 à 9 heures, à quatre pattes, dans un espace de 4 à 5 m, entre les bois de soutènement, les étançons, ils creusent avec des haveuses, des perceuses, des pelleteuses, des marteaux-piqueurs, des explosifs, des chargeurs qui concassent, trient, lavent et envoient le charbon abattu sur des convoyeurs avec des berlines.
« Au fond, là où on extrait le charbon, c’est une sorte de monde à part qu’on peut aisément ignorer sa vie durant. Il est probable que la plupart des gens préféreraient ne jamais en entendre parler. Pourtant, c’est la contrepartie obligée de notre monde d’en haut ».
Orwell réfléchit ensuite sur la situation politique et sociale de son époque, et s’interroge sur les raisons qui expliqueraient pourquoi le socialisme ne gagne pas davantage l’adhésion du peuple. Il a la lucidité, lui, journaliste, à la fois de ne pas flagorner les mineurs et de ne pas se distinguer d’eux : il recherche le point commun entre tous ceux qui ont une activité de production et vendent leur force de travail.
Il fait un fulgurante approche du salariat pris comme un ensemble : « Ce que je dis par là, c’est que des classes distinctes peuvent et doivent faire front commun sans que les individus qui les composent soient sommés d’abandonner du même coup ce qui fait leur originalité. Le chat ne peut faire cause avec la souris. Le capitaliste ne peut faire œuvre commune avec le prolétaire. Mais il est toujours possible de s’associer sur la base d’un intérêt commun. Ceux qui doivent unir leurs forces ce sont tous ceux qui courbent l’échine devant un patron ou frissonnent à l’idée du prochain loyer à payer ».
Deux ouvriers intérimaires sont morts en juillet et septembre 2015 à Arcelor Mittal Grande Scynthe et Fos sur mer, chutant dans la fonte liquide à 1400° : leurs camarades de la métallurgie, de la chimie, des « sites Seveso », dont on pourrait décrire aujourd’hui encore les conditions de travail à la façon de George Orwell, ont eux aussi et toujours, intérêt à unir leurs forces avec l’étudiant, le journaliste, l’employé de commerce ou des services qui a du mal à payer son loyer et à se loger. Les grands médias ne parlent jamais comme il le faudrait (et ça manque forcément à l’imaginaire de jeunes écervelés comme Macron) des accidents et des conditions de travail, certain disent dédaigneusement « C’est du Zola » croyant que ce monde n’existe plus. S’ils avaient enquêté derrière les tunneliers sur la construction des lignes de RER EOLE ou METEOR au milieu des années 1990, ils auraient ressenti » Zola » en direct : il a fallu six morts pour venir à bout du chantier.
Des milliers d’études ont instruit des comparaisons entre « anciens » et « nouveaux » métiers, du mineur de fond au tunnelier du BTP, de la « bête humaine » au conducteur de TGV, du métallurgiste au cariste, du commis cuisinier au serveur de fast-food, du typographe au claviste, de la vendeuse qualifiée à la gondolière de supermarché, de la conseillère experte à l’hôtesse d’accueil, du dépanneur au coursier, du réparateur informatique au centre d’appels…
« Génération précaire » (Cf. livre d’Abdel Mabrouki et Thomas Lebegue Le Cherche midi, 2004) c’est aussi, une forme d’homogénéisation, qu’une génération de « petits boulots » précaires (fast-food coursiers, gardiens, petits vendeurs) revendique et s’organisent. Tout bouge, et tout se mélange, les exigences des gains de productivité, de management, de flux tendus, de rentabilité financière maxima, le chantage à l’emploi pèsent sur tous. A leur corps défendant, les hérauts du tout marché et de la déréglementation libérale, façonnent une même identité chez leurs subordonnés. Des dizaines de livres témoignages, de films, d’enquête en attestent.
L’homogénéisation du salariat est plus profonde encore si l’on étudie les 20 dernières années en matière de salaire et de conditions de travail : le travail répétitif touche 13 % des ouvriers, 20 % des employés de commerce. En 1998, 29 % des salariés déclarent que leur rythme de travail leur est imposé de façon constante par la hiérarchie (contre 23 % en 1991). 53 % des salariés travaillent sur informatique plus de trois heures par jour, et 64 % n’ont pas le choix de leur logiciel.
Toutes les études démontrent que, pour une majorité croissante des salariés, les pressions s’accroissent : augmentation du rythme de travail, multiplication des contraintes, mécanisation plus forte, rapidité d’exécution, demandes multiples, vigilance accrue, contrôle hiérarchique permanent, stress… (voir aussi pour le vérifier empiriquement une abondante filmographie française : « La dernière digue » 1996 de Richard Bois, « Ressources humaines » de Laurent Cantet en 1999, « Trois cent jours de colère » 2002, de Marcel Trillat, « Violence des échanges en milieu tempéré », réalisé par Jean-Marc Moutout, 2003, « MetalEurop Germinal 2003 » film de Jean-Michel Vennemani 2003, « L’éléphant, la fourmi et l’Etat : aujourd’hui Métaleurop, demain … ? » de Jean Michel Meurice et Christian Dauriac 2004, , « Souffrance en France » de Christophe Desjours et « Ils ne mouraient pas tous mais tous étaient frappés », de Sophie Bruneau et Marc-Antoine Roudil, 2006, « Sauf le respect que je vous dois… » film de Fabienne Godet, février 2006, « Le salariat » d’Anne Kunvari, Iskra, 2007, « We want sex equality » de Nigel Cole, 2010, « On a grevé » de Denis Gheerbrandt, 2013, « Merci Patron » de François Ruffin, 2016, particulièrement le film « La loi du marché » primé au festival de Cannes, avec Vincent Lindon, le film « Comme des lions » sur PSA, de Françoise Davisse 201é, « Corporates » 2017 de Nicolas Silhul auxquels il faut rajouter les fantastiques films de Ken Loach « Bread and roses » « It’s a free world » The navigators » ou « Moi Daniel Blake » etc.)
Le risque commun, celui du chantage à l’emploi, s’est répandu du haut en bas du salariat : 60 % des salariés, toutes catégories mélangées, craignaient de perdre leur emploi déjà en 1998 – contre seulement 46 % en 1991. Ce chantage s’est accru depuis 20 ans. Tous les salariés ont une épée de Damoclès sur la tête et n’ayant que leur force de travail à vendre, subissent les mêmes épreuves, les mêmes souffrances, les mêmes craintes.
Le moyen-haut cadre n’est plus sûr de s’acheter sa maison, de ne pas être licencié avant 55 ans, d’élever ses enfants. Il n’en a pas forcément conscience, tout est fait même pour qu’il ne l’ait pas, il se voit encore « libre », « autonome », davantage maître de son travail que ses… subordonnés, mais c’est un sentiment fugace, dilué qui s’affaiblit chaque jour en pratique : il faut qu’il réponde de plus en plus à des normes, des objectifs, soumis à une hiérarchie d’ensemble.
A lui, l’employeur va essayer d’imposer un coresponsabilité, pas seulement l’obligation de « vendre sa force de travail », mais une « obligation de résultats » qui… relève pourtant de l’employeur. Le contrat de travail de l’encadrement, « faut-il accepter d’être responsable ? » est une tentative d’escroquerie patronale qui vise à modifier la signification de la réalisation de l’objectif, pour un cadre qui n’en a pas la maîtrise (choix d’organisation, état du marché, évolution de la concurrence, objectifs stratégiques du seul ressort de l’employeur, etc.). Cela créée une vraie-fausse subordination de l’encadrement prégnante, masquée par une apparence de liberté dans l’exécution quotidienne du travail et exclusive de la plupart des compensations inhérentes à l’état de salarié. On pourrait dire : « ni le beurre, ni l’argent du beurre».
« La dégradation des conditions de travail est générale, l’urgence réduit la prévisibilité des tâches et les marges de manœuvre pour les réaliser. La charge mentale s’accroît et la pénibilité du travail. » (Vingt ans de conditions de travail, Jennifer Bue, Nicole Guignon, Sylvie Hamon-Cholet, Lydie Vinck, Données sociales 2003, 2004, Insee, p. 273).
Toutes les enquêtes convergent et démontrent que les catégories que l’Insee appelle curieusement « intermédiaires » et l’immense majorité des cadres aussi bien dans l’industrie que dans les services, ont été également touchées.
Sophie Audric (« qualification et diplômes » p 183, données sociales Insee 2002-2003) signale que de 1995 à 2000, l’emploi non qualifié augmente sans que l’emploi des moins diplômés montre une reprise : le paradoxe renvoie à un « déclassement » des diplômés, qui, à un niveau de diplôme donné, occupent des emplois de moins en moins qualifiés, lesquels se trouvent subventionnés par des exonérations de cotisations sociales. Les cadres connaissent eux aussi des périodes plus importantes de chômage et sont « tirés vers le bas ».
Il y a environ 3,5 millions de cadres dans notre pays privé et public. Et l’Insee calcule environ 6 millions avec les « PCS » (Professions et Catégories Socioprofessionnelles) ou « professions intermédiaires ». Mais les définitions ne sont pas claires. Si on comprend l’intérêt d’établir, de 1954 à 2003, une nomenclature, avec 9 puis 8 grands groupes subdivisés en 30 puis 42 catégories, par secteur d’activité, primaire, secondaire, tertiaire, et domaines, agriculture, commerce, industrie, il faut bien convenir que les « découpes » sont arbitraires, et prennent, à tort, souvent, un sens politique bien particulier.
On comprend qu’on puisse recenser 860 professions progressivement regroupées par l’Insee en fonction du statut (salarié ou indépendant, hélas, parfois mélangés), de la taille de l’entreprise, du secteur d’activité (dans un hôpital, il existe 271 métiers), du niveau de qualification nécessaire pour l’emploi exercé, mais faut-il en arriver aux 8 catégories retenues ?
1) les agriculteurs exploitants : secteur primaire ;
2) les artisans commerçants et chefs d’entreprises ;
3) les cadres, professions intellectuelles supérieures ;
4) les professions intermédiaires ;
5) les employés ;
6) les ouvriers ;
7) les retraités ;
8) les autres personnes sans activité professionnelle.
Les chômeurs ayant déjà travaillé y sont classés en fonction de leur dernier métier.
Cette classification nous dit-on, est, par exemple, utilisée pour du « marketing » pour savoir vers quel public orienter un produit, ou pour étudier la consommation d’une population. Mais est-ce bien pertinent pour appréhender aujourd’hui la classe salariale active occupée, dans son ensemble ? Ces huit catégories ne sont évidemment pas significatives de huit classes sociales encore moins de couches basses, supérieures ou « moyennes » du salariat. Que vaut, dans ce cas, « l’intermédiaire » ? Classés dans une même catégorie de « PCS », des ouvriers peuvent gagner du simple au double, être non qualifiés ou hyper qualifiés. Les PCS sont donc très hétérogènes, contrairement à l’apparence donnée et l’on aurait tort de croire qu’entre les cadres et les professions intellectuelles supérieures, d’un côté, et les ouvriers, employés de l’autre, il y aurait une catégorie stable, représentative, saisissable, que seraient lesdites « professions intermédiaires »…
Car, de qui s’agit-il ? D’infirmières ou d’enseignants, de Vrp ou de cadres d’entreprise, de professions de l’enseignement, de la santé, de la fonction publique et assimilés, de professions administratives et commerciales, de techniciens, de contremaîtres, agents de maîtrise ? Est-ce le « bas des cadres » ou le « haut des employés et ouvriers » ? Autrement dit, il peut parfois y avoir plus de différences entre des membres d’une même « PCS » « intermédiaires » que dans deux PCS distinctes. Un employé peut se sentir plus proche d’un cadre selon son statut (diplôme, position hiérarchique, salaire), tandis qu’un employé moins élevé dans la hiérarchie est donc plus proche d’un ouvrier que d’un cadre. C’est aussi là, dans ces catégories dites « intermédiaires », qu’il y a le plus de mobilité de carrière. Ces catégories ne tiennent pas compte de l’ascension sociale ni de la précarité des emplois, CDD, temps partiel… et, enfin, au sein d’un ménage, elles ne comptabilisent que le travailleur référant, l’homme, a contrario de la féminisation croissante du salariat.
Finalement, c’est une question d’image, de vécu, de conscience, mais matériellement, les destins salariaux, statutaires, professionnels, sont croisés et proches. Que tout le monde veuille se « hausser » dans la hiérarchie sociale, se considérer au-dessus de telle ou telle autre catégorie, les « A » par rapport aux « B », les « B » par rapport aux « C », les écarts, réels, ne sont pas si énormes, les droits ne sont pas si différents, les devenir sont proches.
Un bas, un milieu et un haut du même salariat
Répétons le, ici encore une fois, sous cet angle, l’expression de « couche (s) » ou « classe (s) moyenne (s) » n’a pas de sens ! Même Louis Chauvel qui décortiquait « Les classes moyennes à la dérive » (in La république des idées » au Seuil, nov. 2006) avait du mal à cerner son sujet : « La classe médiane, celle située au centre exact de la société, a tendance à voir son homogénéité décroître. (…) Les professions intermédiaires stagnent numériquement, et l’homogénéité de revenu des catégories proches de la médiane décline ». Il affirme qu’il y a des « nouvelles classes moyennes salariées » mais qu’elles « commencent à subir une perte d’homogénéité entre le déclassement social de la fraction qui voit s’évanouir les rêves d’ascension ouverts naguère dans le cadre de la société salariale et la promotion de celle qui s’élève vers la bourgeoisie patrimoniale… » (In « le retour des forces sociales », revue de l’OFCE, n°79, 2001)
Aux questions qu’il pose, les « nouvelles classes moyennes » sont-elles une classe ? Sont elles moyennes ? Sont elles nouvelles ? On répondra « non ».
Tellement il semble plus naturel, global, et juste de décrire, ainsi que nous le faisons, la classe salariale comme un véritable ensemble cohérent, par-delà ses diversités.
S’il convient de constater, le rapprochement du « bas des cadres » et du « haut des employés et ouvriers » par contre, les cadres ne sont pas correctement « catégorisés », eux, par l’Insee, comme ils devraient l’être : c’est-à-dire, séparément entre « cadres » et « cadres supérieurs ». De même que ne le sont pas « salariés subordonnés » et « travailleurs indépendants ».
S’il en est une, ce serait pourtant une clarification parmi les plus nécessaires : car elle porte sur le fond, contrat, salaire, subordination. En effet, les cadres supérieurs se distinguent, légalement, explicitement du statut des autres cadres qui ne sont pas « supérieurs ».
Un cadre supérieur exerce des fonctions de haute direction qui relèvent habituellement, directement du conseil d’administration, de la présidence ou de la vice-présidence de l’organisation ou de l’entreprise. Il possède un pouvoir décisionnel important et il peut engager l’entreprise sur des questions primordiales. Le terme « supérieur » présuppose généralement qu’il existe d’autres cadres dans l’entreprise. La personne qui est cadre supérieur a donc fréquemment sous sa responsabilité des cadres intermédiaires. Cela se traduit par des différences substantielles de salaires qui assimilent cette catégorie davantage patrons qu’aux autres cadres. Cette définition juridique, on le voit, aboutit à ce qu’il y ait numériquement très peu de « cadres supérieurs », sans doute moins de 1 % des cadres. Cette précision aiderait à faire tomber le célèbre mythe des « bobos » (bourgeois bohêmes) et l’usage abusif de l’expression « cadres supérieurs ». Ceux qui croient fonder des théories ou même des pratiques électorales sur les « bobos » invoqués à tout bout de champ, doivent se déciller les yeux.
Plus de 98 % des cadres sont donc « de droit commun » au travail comme tous les autres salariés. Même si beaucoup, parmi eux, se croient « supérieurs ».
Dans leur écrasante majorité, les cadres, selon les enquêtes les plus récentes, ont perdu le peu d’autonomie qu’ils avaient dans le cadre des tâches productives qui leur sont assignées. Ils ont pour l’immense majorité des fonctions d’exécution autant que d’encadrement.
Bien sûr, leur vécu conscient est plus complexe, une partie d’entre eux se jouent des films dans leur tête sur leur « supériorité », mais cela ne résiste pas longtemps à l’examen : les entretiens de notation individualisés, les « notes de services », les redéfinitions de postes, les objectifs fixés, le « management » brutal sont vite là pour rabaisser le cadre à sa juste place, à sa juste valeur… de salarié. Les « forfaits jour » sont un leurre terrible pour faire croire que l’on est « hors classe ». D’où l’importance de faire reculer l’idée totalement fausse mais répandue selon laquelle les cadres échapperaient au salariat parce qu’ils « n’auraient pas d’horaires ». La recherche du « cadre autonome » « dont on ne peut pas prédéterminer l’horaire » qui peut donc se voir appliquer (si un syndicat signe un accord en ce sens) un « forfait jour », s’apparente à la célèbre « chasse au dahu ». Il est plus facile aujourd’hui qu’hier, si la volonté existe, de prédéterminer et vérifier les horaires réels de travail effectués par les cadres, car il y a des « pointeuses naturelles » partout et l’on sait à quelle heure un ordinateur est ouvert ou fermé, un appel ou un courriel sont reçus, etc.
Comme pour les auto entrepreneurs ou les télétravailleurs, le sentiment de « liberté » au travail ne résiste pas au temps : tel journaliste qui aime son métier, qui se croit « privilégié » en le faisant, finit par compter et comparer son « temps pour vivre » et les heures sans fin consacrées à « faire un « son » ou une « pige », on un « sujet imagé ». Il s’aperçoit alors qu’il ferait mieux de ne pas compter ses piges en « feuillets » comme le font, de façon illicite, tous les patrons de presse : il faut parfois trente minutes et parfois trois jours pour faire « trois feuillets » ! C’est pourquoi la loi Cressard (juillet 1974) et la circulaire sur les pigistes de 1991 poussent à caractériser un « pigiste » comme salarié, et à compter les commandes de piges en équivalents horaires.
La tendance générale, en même temps qu’ils augmentaient en masse, a été de « banaliser » les cadres, de les assimiler au reste du salariat, y compris au plan de la rémunération. Plus de 40 % des cadres sont passés en dessous du plancher de la Sécurité sociale. La moyenne des salaires des cadres n’est plus que de 2,3 fois la moyenne des salaires des employés et des ouvriers. Cet écart a été abaissé progressivement de 3,9 en 1955 à 2,5 en 1998.
On peut maintenant voir ces tendances de fond exister avec recul : si l’on considère les années au tournant du siècle : 43 % des cadres en 2000, 32 % en 2001 ont subi une perte de pouvoir d’achat selon l’observatoire de la CFDT… Les augmentations individuelles prenaient une place accrue : 48 % contre 64 % pour les augmentations collectives et… rien dans le cas de 15 % des cadres.
D’ailleurs toutes les systématisations raffinées de « primes individuelles » de « salaire au mérite » finissent par créer plus de zizanies et moins de rentabilité dans l’entreprise qu’une politique salariale claire et transparente sur qualifications et anciennetés. Le temps passé à émettre des « grilles de notations », à définir des centaines de paramètres personnalisés finissent par noyer et déconsidérer cette méthode de division qui consiste à payer à la « tête du salarié ». Bien sûr, cela marche, un temps, là où il n’y a aucune conscience, aucun syndicat, aucune mémoire comparative, et des patrons, heureux, croient avoir trouvé la solution-miracle pour séparer leurs cadres « favoris » des autres, séparer ceux-ci de leurs employés et leurs employés de leurs ouvriers, et éviter d’avoir en face d’eux une seule catégorie revendicative de salariés. Il y a des salariés qui viennent à l’inspection du travail pour obtenir une prime… que leur collègue a eue, et pas eux. Mais, même en faisant cette démarche, ils prennent conscience de la vanité de leur situation. Le salaire individualisé est censé remplacer de façon prétendument moderne, le bon vieux « paternalisme ». Mais à quel prix ? Les intrigues, le climat dégradé, les concurrences, le turn-over, font perdre autant d’énergie à la bonne marche de l’entreprise. Cela n’évite jamais que les salariés tôt ou tard, se sentent, comme ils le disent alors : « dans la même galère ».
Avec 700 suicides liés au travail, par an, touchant toutes les catégories, le cadre de Renault aussi bien que l’ouvrier de Peugeot Sochaux, la France montre cruellement une forme d’unité de son salariat : « burn out » et « karoshi » ne sont pas seulement britanniques ou japonais, on se tue au travail aussi bien dans les Yvelines et en France Comté avec la crainte de devenir « SDF » (partagée par plus des deux tiers des salariés). 600 accidents mortels du travail, 4500 handicapés, 650 000 accidents avec arrêt, ca soude aussi entre eux ceux qui vendent leur force de travail.
C’est aussi ce que Macron est incapable de comprendre quand il dit « qu’un employeur court plus de risques qu’un salarié ». Une autre de ces macronades qui le place hors de la réalité sociale.
La mode des « DRH » est, depuis longtemps, d’appeler les salariés (et surtout les cadres) « collaborateurs » : façon de nier idéologiquement la « subordination » et de leur faire croire qu’ils sont dans le « même bateau ». « On est tous devant le même challenge, le même défi, la même entreprise… » jusqu’à ce que le capitaine parte avec le bateau et que les salariés restent amarrés sur le quai au Pôle emploi, là, ils prennent conscience des limites de la « collaboration ».
Il y a évidemment des différences de statut, de salaires et de contrat de travail selon la taille des entreprises, mais ces différenciations traversent la classe salariale sans la briser. Lorsque nous affirmons que non seulement, elle n’est pas « vouée à disparaître », qu’elle existe, qu’elle n’a jamais été aussi puissante, que ses points communs l’emportent, qu’elle est la force sociale ascendante, nous ne nions pas ces différenciations à l’œuvre : mais la classe salariale est comme le « tiers état » hier, elle n’est rien, mais elle devient tout.
En face du salariat, c’est le « patronat », lui, qui n’est pas si homogène qu’il y parait : les donneurs d’ordre sont du côté des « requins » du CAC 40, et 80 % des PMI, PME, ETI sont sous traitantes, les petits patrons « sardines » subissent un sort aléatoire et précaire proche du salariat, même si, hélas, ils ne le vivent pas consciemment comme cela. (Cf. « Vive l’entreprise ? Ed. Gawsewitch, 2015)
S’il y avait une régulation de la sous-traitance, ce vécu changerait : encore un reproche à adresser au quinquennat d’Hollande, il n’a voulu déplaire en rien au Medef. Il aurait suffi d’introduire des changements : un seul niveau de sous-traitance, responsabilisation juridique, économique, financière, pénale du donneur d’ordre, facilitation de la reconnaissance des unités économiques et sociales, pour se gagner l’appui de centaines de milliers de petits patrons à la gauche. Mais Hollande ne voulait pas seulement faire « les reformes structurelles » de Mme Merkel, il cherchait à plaire, littéralement à « pactiser » avec Pierre Gattaz (il a même interrompu, pour donner des gages en ce sens, le processus d’amnistie concernant les délégués syndicaux qui avait été officiellement voté par le groupe socialiste du Sénat en 2012). Gattaz et le Medef n’ont jamais voulu signer un « pacte » avec Hollande, ce dernier en est resté la dupe volontaire.
Conscience en soi et pour soi du salariat
Le salariat est fort mais il ne le sait pas. C’est normal car la conscience de lui même ne peut lui venir que dans l’action de masse.
Le salariat existe « en soi », il faut qu’il existe « pour soi », selon la formule classique. Qu’une réalité objective devienne perçue subjectivement. Mais encore faut-il partir d’un même constat. C’est toute la question de la traduction de cette force sociale, au plan des luttes sociales, au plan syndical et au plan politique.
Ne doit-on pas constater qu’en France, nous avons, plus qu’ailleurs, des éléments qui démontrent que ce grand corps social tend à réagir de façon coordonnée, par-dessus ses différenciations internes ? En mai 68, à plusieurs reprises dans les années 70, en hiver 1986, en novembre décembre 1995, aux printemps 2003 et 2006, 2010 et 2016 ?
Mai 68, après la Commune et mai juin 36, a vraiment fait entrer le salariat de masse dans l’histoire : depuis Sud-Aviation jusqu’à Renault Cléon, toute l’industrie, les transports, l’énergie, tous les services publics, mais aussi toutes les catégories : les pompistes, les cinéastes et acteurs à Cannes, les gardiens de musée, et les joueurs de football…
Rien, là non plus, de « voué à disparaître ». 23 ans après sa grande défaite de 1958, la première grande victoire électorale de la gauche, en 1981, fut un résultat différé de mai 68. François Mitterrand y vit judicieusement une « victoire de la majorité sociologique ». Cela lui fut reproché : à tort. Les caractéristiques de mai 68 se sont retrouvées ensuite dans presque tous les mouvements : spontanéité, déferlement massif du mouvement capable d’entraîner les médias (pourtant hostiles au début), la jeunesse et le salariat, l’opinion publique.
Contrairement à ce qui a pu être écrit vulgairement, « mai 68 n’était pas la dernière grande grève du 19° siècle » (Serge July), mais la première grande grève prémonitoire du 21° siècle.
Depuis la grande grève générale de mai juin 68, des « répliques » n’ont cessé d’avoir lieu, contre les projets réactionnaires de la classe capitaliste. Tout se passe comme si la force de ce salariat fouaillait, en profondeur, les entrailles de notre société, et effrayait les possédants au point qu’ils n’aient de cesse de l’éradiquer. Un candidat de droite s’est même fait élire à la Présidence de la république, en promettant de « liquider mai 68 » : faut-il que cette grande grève de 11 millions de salariés soit encore obsédante quarante ans après !
Le salariat n’est pas qu’un grand corps inerte, inconscient, il lutte : en 1986, une mobilisation étudiante, une victime Malik Houssekine, suffirent à rappeler le mécanisme de mai 68, tous les syndicats unis, appelant à la grève, un raz-de-marée se préparant, le gouvernement retira son projet « Devaquet » visant à privatiser et à mettre en concurrence les universités. Un mois de mouvements sociaux suivirent, François Mitterrand leur doit sa ré élection en mai 1988.
En 1995, Alain Madelin, alors ministre de l’Economie de jacques Chirac, affirma au nom de la droite, qu’il « fallait un autre mai 68 et qu’on le gagne » : Alain Juppé précipita trois mois plus tard, une violente réforme de la Sécurité sociale (selon lui rendue nécessaire « depuis trente ans »), et il du reculer devant une longue quasi grève générale, portée surtout par le secteur public mais soutenue lors des « temps forts », tout aussi massivement par des manifestants du privé. L’importance de cette vague de grèves fut une surprise mondiale, car elle survenait dans un contexte totalement différent de mai 68, à contre-courant des reculs des salariés dans le monde, elle bravait les pressions du chômage et de la précarité. Cela aboutit à une fois encore à une dissolution de l’Assemblée nationale, et résultat différé des mobilisations de 1995, la gauche gagna encore en 1997.
En dépit de novembre décembre 95, François Dubet (qui voyait déjà la fin du mouvement ouvrier en 1984, in « Le mouvement ouvrier » Ed. Fayard) et Danilo Martucelli (« Dans quelle société vivons-nous ? » Le Seuil, 1998) persistèrent à écrire qu’ « aucun mouvement social central ne fédère ou ne charpente plus la totalité des mobilisations collectives. La société est constituée par un champ de luttes éparses qui essaient, chacune à sa manière, d’articuler des orientations hétérogènes ».
Combien de fois non seulement la fin du salariat pris comme un tout, mais celle des « luttes d’ensemble » n’a t elle pas été proclamée ?
Une autre mode consistait à écrire que plus rien n’était « comme avant » : il y avait des « nouveaux enjeux », des nouveaux « mouvements sociaux » (qu’on essayait alors d’opposer terme à terme à l’ancien « mouvement ouvrier »), des « nouvelles attentes » (Droits des femmes, droit devant – au logement- collectifs des « sans », sans-papiers, mouvements contre le racisme, contre les discriminations, pour les droits de minorités sexuelles, etc.). Mais rien de tout cela n’était vraiment nouveau dans les années 90 par rapport aux années 70. Erick Neveu (sociologie des mouvements sociaux, collection Repères, La Découverte 2002) soulignait que cette énumération était un « réflexe de brocanteur » : elle évitait de percevoir le mouvement d’ensemble sous-jacent et son expression politique.
En 2003, l’immense mouvement en défense des retraites par répartition à 60 ans, contre la scélérate « loi Fillon », dura plus de 140 jours, avec 11 journées nationales de grève enseignantes, 9 journées interprofessionnelles, quatre journées avec plus de 2 millions de manifestants, et fut cinq à six fois plus important que novembre décembre 1995. Il ne gagna pas par la faute d’une défection au sein du mouvement syndical, mais, alors que le gouvernement de droite, pour la première fois depuis des décennies, imposait son diktat, il y avait encore 66 % de l’opinion opposée à sa loi. Du coup, le syndicat qui avait fait défection entra en crise et perdit 100 000 adhérents, de 6 à 8 % aux élections professionnelles. La droite paya son coup de force en subissant une lourde défaite électorale, le 28 mars 2004, perdant 20 régions sur 22, 51 départements sur 100.
En 2006, reprenant d’ailleurs l’exemple d’un autre mouvement contre le « Cip » (un contrat d’insertion professionnelle, en fait un Smic jeune qui fut, en mars 1994, proposé puis retiré, contraint et forcé, par le Premier ministre d’alors, Edouard Balladur), la jeunesse initia encore une mobilisation généralisée contre le « CPE » (Contrat première embauche, de MM. de Villepin et Sarkozy, etc.). Là encore, on eut un schéma de mobilisation générale conjoint de la jeunesse et du salariat, avec des journées hebdomadaires atteignant jusqu’à 3,5 millions de manifestants. La droite et le Président Chirac, en complète débandade, promulguèrent une loi en demandant qu’elle ne s’applique pas : en fait, ils retiraient le « CPE ».
Parfois, en dépit de tout, des voix saisissent toute occasion pour insister sur la « faiblesse » ou la « mort du syndicalisme » : quel paradoxe, après l’année 2006 où le syndicalisme uni a remporté une éclatante victoire ! Il est vrai que les médias ont plus qu’une tendance à oublier les grandes luttes sociales, c’est plus qu’une tendance, c’est un ordre. Aussitôt vécues, aussitôt oubliées, effacées de la mémoire collective. Chaque jour, en France, on parle du CAC 40, mais une seule fois par an, le 30 juin, veille des départs en vacances, il y a un rapport annuel, d’ailleurs contestable, sur les mouvements sociaux de l’année précédente.
Hiver 1986, novembre décembre 1995, printemps 2003 et 2006, les mouvements pour els retraites de 2010 et contre la loi El Khomri de 2016, la France de mai 68 persiste : le monde entier admire les mouvements d’ensemble coordonnés de son salariat. Ainsi, le salariat n’est pas seulement une construction juridique, sociologique, économique, historique, mais aussi un mouvement social, syndical et politique ascendant.
De toute façon l’identification consciente de la classe salariale par elle-même est un combat.
Nul ne peut nier qu’elle a de puissants et irréductibles ennemis idéologiques, économiques, politiques. En face du salariat, il y a l’actionnariat, le patronat. Et ces derniers ne ménagent pas leurs efforts pour casser cette prise de conscience qu’ils redoutent tant, du salariat par lui-même. La classe dominante qui possède la finance et les moyens de production a intérêt vital à acheter le travail au moindre coût afin d’élever le plus possible ses profits. Elle fait tout pour que le salariat ne soit pas identifié, reconnu, valorisé, encore moins unifié : tout ce qui l’empêche de prendre conscience de sa force collective est bon. Ils oeuvrent sciemment à déconstruire, juridiquement, socialement, économiquement cette immense force sociale, qui a été engendrée, en son sein par le système capitaliste. Et la division des rangs de la gauche est leur meilleure alliée.
Mais de 2002 a 2012, en dépit de la défaite surprise de Lionel Jospin, le salariat a voté a gauche de façon constante : en juin 2012, la gauche détenait tous les pouvoirs, la Présidence, l’Assemblée, le Sénat (pour la première fois depuis 200 ans), 2 villes sur 3, 20 régions sur 22, 61 départements sur 101. Cette puissante montée électorale sans précédent correspondait à une montée en puissance du salariat, résistant aux multiples offensives de la droite et du Medef.
Ce fut la première fois en 100 ans, qu’un gouvernement de gauche, si bien élu n’apporta rien aux salariés ; pas une seule avance, pas une seule conquête. Au contraire François Hollande bloqua les salaires et haussa les dividendes, il défit ce que Léon Blum, François Mitterrand avait fait, il remit en cause les 40 h, les 39 h et les 35 h. Il entama la plus inimaginable des contre révolutions en droit du travail à travers la loi El Khomri, préparant le pire avec Macron.
Pour bien comprendre le salariat que Macron affronte frontalement, il faut encore prendre la peine de balayer les cliches sur ce que celui ci est vraiment et pas seulement tourner en dérision les lubies des start up et d’Uber.
Le salariat ne se réduit pas à la « la classe ouvrière »
Réduire la « classe laborieuse » ou le « prolétariat » aux seuls ouvriers d’industrie ou d’entretien, revient à passer à côté du profond développement et du phénomène d’homogénéisation du salariat. C’est refuser un immense terrain d’action, et la mobilisation de forces considérables, majoritaires numériquement.
« L’ouvriérisme » est une erreur, c’est s’accrocher, souvent avec nostalgie, remords, regrets et pessimisme à la seule « culture ouvrière » du milieu du XX° siècle, à ses stricts bastions traditionnels et à l’âge d’or du « parvis des mines » et des « passerelles de Billancourt ». C’est le passé, glorieux et émouvant, mais avec une imagerie elle même dépassée. Il vaut mieux aujourd’hui glorifier le salarié qui n’a que sa force de travail à vendre » point commun à celles et ceux qui produisent les richesses et n’en reçoivent pas la part qu’il méritent.
Il y avait en 1973, 4 553 000 employés, il y en a 7 132 000 en 2005
Il y avait en 1973, 7 651 000 ouvriers, il y en a 5 972 000 en 2005
Ce « chassé-croisé » doit être examiné avec attention. D’abord pour souligner qu’il y a, selon les catégories de l’Insee, 13 104 000 d’employés et d’ouvriers au total, soit la majorité écrasante de la population active occupée. (Et, on va le voir ci-dessous, nombre des 3 millions des « professions intermédiaires », et des 3,5 millions de cadres, leur sont assimilables).
Il est indispensable de balayer les idées reçues : « il n’y aurait plus d’ouvriers », on serait une population de « bobos » (de « cadres supérieurs »), les unités de production seraient morcelées, éclatées, disparues, les services auraient tué l’industrie ». C’est faux !
Inversement, qui voudrait réduire la classe sociale travailleuse aux seuls « ouvriers », ou pire s’accrocher aux seuls 3 millions d’ouvriers d’industrie « purs », et ne pas prendre acte de la masse de 13 à 15 millions, la plus laborieuse du salariat, se priverait de comprendre un profond phénomène d’homogénéisation et refuserait un immense terrain d’action.
S’accrocher à la « seule culture ouvrière », aux « cols bleus », à ses bastions traditionnels, est plus qu’une erreur d’optique. Ce réflexe est encore culturellement, sociologiquement, syndicalement, politiquement puissant : si jamais il eût un sens hier, il n’en a plus de véritable aujourd’hui.
L ‘ouvriérisme est loin d’être mort : il ne mérite pourtant pas de complaisance, car, nonobstant une sympathique larme sentimentale, il appauvrit les idées, conforte le passéisme, divise les efforts pour comprendre et agir. Il rabougrit le champ d’action donc de l’espoir. Bien sûr, il y a une légende, une culture, un âge d’or du parvis des mines et des passerelles de Billancourt, des corons et des bastions, mais ce qui s’offre aux acteurs du temps présent est une friche infiniment plus vaste, fertile, stimulante.
Parler aujourd’hui de « classe ouvrière » est devenu réducteur : c’est valoriser une partie devenue minoritaire des salariés, et négliger, voire mépriser, une autre partie devenue socialement majoritaire mais tout aussi exploitée. Pire, certains s’emploient à ne retenir que les seuls ouvriers d’industrie, lesquels, sont devenus minoritaires numériquement au sein même des ouvriers. C’est encore plus réducteur : toute politique fondée sur cette seule force sociale ainsi découpée, est vouée à devenir de plus en plus marginale, sectaire ou gauchiste et à passer à côté des champs étendus de l’ensemble du salariat.
« Prolétariat » est un mot, qui lorsqu’il est assimilé à « classe ouvrière » subit la même dévaluation socio-politique. Le concept, lui aussi, a moins de valeur représentative et utile dorénavant que le mot « salariat ». Dans l’ensemble des littératures, enquêtes, études, discours vulgarisés, « salariat » prend, il est vrai de plus en plus d’importance, mais cela se fait empiriquement. Il faut théoriser pour que cela soit un acte conscient et collectif.
Ne pas voir que le salariat a englobé et dépassé « la classe ouvrière » et qu’il est aujourd’hui synonyme de « prolétariat » est mutilant aussi bien pour toute analyse que pour toute action en découlant. La littérature abondante sur ce sujet s’est doublée de visions romantiques, désespérées, révisionnistes, conservatrices ou sectaires, qui font obstacle à l’appréhension de la classe salariale d’aujourd’hui et de toute sa force potentielle.
En cultivant ainsi une nostalgie, on pleurniche sur le siècle passé, et sans voir l’immense mission d’unification d’un prolétariat devenu totalement majoritaire. Ils sont trop nombreux à le faire, ceux qui se désespèrent de la fin de la classe ouvrière, et contribuent, consciemment ou non, à démobiliser, diviser et aveugler. Démobiliser sur la compréhension du rôle maintenu, toujours aussi grand, des « ouvriers » dans la production. Diviser en refusant d’amalgamer, d‘intégrer, d’unifier tous les producteurs travailleurs subordonnés. Aveugler sur la perception du champ immense, plus puissant que jamais, de l’ensemble du salariat.
Il est absurde de ne pas voir que c’est l’ensemble du salariat qui est devenu une classe socialement majoritaire et tout autant exploitée.
Le temps n’est pas de décrire à l’infini les différenciations, divisions, fragmentations, catégories, secteurs, internes au salariat, il est de chercher ses points communs et de l’unifier.
Il ne s’agit pas des « couches moyennes »
Un autre aveuglement anti salariat consiste à tronçonner la population active et active occupée en couches ou classes « populaire(s) », « moyenne(s) », « supérieure(s) », « intermédiaire(s) », au singulier ou au pluriel selon les cas, et à fragmenter encore un peu plus les catégories ainsi créées en multiples sous-couches et sous-classes. De quoi atomiser le salariat pour mieux nier son existence en tant que tel et de quoi désespérer les millions de porteurs d’une feuille de paie d’avoir un seul point commun.
Il n’y a pas que ceux qui s’accrochent au fétichisme de « classe ouvrière », qu’ils confondent avec le « prolétariat », qui se trompent, il y a aussi ceux qui, le rejetant, en profitent pour ne plus y voir qu’une « couche moyenne » : ce fut par exemple, la thèse de Dominique Strauss-Kahn, (DSK) dans son livre, (Dominique Strauss-Kahn, Grasset, 2002), « La flamme et la cendre » où il explique que notre société est dorénavant structurée en un grand corps central, une grande couche moyenne… composée des salariés. C’est bien la « grande classe » sociale, mais elle n’est plus exploitée, ni dominée, elle ne demande qu’à se réaliser bien au chaud, au sein du système tel qu’il existe.
Ce n’était pas très nouveau, en fait, Marx était à peine mort que toutes les théories voyaient proliférer d’énormes et nouvelles petites bourgeoisies de fonctionnaires, d’employés supérieurs, de cadres ingénieurs, techniciens, ITC, CSP+, de nouvelles professions libérales, du secteur « tertiaire » hypertrophié, etc. (Un des premiers « réviseurs » de ce type fut Bernstein). Magnifiques tours de passe-passe ont tous l’avantage d’aboutir au même résultat : le prolétariat est disparu, le salariat n’est pas ce que vous croyez…
Des courants réduisent aussi le prolétariat aux « sans », sans papier, sans logement, sans travail, etc. Ségolène Royal avait aussi affirmé que « le nouveau prolétariat, c’était le salariat féminin ». Autre forme d’expression réductrice qui ne rend service ni à la grande force du salariat ni, en son sein, au salariat féminin : pourquoi l’isoler les combattants des combattants ?
Bien que DSK ait été discrédite politiquement, ses idées ont malheureusement fait florès dans l’aile droite du Parti socialiste et dans l’entourage de François Hollande. Les « think thank » se sont régalés en rebaptisant l’ensemble du salariat « couches moyennes »
Selon cette thèse, il n’y aurait plus qu’environ 20 % d’exclus, de chômeurs en fin de droits et non ré insérables, de Rmistes, de travailleurs pauvres et précaires, de marginaux sociaux. « Flamme bourgeoise, cendre prolétarienne » persifla Serge Halimi. D’autres inventent des borborygmes « insiders » « outsiders ». Il survit des sous produits des classes sociales, mais elles ne se définissent plus selon leur place dans les processus de production. Cette catégorie de pauvres et d’exclus c’est qui resterait de l’ancien prolétariat révolutionnaire, le résidu de la division en classes antagonistes, ultime partie du peuple surexploité et humilié. Elle n’a pas vocation à changer le monde. Cette couche d’exclus ne vote pas ou plus, et elle ne lutte guère, elle est dépossédée de la puissance d’agir socialement, la droite l’ignore à cause de cela, elle ne fait plus peur, il n’y a pas de risque de révolution à cause d’elle. Cependant les socialistes, parce qu’ils sont socialistes, doivent s’en préoccuper et soulager sa misère, l’aider, diminuer l’impact qu’elle a encore, malgré tout, en tirant la société vers le bas, en menaçant son bien-être et son équilibre général. Sans doute faut-il mettre en place la « Couverture maladie universelle », et la « Couverture logement universelle ». Sans doute faut-il lutter en priorité contre le chômage. Sans doute faut-il faciliter les mesures de réinsertion, de formation sur toute la vie. Le nouveau socialisme du réel, version « DSK » ex social-démocrate moderne, c’est de donner la main de façon volontariste à ces exclus. Une politique qui peut même prendre des formes « communicantes » spectaculaires comme : « zéro SDF. » Mais une politique qui n’a plus rien à voir avec la lutte de classes ente exploiteurs et exploites.
Reste donc ensuite la « grande couche moyenne centrale ». Ce serait le salariat lequel bénéficierait des bienfaits du système (capitaliste) et qui aspirerait à en bénéficier mieux, davantage. Ce salariat homogène « grande couche moyenne centrale », serait intégré, il ne serait pas hostile au système, il s’y fondrait, au contraire il le voudrait plus rentable, plus efficace… L’horizon du système capitaliste devient indépassable, et ce que doivent faire les derniers partisans sociaux-démocrates du « socialisme réel », c’est donc faire mieux marcher l’industrie, le commerce, les échanges, l’innovation, la production, c’est rendre le capitalisme meilleur, afin de satisfaire les souhaits fondamentaux de cette grande couche sociale moyenne qui ne demande que cela. Après tout, Herbert Marcuse, son disciple Lucien Goldmann, Serge Mallet (inspirateur du PSU des années 60) croyaient distinguer aussi une « nouvelle classe ouvrière », les « blouses blanches », celle des « industries nouvelles » porteurs d’une « révolution des élites »…
La grande leçon du dernier livre de DSK, avant sa déchéance, se trouve au coin d’une phrase, p. 25 et elle est extraordinaire : « La redistribution est près d’avoir atteint ses limites, en même temps que certains de ses objectifs ». Fermez le ban.
On a entendu des responsables centraux du PS, après le désastreux quinquennat de François Hollande, essayer de trouver là une ébauche d’explication : « La social démocratie est en recul parce qu’elle a atteint ses objectifs » ont avancé Christophe Borgel ou Jean-Marc Germain en juin 2017. Pour l’essentiel, la redistribution serait faite et c’est ce qui expliquerait que le PS perde sa fonction, ses électeurs, et que « la crise frappe toute la social-démocratie européenne ». Ils se sentent déjà tellement insérés et condamnés à évoluer dans le haut de la société qu’ils s’identifient aux « couches moyennes » à travers leurs sommets : comblés, à 10 000 euros par mois, leur existence déterminant leur conscience, les dirigeants sociaux démocrates attribuent au peuple leurs sentiments, puisqu’il existe une protection sociale, des retraites, l’essentiel est fait et le peuple salarié, transformé en grande couche moyenne incontournable, se détourne de ceux qui l’ont servi…
Et quand vous objectez à cette vision du monde « - Mais il existe 6,7 millions de chômeurs, 50 % de salaires en dessous de 1680 euros, 9 millions de pauvres, misère et illettrisme » l’exploitation est de plus en plus féroce, ils le nient, ils vous répondent que « tout n’est pas parfait », mais que la société doit se perfectionner et que c’est ce qu’a essayé de faire François Hollande, de redresser la barre, faire reculer les déficits, de faire « tampon » entre la finance, Mme Merkel, l’oligarchie et les derniers pauvres. « On a essayé de fabriquer des bonbons, mais on n’a pas pu les redistribuer à temps » ! La courbe du chômage a pris trop de temps à se stabiliser. Alors bien sur les efforts pour les exclus du bas de l’échelle ont été insuffisants. Mais « on » a été injustement sanctionné par nos électeurs malgré notre bon cœur, et notre bonne politique, « parce qu’ils ne votent plus ». Le salariat lui, dans sa majorité à un travail, de l’argent a été mis pour l’école, et « ça va mieux en France qu’ailleurs », donc il n’y a pas de problème de redistribution, de social, il n’y a qu’un problème d’idéologie, de nationalité, d’institutions, d’ordre républicain, de laïcité, de sécurité…
Le « montage » qui tient lieu d’analyse sociopolitique de DSK ne tient pas même si sa fonction politique est évidente puisqu’il revient à marginaliser tout projet socialiste, à le réduire à la charité compassionnelle d’une part, à une recherche de rentabilité rationalisée d’autre part, en prétendant qu’il n’y a plus de force sociale pour imposer un vrai changement. Finie la révolution, vive le socialisme du réel, c’est le capitalisme qui marche le mieux.
C’est donc à ce stade, qu’il faut faire litière des approximations qui fleurissent partout, dans la presse, la littérature et la politique : on nous parle indifféremment, sans aucune réflexion, de « couches populaires » ou même « classes populaires » (au singulier et au pluriel, sans rigueur aucune), de « couches ou classes moyennes », de « couches ou classes supérieures », tout cela dans la plus grande confusion. On entend des portes paroles très sérieux, et très responsables, à l’écrit, à l’oral, à l’image, utiliser à tour de rôle une expression ou l’autre sans se soucier de la définir, pas même de la décrire. Esprits vagues, vagues esprits.
Il y a même des stratégies qui s’élaborent en fonction desdites « couches » ou « classes », sans que l’on sache ce qu’elles sont le moins du monde. Tel article ou discours attribuera des vertus approximatives et éphémères aux « cadres » ou aux « ouvriers », puis, sans qu’on sache de quoi il relève, aux « professions intermédiaires ». Tous ceux-là voient le salariat « voué à disparaître » : ils le remplacent globalement par les « couches moyennes ». Ou bien leur propre vécu leur fait encore surestimer les « professions libérales », les indépendants et là, ça devient du Macron.
D’autres encore recherchent « des couches moyennes, intermédiaires » dans le salariat, niant son existence en tant que tel, le décomposant, le tronçonnant en différentes sous « couches » ou sous « classes », en dépit de ses spécificités globales clairement identifiées. Ils ne veulent plus voir que les différences, les fragmentations au détriment de l’ensemble. Ils se complaisent à subdiviser les sous catégories, les groupes, les précaires et les fameux « bobos », sans parvenir à voir les points communs déterminants. De quoi désespérer les 24 millions de porteurs d’une feuille de paie d’avoir un seul point commun.
« Voyage au centre des classes moyennes : vers le milieu de nulle part ? » se moquait fort bien C. Doubstar, (dans une chronique sociale de juillet 2006, « Lettre d’information de Pénombre ») : « Cette France du milieu qui a besoin de futur ». C’est avec ce titre que le dossier du supplément « Économie » du Monde, daté du 21 juin 2005, en trois pages, expliquait déjà le « mal-être » des classes moyennes, leurs « frustrations », leur vague à l’âme, outre-Atlantique également, et tentait d’en définir les contours. Puis, dans son édition du 1er septembre 2005, le même journal titrait la rubrique « Politique économique » : « Matignon veut un big-bang fiscal en faveur des classes moyennes ». Et sans désemparer, le lendemain 2 septembre, le même journal, à propos du plan de « croissance sociale » du Premier ministre, intitulait un article « Les classes moyennes sont courtisées par la droite et par la gauche », lequel prenait soin de préciser que « les partis ne manquent pas une occasion de courtiser les classes moyennes qui, bien qu’insaisissables et hétérogènes, détiennent la clef des urnes ».
Les « classes moyennes », c’est en effet le triangle des Bermudes, plus on les cherche, plus on s’y perd. En fait, elles n’existent pas autrement que comme leurre.
On peut dire qu’il y a eu des centaines d’articles depuis 20 ans dans cette veine mais sans convaincre, car c’est le salariat qui progressait en dépit du chômage, des analyses, des coups portés idéologiquement et juridiquement contre son statut. Ils ont déjà ré écrit entièrement le code du travail par ordonnance entre 2004 et 2008 : ils ont supprimé 10 % du texte, enlevé 1,5 million de signes, supprimé un libre sur 9, 50 ù des lois et redécoupé celles qui restaient en 3 850 autres lois renumérotés à quatre chiffres au lieu de 3 chiffres. Mais la magie anti code du travail ne suffit ni à réduire ni à transformer le salariat. Pour eux, la nouvelle société se résume à une grande couche moyenne centrale, il faudrait apprendre à lui plaire, la question ne serait plus de redistribuer les richesses. Leur monde, c’est 1 % de décideurs en haut, 80 % de couches moyennes et 20 % d’insiders.
Mais la réalité est autre : leur tour de passe analytique rend hommage a contrario à notre sujet : le salariat est bien là, le changement social fondamental de toutes ces dernières décennies, c’est bien le développement de sa puissance économique et sociale ! Mais justement, ce grand corps social est en confrontation avec le système : il n’est pas une « grande couche moyenne », il est LA couche majoritairement spoliée, subordonnée, surexploitée du système. Il produit toutes les richesses, mais il n’en reçoit pas, en retour, la part qu’il mérite.
En vérité, il n’y a pas de « couche moyenne », il y a ceux qui possèdent et contrôlent les moyens de production, les 1 %, les 5 % à 10 % de la population, selon la façon étroite ou large de les compter, avec familles proches et soumis, les employeurs et cadres supérieurs assimilés, actionnaires, rentiers, libéraux qui possèdent 50 % du patrimoine du pays. En face, il y a encore et toujours 93 % à 90 % de la population active salariée.
Les « indépendants » ont un passé mais pas d’avenir
Magnifier les indépendants non salariés est une autre grossière erreur :
L’économie informelle a reculé, les « sans statuts » et start up, sont archi minoritaires et ce ne sont pas les quelques dizaines de milliers d’auto entrepreneurs effectifs qui vont changer cela. Alain Madelin et Raffarin, avant Macron, se vantaient en 1995 ou 2005, de créer des millions d’entreprises uninominales mais en vingt ans cela reste heureusement un mouvement superficiel.
Il existe sur le papier 1,65 million d’entreprises sans salariés. Il faut remettre les faits a leur place : l’artisanat n’est pas la plus grande entreprise de France, mais une myriade de très petites, et d’individuelles. Selon la CAPEB, l’artisanat du bâtiment représenterait environ 422 000 entreprises, 702 000 salariés (60% des effectifs) et 76 800 apprentis (81 % des apprentis du secteur) pour un CA de 77,7 milliards d’euros en 2012 (63 % du CA du bâtiment en France). L’UPA fédère 300 métiers de l’artisanat, et annonce 11, million d’entreprises artisanales, dont 231 du commerce de proximité et de l’hôtellerie restauration.
Toutes les tentatives pour défendre ou recréer des « travailleurs indépendants » en dépit et contre le salariat ont échoué : il vaut la peine de souligner celle d’Alain Madelin, ministre de l’industrie, par une loi du 11 février 1994, voulant rétablir une « présomption de non salariat » au profit des travailleurs indépendants (personnes physiques, immatriculés à titre individuel notamment au registre du commerce et des sociétés (RCS), au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux, auprès de l’Urssaf pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales). Les dirigeants des personnes morales immatriculées au RCS et leurs salariés étaient présumés ne pas être subordonnés avec un donneur d’ouvrage par un contrat de travail dans l’exécution de leur activité.
La loi Madelin en 1995 imposait que pour prouver l’existence d’un contrat de travail, l’administration devait établir de façon formelle que le travailleur indépendant fournissait ses prestations au donneur d’ouvrage dans des conditions qui le plaçaient dans un lien de subordination juridique permanent vis-à-vis de ce dernier. C’était la fin de la « présomption de salariat ».
Et dans l’hypothèse où l’administration y parvenait, le donneur d’ouvrage n’était passible de sanctions pour travail dissimulé que s’il était démontré qu’il s’était soustrait intentionnellement à son obligation de remise d’un bulletin de salaire ou de déclaration préalable à l’embauche.
L’éventuelle requalification, même dans ce cas, d’un emploi non salarié en emploi salarié ne permettait plus aux organismes de protection sociale de réclamer les cotisations dues par l’employeur au titre de la période postérieure à cette requalification (alors qu’auparavant l’administration pouvait auparavant réclamer les cotisations dues antérieurement à cette période dans la limite de la prescription de ces cotisations, généralement 3 ans).
On peut dire de cette loi Madelin, qu’elle était une « loi anti-salariat » par excellence. Elle facilitait le remplacement d’un « contrat de travail » par un « contrat commercial », ce qui débarrassait le « travailleur indépendant » de toutes les obligations liées au Code du travail et son « donneur d’ordre » du paiement du salaire indirect, les cotisations sociales.
Macron et son entourage Medef et libertarien, sont obsédés par cela, puisqu’il sont encore revenus là dessus dès sa loi du 8 aout 2015 en modifiant en douce de façon perverse l’article 2064 du code civil.
Mais de 1995 à 2005, la loi Madelin et ses succédanés n’eut aucun impact : elle fut abolie, d’ailleurs, entre autres, partiellement sur l’insistance de l’auteur de ce livre, (par la loi Aubry II n° 2000-37 du 19 janvier 2000, relative à la réduction négociée du temps de travail qui a supprimé la présomption de non salariat instaurée par la loi Madelin du 11 février 1994 en abrogeant les deux premiers alinéas de l’article L 120-3 du Code du travail), le nombre de « travailleurs indépendants » dans ce pays n’avait pas ré augmenté et le télétravail stagnerait à 2 % en l’an 2016.
Ce fameux « télétravail » évoqué si souvent comme un « travail nomade » échappant au salariat, est très surfait : c’est davantage un retour, très limité en pratique, au vieux « travail à domicile », comme celui des dentellières du XIX° siècle. Les « télétravailleurs » ont vite un sentiment d’isolement, des variations de stress, et autant de difficultés à concilier vie personnelle et professionnelle, pendant que les employeurs se voient obligés, de loin, d’exiger « rigueur et organisation sans faille ».
Il est seulement plus difficile pour l’inspection du travail de prouver et de faire sanctionner les fraudes existantes c’est-à-dire le « faux travail indépendant », le « marchandage » ou « prêt illicite de main d’œuvre ».
Des « sociétés de portage salarial » se chargent, moyennant commission, de gérer et de verser leurs rémunérations aux salariés pseudo « indépendants » : artifice illégal pour contourner les obligations des sociétés d’intérim.
Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre en exercice, rêva tout haut en 2004, de créer « un million d’entreprises nouvelles » ce qui revenait à encourager un million de petits entrepreneurs, « à leur compte », puis « la loi Dutreil », de juillet 2005 a tenté de réveiller les vocations du « travail indépendant » par toutes sortes de facilitations juridiques et fiscales. La présomption de salariat dans les relations de travail, supprimée en 1994, rétablie en 2000, a été, à nouveau, supprimée : il suffit d’être inscrit dans un registre d’immatriculation (commerce, métiers, agents commerciaux, transport routier de personnes ou autres) pour être présumé « non-salarié » du donneur d’ouvrage (articles L.120-3 du CT et L.146-1 du CC).
Une loi n° 2003-721 du 1e août 2003 a créé le contrat d’appui au projet d’entreprise, un dispositif d’exonération des charges sociales temporaires pour les salariés qui créent une autre activité non salariée. Une loi n° 2005-882 du 2 août 2005 a introduit pour les professions libérales, le régime de « collaborateur libéral » qui constitue un statut intermédiaire prétendant se rapprocher par certains aspects de la « para-subordination » (sic). Mais ils n’ont même pas réussi à coordonner correctement les régimes de sécurité sociale entre artisans et salariés : cela ne fonctionne que dans le sens régime général vers travailleurs indépendants et pas en sens inverse ((Le Monde 29/7/07, Michaëla Bobasch : de l’artisanat au salariat, régimes mal harmonisés). En fait, le « statut mixte entre salariat et travail indépendant » c’est dans les rêves !
Les libéraux s’entêtent, car, eux ils comprennent et ils veulent paralyser la montée irrésistible du salariat. Mais il y a loin de la coupe aux lèvres. Il y a ce qu’ils veulent et ce qui est. Rien de significatif ne contrecarre la tendance générale à la montée du salariat. Entre 1990 et 2011, en 20 ans, on est passés de 2 988 000 à 2530 000 « indépendants non salariés ».
Nul doute qu’avec beaucoup de mesures, des ordonnances, il sera possible de freiner la lourde trajectoire mais il ne sera pas facile pour Macron de freiner le grand paquebot du salariat, de le détourner, et encore moins de le diviser en une infinité de petites flottilles.
Salariés, si vous saviez… votre force est réelle
Les 18 millions de salariés du privé sont regroupés en 1,2 million d’entreprises ayant au moins un salarié. La pyramide de ces entreprises est très concentrée.
Mille entreprises font 50 % du Pib et prés de 3,5 millions de salariés. 3 % d’entreprises seulement ont plus de 50 salariés mais font travailler 50 % du total du salariat.
Un million d’entreprises ont moins de 10 salariés, elles emploient 4,2 millions de salariés, mais elles sont atomisées et souffrent. Les entreprises intermédiaires, PME, PMI, ETI, sont sous traitantes à plus de 80 % des mille donneurs d’ordre essentiels.
Ce tableau et ces chiffres donnent sans conteste un salariat puissant numériquement, et encore relativement concentré en dépit de la bataille idéologique du patronat pour le diviser, l’éclater, l’écarteler, casser ses droits communs.
La France compte 11,7 millions d’inactifs en 2016 : avec 27,6 % de taux de non-emploi en équivalent temps plein, elle se situe cependant au-dessus de la moyenne européenne qui est de 29,3 %. Et très au-dessus de la moyenne de la zone euro de 31,6 %. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, la France est en effet légèrement mieux placée que le Royaume Uni – 28 % – et l’Allemagne – 28,4 % – et sa situation en termes de non-emploi est bien meilleure que celle de l’Espagne – 35 % – ou de l’Italie – 37,7 %.
Mais sur 66 millions d’habitants, la France compte 29 millions d’actifs : une fois déduits 6,7 millions de chômeurs toutes catégories confondues, il y a moins de 18 millions d’actifs occupés salariés dans le privé, et 5,5 millions dans le public et para public. Le contrat a durée indéterminé est la norme absolue même si, sous les attaques des libéraux il baisse un peu : 85 % des actifs occupés. Et même entre 29 ans et 54 ans, il existe 95 % de CDI.
Il n’y a que 11 % de CDD, 3,5 % d’intérim, et au total environ 15 à 18 % de contrats précaires (3,4 millions sur 23 millions d’actifs occupés). (Attention aux mauvaises présentations : les libéraux aiment à répéter dans les médias que 85 % des embauches de jeunes se font en CDD, mais il s’agit de « flux » et non de « stocks »). Le chômage touche 24,6 % des actifs de 15 à 24 ans. Ensuite ce sont les « seniors » qui fournissent les rangs des chômeurs ou précaires : à partir de 55 ans, un salarié sur trois est licencié, inapte ou malade.
La part des actifs non salariés c’est à dire des « indépendants » (inclus les VTC, les Deliveroo, etc.) tant valorisés par Macron, le défenseur des « sans statuts » est inférieure à 10 %. La propagande fait croire qu’un tiers des salariés « pensent » devenir travailleurs indépendants, exclusivement ou en alternant période de salariat et de travail indépendant. De prétendues études prétendent que 40% des travailleurs « seront » des free-lances en 2020, (71% des activités réalisées par les free-lances porteraient sur de l’accompagnement d’entreprise, genre conseil, expertise, formation/coaching, commercial, et ça donnerait 15 millions de free-lanceurs. Tous uberisés, ryanisés, numérisés. Mais qui peut croire cela ? Les chiffres réels indiquent des tendances inverses lourdes.
Il y avait 4,5 millions d’employés en 1973, contre plus de 7 millions en 2005. Dans le même temps, le nombre d’ouvriers est passé de 7,7 millions à moins de 6 millions (23 % des actifs). Ce mouvement continue, mais l’employé de chez Mac Do est bien plus mal loti à tous points de vue que l’ouvrier de chez PSA. Ce chassé-croisé ouvrier-employé ne signifie en rien un hypothétique déclin du « prolétariat » qui aurait laissé place à la montée d’une population de « bobos » : c’est ce que voudrait faire croire l’école des Macroniens et leurs fantasmes de start up, mais cela n’a rien à voir avec la réalité. Il reste 2 millions d’ouvriers d’industrie, 4 millions d’ouvriers d’entretien, 4,2 millions d’employés du commerce, 1,4 million de salariés du bâtiment,
Selon les catégories de l’Insee, la somme des deux catégories employés et ouvriers dépasse les 13 millions, soit la majorité écrasante de la population active occupée (près de 24 millions).
En outre, les 6 millions de « professions dites intermédiaires » et des 3,5 millions de « cadres » leur sont assimilables. Sur 3,5 millions de cadres, 99 % sont de « droit commun » comme les autres salariés et ne sont pas du tout des « cadres supérieurs ». Toutes ces catégories ont des salaires qui ont été « compactés » depuis 60 ans : en mai 68 (l’écart des salaires était de 1 à 6, il n’est plus que de 1 à 2,5). 90 % des actifs occupés ont un bulletin de paie, un contrat, des droits relevant du code du travail et des conventions collectives et 98 % d’entre eux gagnent moins de 3200 euros nets. Certes, on ne vit pas de la même façon à 900 euros, 1800 euros, et 3200 euros nets, les salaires ont été bloqués depuis plus de 30 ans, et les salariés ont plus de points communs qu’ils ne le croient ou ne le savent : la part des salaires dans le PIB a baissé de 10 points, ce qui veut dire en France 200 milliards qui manquent à la Sécurité sociale, à la santé, à l’éducation, aux retraites… mais aussi des centaines de milliards à la consommation, donc aux fameux carnet de commande des entreprises.
Salariés, Macron et sa propagande essaient de vous faire croire que vous n’existez pas, que vous n’avez pas de point commun, que vous n’êtes pas la force sociale majoritaire, que ce n’est pas vous qui produisez les richesses, que vous ne pouvez pas vous unifier, que vous n’incarnez pas l’avenir, qu’il ne vous faut pas de code du travail, que votre avenir est le turn over, qu’il faut accepter le licenciement sans motif et le tri a l’embauche……
Contre cela, nous mettons ici, chiffres à l’appui, en évidence les fleuves impétueux qui abreuvent, encore, chaque jour, l’océan du salariat, en dépit des crises et contradictions, qui le traversent.
Comment douter de l’avenir, alors que le siècle qui vient de s’écouler est celui, non pas d’une disparition, mais d’un « tsunami » en faveur du salariat ?
Celui-ci a progressé massivement en France, en Europe, dans tous les pays développés, mais aussi dans le monde entier : dans tous les systèmes de production, des plus avancés aux plus arriérés, en dépit des explosions, des guerres, des famines, des pandémies, de la mondialisation libérale, le salariat a pris ou est en train de prendre la place centrale socialement.
Certes il est délibérément freiné, il est soumis à des catastrophes multiples (par exemple les pandémies ou les pressions accrues des financiers organisant chômage, précarité et retour aux loueurs de bras, obsédés par la baisse du coût du travail) mais il surmonte toutes les périodes de réaction, s’impose à contre courant, progresse là où il est déjà installé.
Là où, au départ, il y avait des esclaves, des travailleurs forcés, des serfs, des « journaliers », des « tacherons » des « travailleurs indépendants », des « professions libérales », des paysans, des artisans, des commerçants, d’innombrables activités informelles, nous avons assisté depuis 150 ans et nous assistons sans relâche à leur remplacement progressif, mais relativement rapide par des producteurs qui ont le statut de salarié.
Ce n’est pas une tendance hésitante, balbutiante, lente, chaotique, c’est une tendance profonde, rapide, continue. L’avenir n’est pas aux « start up » croquignolesques. Jamais le salariat n’a été aussi nombreux, puissant, économiquement, socialement, politiquement, mondialement. Insistons : ce n’est pas une tendance descendante mais ascendante. Elle est particulièrement massive dans les pays développés, mais c’est une tendance internationale, y compris, même si c’est de façon relative et chaotique, dans les pays pauvres.
Et ce, même si sur les 2,8 millions de travailleurs sur cette planète, l’Oit (Organisation internationale du travail, émanation des Nations Unies) estime que 50 % cherchent encore désespérément à vivre avec 2 dollars par jour.
selon l’Oit, même en décomptant le travail forcé (encore 12, 3 millions d’humains esclaves, en recul), le travail des enfants (200 millions environ, en recul), le travail des migrants (86 millions) le chômage massif (185,9 millions de chômeurs en 2003, 26 %, en hausse) le chômage des jeunes (86 millions de jeunes sans emploi, 13,8 % en 2006 au lieu de 11,7 % en 1996, deux fois plus que les adultes), les travailleurs pauvres (550 millions), malgré tout ça, le salariat progresse dans le monde entier,.
Même avec un sous-emploi de masse, un secteur informel considérable, même là où les paysans sont encore majoritaires, c’est le salariat agricole qui augmente. Plus d’un milliard et demi d’humains sont aujourd’hui salariés : une progression fantastique dans une époque où le chômage mondial atteint son niveau le plus élevé de tous les temps (+ 26 % dans les dix dernières années).
« Bien loin de faire disparaître la question du travail, la mondialisation de l’économie de marché lui donne une dimension sans précédent » écrivait Alain Supiot (professeur à la Faculté de droit et des sciences politiques de l’université de Nantes, Revue internationale du travail)
C’est un développement impétueux, inégal et combiné, car l’Oit constate qu’il n’y a que 20 % des salariés qui bénéficient d’une protection sociale décente, et 50 % qui n’en ont pas du tout. L’Oit souligne d’ailleurs qu’il y a, chaque année, parmi les salariés, plus de 2,2 millions de morts par accidents du travail ou maladie professionnelle, soit 6000 morts par jour, 270 millions d’accidents répertoriés et 160 millions de maladies professionnelles, c’est-à-dire plus de victimes que par les guerres ou les accidents de la route.
L’Oit est bien placée pour cerner les aspects chaotiques de ce bond en avant du salariat de masse : créée en 1919, confirmée en 1944, elle regroupe aujourd’hui 185 pays, elle a adopté 180 conventions internationales, et plus de 190 recommandations sur le travail. Non seulement, toutes les études de l’Oit témoignent de cette poussée phénoménale du travail salarié, mais elle est en a déduit sa mission : « accélérer l’accès des hommes et des femmes à un travail décent et productif, dans des conditions de liberté, d’équité, de sécurité, et de dignité. » Ses principales tâches « consistent à promouvoir les droits au travail, encourager le dialogue dans la recherche de solutions aux problèmes du monde du travail ».
L’évolution mondiale du travail :
On ne peut pas, comme Macron, ne pas prendre comme une base solide, tous les travaux de l’Oit qui est la seule institution « tripartite » des Nations Unies, en ce sens que ses politiques et programmes sont élaborés conjointement par des représentants des employeurs et des travailleurs, qu’elle est une organisation mondiale chargée d’élaborer des « normes internationales du travail » et d’en contrôler l’application. (Tout le contraire de l’inversion de la hiérarchie des normes de El Khomri et Macron).
Ainsi l’OIT a-t-elle élaboré en 1999, une « Déclaration relative aux principes et aux droits fondamentaux au travail », qui vise à donner aux salariés, « la possibilité de revendiquer librement et avec des chances égales, leur juste participation aux richesses qu’ils ont contribué à créer, ainsi que de réaliser pleinement leur potentiel humain. »
L’Oit définit même, à partir de la réalité actuelle, un devenir, une notion de « travail décent » pour le salariat : « possibilité d’exercer un travail productif et convenablement rémunéré, assorti de conditions de sécurité sur le lieu de travail, et d’une protection sociale pour sa famille. Le travail décent donne aux individus la possibilité de s’épanouir et de s’insérer dans la société, il leur donne aussi la liberté d’exprimer leurs préoccupations, de se syndiquer, et de prendre part aux décisions qui auront des conséquences sur leur existence. »
Ce, avec une égalité de traitement pour les hommes et les femmes, des négociations collectives, afin d’éliminer progressivement et durablement la pauvreté, par la création d‘emplois décents ce qui est, toujours selon l’Oit, au coeur de toute politique de développement, pour une dimension sociale d’une mondialisation « juste ».
Le salariat est non seulement en croissance impétueuse, mais c’est donc, aussi, un phénomène social et économique planétaire, qui a ses règles, ses organisations indépendantes, ses conventions, ses institutions, un programme, un développement organisé internationalement, un avenir.
Il est difficile de prétendre, au moins à partir de ces signes, qu’il serait aujourd’hui « voué à disparaître » comme la presse de droite (Le Figaro, l’Opinion, ..) derrière Macron, le proclame chaque jour.
Karl Marx, adulte, en 1865, dans « Salaire, prix, profit » écrit : « En même temps, et tout à fait en dehors de l’asservissement général qu’implique le régime du salariat, les ouvriers ne doivent pas s’exagérer le résultat final de cette lutte quotidienne. (…) Ils ne doivent donc pas se laisser absorber exclusivement par les escarmouches inévitables que font naître sans cesse les empiètements ininterrompus du capital ou les variations du marché. Il faut qu’ils comprennent que le régime actuel, avec toutes les misères dont il les accable, engendre en même temps les conditions matérielles et les formes sociales nécessaires pour la transformation économique de la société. Au lieu du mot d’ordre conservateur: « Un salaire équitable pour une journée de travail équitable », ils doivent inscrire sur leur drapeau le mot d’ordre révolutionnaire: « Abolition du salariat ». Oui, un jour cela se produira, quand le salariat sera totalement majoritaire, conscient et en capacité de dépasser le capitalisme.
Mais face à Macron, nous sommes ramenés dans un moment, où la lutte essentielle, jour après jour, est « Augmentez nos salaires ! » « Réduisez la durée du travail ! » « Garantissez notre emploi ! ». Pour créer un jour les conditions de l’émancipation, du dépassement et de l’abolition du salariat, il faut d’abord chaque jour, pas à pas, renforcer le salariat, ses salaires, ses droits, ses statuts. C’est à la fois le chômage de masse et la puissance du patronat et de ses propagandes qu’il faut faire reculer.
En France, les millions de salariés en vendant aux meilleures conditions leur force de travail se sont renforcés mutuellement et rapprochés de leur heure, celle de leur pouvoir. Les réformes qu’ils ont arrachées depuis 1945 ne s’opposent pas à la révolution mais la nourrisse. Mieux ils les défendent plus ils étendent le salariat, plus « ils engendrent en même temps les conditions matérielles et les formes nécessaires pour la transformation économique de la société. »
Par contre quand ils subissent des contre-révolutions, quand des Macron gagnent, quand le salaire stagne, quand il recule, quand le statut des salariés est cassé, quand ils sont ramenées aux loueurs de bras, VTC, ubérisés, il n’y aura ni victoire ni émancipation sociale.
Les salariés ne vivent pas de la possession de moyens de production ni de rentes ni d’actions. Ils n’investissent dans des instruments de travail. Ils louent par contrat leurs qualifications, leurs capacités de travail manuelles, intellectuelles, et, en échange de leur production, généralement selon des horaires établis, ils reçoivent un salaire : dans tout ce processus, ils sont dépendants juridiquement de leurs employeurs, entrepreneurs ou actionnaires, avec des contreparties contractuelles, individuelles et collectives, négociées ou légales.
L’économie libérale mondialisée, même la plus haïssable, égoïste, brutale celle qui fait que les trois hommes les plus riches possèdent davantage que 48 pays les plus pauvres, nourrit en son sein ce puissant salariat qui va la détruire. L’état de droit s’installe implacablement dans le travail, dans l’entreprise. C’est un appui, c’est une arme.
Le salarié a un statut, un code, des conventions. Ce qui caractérise son contrat est un « lien de subordination ». C’est l’employeur qui décide de la naissance du contrat, de la gestion du contrat, de la fin du contrat, unilatéralement. Il n’y a pas égalité entre les deux parties dans la relation contractuelle. Il est important que ce soit clair. Il n’y a pas de citoyenneté, ni de démocratie dans l’entreprise. En l’échange de l’acceptation du « lien de subordination » et à l’occasion de l’activité productive qui en découle, il y a un salaire négocié et des contre parties sous forme de « droit du travail ».
Contrairement à tous ceux qui s’ingénient à compliquer la définition du salariat, ces trois critères, contrat, subordination, salaire, sont des variables essentielles et suffisantes : elles couvrent tout le champ du salariat.
Certaines études se complaisent à évoquer la « dématérialisation de l’entreprise », l’entreprise sans entreprise, le salarié partenaire, le salarié associé aux risques employeurs, le salarié co-gestionnaire de sa propre sécurité, la subordination active, le salarié associé à la gestion de son emploi, etc. Le Medef pousse à appeler les salariés des « collaborateurs », il veut remplacer la « subordination » par la « soumission librement consentie » (« compliance without pressure ») et ce afin de supprimer les droits qu’ils ont acquis jusque là en contre partie.
Tout cela est de la poudre idéologique aux yeux, pour masquer le rapport simple d’exploitation, rogner le paiement du meilleur salaire possible. Tout salarié à un travail intellectuel ou manuel bien matérialisé, des tâches, des objectifs, et il doit s’y soumettre et permettre à son employeur d’en retirer profit : sinon il n’est plus salarié.
Le contrat peut n’être pas écrit, il n’en existe pas moins, il est synallagmatique. Seuls les contrats « atypiques » (CDD, temps partiels, intérim, « aidé » etc.) doivent obligatoirement être écrits. Et tout contrat qui n’est pas écrit, est réputé être la norme, soit un CDI à temps plein. Principes auxquels les ordonnances Macron, après la loi El Khomri, s’attaquent fondamentalement.
« A l’occasion du travail subordonné, les employeurs sont contraints de reconnaître le temps aliéné et le temps libre des travailleurs par de la monnaie distribuée selon un tarif fondé sur l’attribution politique d’une qualification » écrivait très tôt Bernard Friot (Maître de conférences en économie en septembre 2000 pour la Revue Française des Affaires Sociales, n° 3-2000).
Des origines à nos jours, les conditions d’attribution de cette part salariée du travail est l’enjeu décisif : selon le temps de travail réel, selon les quantités de travail effectuées, selon la quantité et la qualité du travail et du salarié, selon les lieux de travail, selon l’ancienneté, selon le contexte social, selon le contexte économique, selon les variations de la plus value réalisées, selon les négociations individuelles ou collectives, selon la loi, des critères différents de niveau et de paiement des salaires ont été fixés, exprimant fondamentalement un rapport de forces entre salariés et employeurs.
Ce salaire est même clairement décomposé en France, en deux parts essentielles : une part indirecte, brute, et une part directe, nette. Le salaire brut étant l’essentiel puisque c’est lui qui englobe le salaire net.
Le salaire net correspond à l’acte productif. Le salaire brut correspond à tout ce qui a permis, permet, permettra l’acte productif.
Ces salaires bruts et nets sont l’élément essentiel du contrat de travail.
Ils ont été institutionnalisés de façon extrêmement codifiée.
Bernard Friot esquissait ainsi le devenir possible du salaire si les salariés sont assez forts pour gagner :
« D’une part, le salaire paie non seulement le temps aliéné mais aussi le temps libéré. L’entrée des retraités dans la logique du salaire peut être délibérément étendue aux chômeurs, à qui leur salaire doit être maintenu en cas de démission comme de licenciement. Elle doit être étendue aux jeunes, à qui du salaire doit être distribué à compter de leur majorité par exemple, selon un forfait jusqu’à ce qu’ils aient leur premier emploi.
D’autre part, le salaire versé au travailleur et à la sécurité sociale au titre de chaque emploi est inaliénable, tandis qu’il reconnaît un temps de travail subordonné décroissant (ramené progressivement par exemple à 20 heures par semaine) et un temps libéré pour le travail libre croissant. » (Pour la Revue Française des Affaires Sociales, n° 3-2000
La mort du salaire brut ?
Macron prépare la plus terrible attaque contre nos salaires de toute l’histoire de notre pays. Du jamais vu. Il va supprimer le salaire brut.
Car ce n’est pas le salaire net en bas de la feuille de paie qui compte le plus. C’est le salaire brut qui compte ! Il faut le réexpliquer à nos concitoyens car le pouvoir cherche à supprimer les feuilles de paie papier et à les « simplifier » pour ne pas qu’on voit la manœuvre.
Le salaire net c’est pour payer la force de travail. Le salaire brut c’est pour payer la reproduction de la force de travail.
Le salaire net on vit avec au mois le mois. Le salaire brut on vit avec tout au long de la vie.
Le salaire net permet de consommer et de vivre quotidiennement.
Le salaire brut permet de faire face à tous les aléas de la vie, quand vous avez besoin de logement, quand vous êtes en charge de famille, quand vous êtes malades, quand vous avez un accident du travail ou une maladie professionnelle, quand vous êtes au chômage, et quand vous êtes en retraite.
Le salaire brut ce n’est pas une « charge » comme ils le disent, c’est un bonheur. C’est une partie du salaire mutualisée, pré affectée et redistribuée à chacun selon ses besoins, c’est ce qu’il y a de plus beau dans notre pays.
Le salaire brut est redonné en « temps différé » en cas de maladie, en « temps indirect » pour le logement, mais aussi en « temps réel » pour la retraite (car dans ce cas il va en direct, de ceux qui travaillent à ceux qui sont en retraite, la retraite par répartition n’est pas une épargne !).
C’est le capital, l’actionnaire, l’employeur qui paient ainsi à la source la protection sociale, le salaire brut, chaque mois, en même temps que le salaire.
Sous Hollande, Macron a déjà supprimé les cotisations familiales, il a baissé les cotisations parfois jusqu’à 1,6 ou 1,9 fois le smic. Là, il supprime et remplace tout par l’impôt.
Les spécialistes y verront le passage pour l’essentiel d’un système dit « Bismarckien » (la protection sociale payée par les employeurs à la source avec le salaire) au système de Lord Beveridge, britannique, basé sur l’impôt. Ca fait longtemps que le Medef en rêve pour baisser le coût du travail.
Chacun paiera l’impôt dorénavant à la place de son patron. Un hold up de 470 milliards, cadeau géant de 470 milliards pour le Medef. Pour tenter de masquer ça, ils vont augmenter de quelques euros votre salaire net mais baisser de centaines d’euros votre salaire brut. Ils baissent le haut de la feuille de paie en faisant croire qu’ils augmentent le bas de celle-ci. C’est un coup de bonneteau.
Et c’est pourquoi Macron diffère le prélèvement de l’impôt à la source prévu (par ses services quand il était ministre !) fin janvier 2018, purement pour manipuler, cacher cette énorme arnaque. Il le reporte en 2019 au moment ou il remplacera aussi le système de retraite de répartition par un système à « points ».
Nous y opposons, le versement inclus dans tous les revenus d’activité, du salaire brut, des éléments pré-affectés de la protection sociale, le retour à la gestion séparée, démocratique, des syndicats des salariés.
Le salaire est « net » et brut » jusque là, il ne pouvait être diminué, modifié contre la loi et le gré du salarié.
Pouvoir le faire varier au gré de l’employeur, c’est devenu un objectif des lois Fillon du 4 mai 2004, de la loi Warsmann du 22 mars 2012, puis des lois Sapin, El Khomri et Macron que de permettre aux employeurs unilatéralement de baisser les horaires et d’augmenter les durées du travail.
Jusque là, les sanctions pécuniaires, retenues sur salaires, étaient interdites. Le salarié était créancier super privilégié en cas de faillite de l’entreprise. Il existait une assurance garantie pour le salaire. Le salaire était mensualisé (actuellement à 151 h 66 pour 35 h hebdomadaires) et selon la loi du 19 janvier 1978, il devait être identique chaque mois et versé à date fixe, avec un bulletin de paie, comportant des mentions obligatoires, rendant lisibles tous les éléments de calcul dudit salaire, notamment les cotisations sociales.
Chaque catégorie d‘heures supplémentaires devait figurer sur une ligne distincte du bulletin de paie avec sa majoration correspondante. Le fait de ne pas remettre de bulletin de paie, de l’établir avec des omissions, ou des mentions inexactes était pénalement sanctionné d’une amende de 450 euros applicable autant de fois qu’il y avait irrégularité. Les prescriptions pour réclamer un salaire étaient de 5 ans et dans certains cas trentenaires. Il existait un salaire minimum interprofessionnel de croissance, et des minima conventionnels s’appliquaient, le principe « à travail égal, salaire égal » devait être respecté, et toute discrimination était considérée comme nulle, ses auteurs étant passible de sanctions pénales pouvant atteindre 45 000 euros d’amende et 3 ans de prison.
Au travers du salaire, l’employeur ne fait aucun « cadeau », aucun « don », il paie seulement l’équivalent d’une partie de la valeur de la production totale effectuée par le travailleur. Ce n’est pas lui qui « donne du travail », il en achète, fait une marge et revend. Dans la réalité, l’employeur ne verse ni salaire brut, ni cotisations sociales, ni salaire net, direct, puisqu’il récupère tout, au moment de la vente, lorsqu’il réalise sa « plus-value ». Dans la vraie vie, tous les éléments de salaire sont inférieurs à ce que l’employeur tire du travail de son salarié. S’il n’en était pas ainsi, l’employeur n’aurait aucun intérêt à embaucher un ou des salariés, il n’y aurait pas d’entreprise.
C’est bon de le redire face aux maniaques de « l’entreprise » qui veulent ré imposer des salaires variables : « Il y a assez de blé, je te paie ça, il n’y a pas assez de blé, je te paie moins »…
Il se trouve que le salarié n’est pas tenu à une « obligation de résultat ».
Le « risque » d’un travail non conforme à l’attente de l’employeur doit être assumé par celui-ci. L’employeur est, pour cela, investi d’un pouvoir de direction, organisationnel et disciplinaire. La subordination, c’est l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui donne des ordres et des directives, contrôle leur exécution, sanctionne les manquements éventuels.
C’est le salarié subordonné qui vend, dans cet échange contractuel, une part de son travail au patron. Et c’est dans la valeur de la production effectuée, avec une partie de travail gratuit que l’employeur réalise les bénéfices. Une fois que, par la vente, le patron a récupéré ses investissements, ses frais et salaires bruts et nets, il lui reste le profit, en quelque sorte, son « salaire » à lui. Il a donc intérêt à payer le salaire le moins cher possible. Tout le reste, sur la générosité prétendue des entreprises, est billevesée.
Un libéral de l’institut Montaigne expliquait qu’il était normal « qu’un grand employeur touche de gros appointements « puisqu’il « faisait vivre 50 000 salariés ». La vérité est pourtant que ce sont « 50 000 salariés qui font vivre cet employeur » et c’est de leur activité qu’il tire ses gros appointements.
L’extraction et la réalisation de la plus value ne s’effectuent pas entreprise par entreprise, mais le système fait qu’elle est soumise à l’ensemble du marché. Et le mécanisme global du capitalisme pousse, non pas à la simple recherche du profit, mais à celle du « profit maximum ». La « concurrence libre et non faussée », la jungle du marché exigent que chaque employeur recherche le maximum de profits, il ne peut se contenter d’un minimum sous peine de disparaître devant d’autres concurrents.
Pour encadrer, normaliser les rapports de force, une codification considérable a été, progressivement, élaborée en un siècle, définissant un droit du travail, permettant de mieux vendre la force de travail, de négocier la part de travail gratuit, pour l’ensemble du salariat. « Je prétends qu’une feuille de paie est le plus sûr garant de la paix, de la paix sociale comme de la paix entre les peuples », s’écriait encore Christine Lagarde, ministre de l’économie, à l’Assemblée nationale en juillet 2007 alors même que sa politique concrète tendait à diminuer le nombre de porteurs d’une feuille de paie.
Cet ensemble de lois du travail n’aurait jamais été développé à ce point jusqu’à aujourd’hui si la tendance était à ce que le salariat soit « voué à disparaître ».
Au contraire, on est passés, en France, de moins de 3 millions de salariés vers 1900 à près de 16 millions de salariés en l’an 2000. En même temps, on est passé de 3 lois fondamentales et de 80 décrets, essentiellement sur la durée du travail, à plus de 400 lois et 8000 décrets touchant à toutes les questions du travail salarié.
Le développement du statut juridique a accompagné spectaculairement l’extension de l’activité salariale. Cela ne s’est pas fait de façon linéaire, encore moins automatique, ce fut le fruit de luttes, de grèves, de conflits et d’explosions de toutes sortes, des rapports de forces et des politiques différentes.
Ce n’est pas seulement le nombre de salariés qui a augmenté mais – bien plus significativement - la proportion de salariés dans la population active occupée : même au cours de ces dernières années qui sont celles d’attaques libérales contre le salariat (Fillon, Chirac, Sarkozy, Hollande-Valls-Macron), celui-ci continue d’augmenter.
Ce n’est donc pas une disparition, c’est une croissance vertigineuse.
Il y avait en 1983, 17 735 000 salariés sur une population active occupée de 21 379 000. En 2005, à peine plus de 20 ans après, et en dépit du chômage de masse et de la précarité croissante, des attaques multiples dont nous parlerons plus loin, il y avait 22 202 000 salariés sur une population active occupée de 24 921 000.
La puissance du salariat.
Au travers de cette extension continue, c’est la quasi-totalité de l’activité productrice du pays qui est concernée. La place des salariés par rapport aux autres catégories comme la paysannerie, ou les « travailleurs indépendants » déterminaient encore il y a 40 ans une forme relativement importante d’intérêts et de consciences spécifiques et différentes : on évoquait même des « alliances» sociales entre couches distinctes de la population active.
Aujourd’hui, pourquoi parlerait-on de « front de classe » ? Il n’y a plus qu’une classe.
Pourquoi parler dans tous les sens, et souvent à tort et à travers, de « couches moyennes et populaires » ? Il n’y a objectivement qu’un « haut, un milieu, un bas » du même salariat. Reste à le faire comprendre subjectivement.
De 93 % à 90 % des actifs occupés sont dépendants du « moule » salarial, c’est-à-dire de la relation de travail légale et conventionnelle qui l’accompagne. Mais aussi les jeunes, les chômeurs et les retraités.
- Les jeunes sont des « salariés en formation » : par l’école et l’université, c’est autant d’apport de la nation à la future productivité des entreprises. Que les employeurs se plaignent que la main d’œuvre ainsi préparée ne soit pas assez spécialisée ni docile, ne change pas ce fait. La République les forme ainsi.
- Les chômeurs sont des salariés temporairement privés d’emploi. Les chômeurs ne sont pas des « assistés » contrairement à ce que d’indécentes campagnes voudraient faire accroire : ce sont des salariés qui ont cotisé, à une assurance volontaire, et qui, licencié contre leur gré, reçoivent leur dû (et non une aumône). Cette assurance, ils l’ont payée sur leurs salaires. C’est des « ayants droits » et non des secourables, dépendants ou paresseux.
- Les retraités dépendent en direct au jour le jour, au mois le mois, d’une part soustraite des salaires de ceux qui sont en activité. Le fondement du bonheur des retraités, c’est qu’ils vivent la nouveauté inouïe d’être payé pour être libres.
« La possibilité de dépassement de la force de travail est exprimée dans la pension de retraite (Bernard Friot 1999). Ils sont payés : ils ne touchent pas une allocation publique au titre de la solidarité nationale envers les “ personnes âgées ”, mais du salaire au titre d’un contrat entre employeurs et salariés. Comme les salaires directs, les pensions sont financées par des cotisations versées pas les employeurs à l’occasion des emplois. Proportionnelles à ces salaires directs, les cotisations sont immédiatement dépensées et non pas accumulées dans des fonds d’épargne. Elles ouvrent droit à des pensions proportionnelles aux salaires directs et référées comme eux à la qualification ». (Bernard Friot, Pour la Revue Française des Affaires Sociales, n° 3-2000)
A l’occasion du « travail subordonné », la protection sociale est née et a grandi, liée aux salaires par les luttes et conflits, tout au long du 20° siècle.
Citons encore Bernard Friot, dont les travaux (« Puissance du salariat, 1999, édition La dispute * Et la cotisation sociale créera l’emploi, 1999, édition La dispute * La construction sociale de l’emploi en France, des années soixante à aujourd’hui, édition L’Harmattan»), sont sous-estimés : « La socialisation du salaire telle qu’elle se construit au cours du siècle en Europe continentale, c’est le double mouvement, indissociable, d’inscription des salaires directs dans le barème d’une grille établie selon la qualification (du poste ou de la personne, selon que l’on est dans le privé ou la fonction publique) d’une part, et d’autre part de partage du salaire total en deux parties, dont la seconde, en croissance relative, va au pot commun et peut être qualifiée de salaire indirect. » (ibidem)
Evidemment, dans un premier temps, le patronat a été contraint, selon les rapports de force, de céder aux revendications salariales et de lier le salaire direct au salaire indirect, socialisé.
Est-ce surprenant s’il n’a cessé, chaque fois qu’il le pouvait, de freiner l’un et l’autre, bloquant le salaire direct, et attaquant le principe et le niveau du salaire indirect ? « Il n’y a rien de honteux, pour quelqu’un qui travaille, à vouloir gagner davantage d’argent. Cessons d’être aussi pudique sur notre intérêt personnel, qui, bien souvent, rejoint celui du groupe. » affirmait Christine Lagarde (Assemblée nationale, juillet 07). Lorsque le « groupe » patronal veut gagner plus d’argent et que les salariés défendent leurs salaires, cela s’appelle la lutte des classes. Même si Madame Lagarde rajoute : « La lutte des classes est bien sur, une idée essentielle mais, de mon point de vue, essentielle pour les manuels d’histoire. Il faudra certainement, un jour, en étudier les aspects positifs, mais elle n’est aujourd’hui d’aucune utilité pour comprendre notre société ». (sic).
Donc, la guerre principale : celle des salaires :
Le patronat veut donc, depuis longtemps, en revenir au seul salaire net.
« On vous les donne, M. Filoche, on vous les donne vos cotisations sociales, faites en ce que vous voulez, on ne s’en occupe plus, on arrête avec cela, débrouillez-vous, gérez-les, assurez vous » s’écriait dans un grand cri du cœur, Denis Gauthier-Sauvaignac, principal dirigeant de l’UIMM (« Union des industries métallurgiques et minières » et pris la main dans le sac, depuis, d’une caisse noire du patronat égale à 600 millions d’euros. Cf. « La caisse noire du patronat, Ed Gawsewitch, 2008), dans un débat avec l’auteur, en plein forum de la fête de l’Humanité en 2005. Ne plus payer que le strict « acte productif » tel était son rêve (comme celui des esclavagistes espérant y gagner en libérant leurs esclaves pour en faire des salariés, dans le film Queimada, de Gilles Pontecorvo avec Marlon Brando)
Depuis trente ans, les salaires ont perdu 10 points par rapport aux profits. Et depuis 15 ans la politique de blocage des salaires a amené à les compacter. Bien sur cela n’a aucun effet sur le chômage, ce n’et pas le cout du travail qui est trop élevé, mais le cout du capital qui est trop cher.
Tous les jours, dans tous les médias libéraux, ils s’acharnent à « bourrer les cranes » et à faire croire que les salaires sont trop élevés. Il est facile de prouver depuis 15 ans que c’est faux.
Les salaires nets annuels moyens par sexe et catégories socioprofessionnelles en 2000 étaient déjà plus resserrés que trente ans auparavant (les ouvriers sont passés devant les employés) :
36 340 euros pour les cadres,
21 190 pour les « professions intermédiaires »,
14 960 pour les ouvriers,
14 850 pour les employés,
La moyenne de l’ensemble étant 20 440 euros. (Insee, TEF, 2002-2003, salariés à temps complet, hors apprentis et stagiaires).
En 2000, le salaire mensuel médian brut était de 1 377 euros soit 1 428 euros pour les hommes et 1 292 euros pour les femmes.
Le salaire mensuel brut moyen à temps complet dans les entreprises de plus de 10 salariés était de 2 180 euros tandis que le salaire net moyen est de 1 700 euros.
Un cadre a un salaire net moyen de 3 280 euros par mois un ouvrier a un salaire net moyen de 1 250 net proche d’un employé : ainsi un cadre gagne en moyenne 2,6 à 2,7 fois plus qu’un ouvrier ou un employé.
Le rapport entre les 10 % qui gagnent 868 euro nets par mois et les 10 % qui gagnent 2 688 euro nets est inchangé (égal à 3,1 c’est-à-dire 3,3 chez les hommes, 2,7 chez les femmes) »
La tendance existe depuis 15 ans : Le Monde (du 24 février 2006) publiait un rapport de l’Observatoire national de la pauvreté : en 2003, 3 694 000 personnes vivaient en dessous du seuil de pauvreté avec moins de 50 % du revenu médian – soit 645 euro par mois pour une personne seule. C’est-à-dire 260 000 personnes de plus qu’en 2002. Si l’on prend le seuil retenu dans l’Union européenne – 60 % du revenu médian, soit 774 euro par mois – le chiffre est encore plus accablant avec 7 015 000 pauvres !
Selon une autre étude de l’Insee du 11 juillet 2007, le salaire médian était passé de 1484 euros en 2004 à 1528 euros en 2005 pour un temps complet.
En rajoutant 17 % de salariés à temps partiels, il est beaucoup plus bas, sans doute proche de 1250 euros. Le salaire médian, cela veut dire que 50 % gagnent moins et 50 % gagnent plus. Il se différencie du salaire moyen qui est la moyenne de l’ensemble des salaires soit 1.904 euros net par mois en 2005.
En 2007, seulement 10 % des salaires sont en dessus de 3029 euros, les 10 % les moins bien payés à temps complet ne touchent 1.042 euros net par mois en 2005.
L’écart salarial entre hommes et femmes s’est pour sa part légèrement réduit, une salariée à temps complet gagnant en moyenne 18,9 % de moins qu’un collègue masculin contre 19,4% en 2004. (Même raisonnement : 85 % des temps partiels sont des femmes, donc en réalité, l’écart est plus important, autour de 23 %).
Le nombre de « Smicards » s’est étendu, passant de 8 % des salariés en 1994, à 15,6 % en 2004, 14 % en 2002 et 16, 8 % au 1er juillet 2004 soit 2,54 millions de salariés, Quatre Smicards sur dix sont employés à temps partiel, et 80 % d’entre eux sont des femmes. Fortement représentés dans les services aux particuliers (40 %), les services opérationnels aux entreprises (31 %), le commerce (24 %) ou l’industrie agroalimentaire (24 %), les smicards sont très présents (12, 1 %) dans les entreprises de moins de 10 salariés.
La DARES constatait en 2006 que, depuis 2003, la hausse du nombre des Smicards avait été de 9,1 % dans les entreprises de plus de 10 salariés, que leur nombre a même doublé dans les entreprises de plus de 250 salariés, et qu’ils sont tout de même 7,8 % dans celles de plus de 500 salariés.
On ne vit pas évidemment pas de la même façon avec 3000 euros, 2000 euros, 1000 euros. Il y a « 7 millions de travailleurs pauvres » en 2006, 2,5 millions de smicards, 3,7 millions de temps partiels, 4 millions de chômeurs et exclus.
Au bas du salariat, la pauvreté s’est nettement réinstallée, de retour depuis vingt ans, après avoir fortement reculé.
Selon Jacques Rigaudiat, (in « Le nouvel ordre prolétaire », le modèle social français face à l’insécurité économique, Ed. Autrement, mars 2007) il y aurait eu en 2004, 3,6 millions de personnes en dessous de 657 euros par mois, (la moitié des ressources médianes), il y aurait prés de 1,2 million de foyers allocataires du Rmi, soit plus de 2 millions de personnes concernées, 1,5 million de bénéficiaires de la seule CMU, les restaurants du cœur distribueraient 67 millions de repas aujourd’hui (contre 8,5 millions en 1985).
Toujours selon Jacques Rigaudiat, (lequel trouve aussi ses sources in « Les working poors, version française » de Margaret Maruani, Droit social, mars 2003) « 15 % des salariés touchent le salaire minimum, 15 % une rémunération comprise entre le Smic et 1,3 fois le Smic, 45 %, soit 8,5 millions perçoivent de 1,3 à 2 Smic soit entre 1600 et 2400 euros par mois. «
On a là une « photo » globale du « grand corps social », du salariat de bas en haut, en 2007, d’une population active de 27 millions de personnes dont 24 millions dits « occupés ».
On ne vit pas non plus de la même façon, la situation de « salarié » dans le million d’entreprises de moins de 10 salariés (3,4 millions de travailleurs) et dans les mille entreprises de plus de mille salariés (3,4 millions de travailleurs également). On a déjà souligné que la pyramide d’entreprises avait une base très large : en haut, mille entreprises produisent près de 50 % du Pib, en bas, un million d’entreprises ont une existence précaire et la moitié d’entre elles dépendent d’un seul donneur d’ordre.
Dix ans après, en 2017, le salaire net médian mesuré en équivalent temps plein par l’Insee est à 1.797 euros par mois (selon les dernières statistiques disponibles 2015, contre 1.783 euros en 2014), dont 1.650 euros pour les femmes et 1.906 euros pour les hommes, hors salaire des apprentis et des stagiaires. Si l’on introduit tous les salaires, la médiane descend à 1680 euros.
Le salaire médian net est inférieur de 20,1 % au salaire moyen net des prélèvements à la source (CSG, CRDS notamment) qui se monte à 2.250 euros toujours selon l’Insee, contrats aidés compris, dont 1.986 euros pour les femmes et 2.438 euros pour les hommes. En excluant les emplois aidés, le salaire net se monte à 2.277 euros mensuels.
Classées selon la catégorie socioprofessionnelle, les rémunérations nettes atteignent les montants suivants (Insee, salaires 2015, Ces statistiques portent sur les salariés du privé et des entreprises publiques) :
- Cadres et chefs d’entreprise salariés : 4.141 euros mensuels
- Professions « intermédiaires : 2.271 euros mensuels
- Ouvriers : 1.717 euros mensuels
- Employés : 1.637 euros mensuels
En 2014, le salaire net annuel moyen est de 26 327 euros (contre 20 440 en 2000), et le salaire brut mensuel moyen est de 2 957 euros.
Seul le salaire net annuel des chefs d’entreprise s’est envolé, à 68 830 euros en moyenne,
Celui des cadres stagne à 48 373 euros (contre 36 340 en 2000),
Celui des employés est de 19 667 euros (contre 14 960 en 2000),
Il s’agit encore d’un tassement.
Depuis 1995, ce sont les chefs d’entreprise qui affichent la plus forte hausse, avec un salaire net annuel moyen qui a bondi de 86 %, tandis que celui des employés n’a augmenté que de 42,1 % suivis des apprentis et stagiaires (+56,8 %) et des ouvriers (+49,9 %).
Ces trois catégories sont les seules à enregistrer une progression du salaire net annuel moyen supérieure à celle de l’ensemble des salariés (+ 46,8 % depuis 1995). La croissance la plus modérée est celle des cadres et professions intellectuelles supérieures ainsi que des professions intermédiaires, avec +33,3 % sur la période, autre signe de tassement.
En 2014, le salaire net annuel moyen des hommes reste plus élevé que celui-des femmes, à 28 457 euros contre 23 280 euros, soit une différence de 5 177 euros. Qui dit augmentation du salaire net annuel moyen ne dit pas forcément augmentation du pouvoir d’achat des salariés. Il faut en effet tenir compte du taux d’inflation lequel n’est pas très loin derrière les salaires.
C’est le salaire « médian » et non le salaire « moyen » qui est important.
En 2014, le salaire net annuel médian en équivalent temps plein s’élève à 21 147 euros, soit 0,6% de plus qu’en 2013. C’est la plus faible progression enregistrée depuis 1995, date des premiers chiffres disponibles. Le salaire médian est de 1680 euros par an, et se tasse lui aussi.
En plus de la catégorie socio-professionnelle et du sexe, il est confirmé que la dispersion du salaire moyen en France diffère selon la taille des entreprises : plus l’entreprise est grande, plus les salaires sont élevés (d’où l’intérêt des externalisations, des sous-traitances pour les 1000 donneurs d’ordre principaux). Dans le million de petites entreprises qui comptent moins de 10 salariés, la rémunération brute moyenne plafonne à 2 403 euros par mois en 2014 alors que, dans les entreprises de plus de 500 salariés, elle culmine à 3 336 euros. Même constat du côté du salaire net des Français qui, selon la dimension de l’entreprise, oscille entre 1 833 euros et 2 495 euros bruts par mois.
Salaire net annuel moyen par décile :
Suivre l’évolution du rapport entre le 9e décile du salaire net annuel en équivalent temps plein et le 1er décile permet de savoir si l’écart de niveau de salaires se creuse entre les 10% de salariés qui gagnent le plus et les 10% de salariés qui gagnent le moins. En 2014, ce ratio augmente pour la première fois depuis 2011 (+0,03 point). Sur le long terme, la tendance est toutefois à la réduction de ce fossé : en 2014, les 10% de salariés les mieux payés touchent 42 860 euros net par an en moyenne, c’est-à-dire 3,04 fois plus que le premier décile. En 1995, l’écart était de 3,12, avec un salaire net annuel moyen de 29 086 pour le 9e décile contre 9 319 pour le 1er décile.
Quelque soit le tableau de l’INSEE choisi et les méthodes de comparaison, par catégories professionnelles, par entreprises, en relation avec l’inflation, on assiste un tassement des salaires, exceptés de ceux des chefs d’entreprise.
On ne peut pas vivre décemment avec un Smic en 2016, à 1150 euros net et 1466,62 euros brut. Une étude de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale (ONPES) pour évaluer les «budgets de référence», nécessaires pour «une participation effective à la vie sociale» s’est inscrite dans une réflexion menée au niveau européen, visant à déterminer «un revenu minimum décent».
L’ONPES a d’abord déterminé les paniers de biens et services relevant d’un besoin minimum: disposer d’une chambre pour chaque enfant de sexe différent et de plus de 6 ans, d’une chambre d’amis pour les retraités. Avoir une voiture d’occasion, pouvoir partir en vacances (deux semaines par an pour les actifs avec enfants, une semaine pour les retraités et les actifs sans enfant), pouvoir pratiquer des activités culturelles et sportives, inviter des amis, offrir des cadeaux. Alimentation, habillement, soins et hygiène corporelle ont également été pris en compte. Les budgets nécessaires à une vie décente, pour un ménage logé dans le parc social, ont ainsi été établis entre 1.424 euros pour une personne active seule (1.571 euros dans un logement du parc privé), et 3.284 euros pour un couple avec deux enfants (3.515 dans le privé). Le budget nécessaire pour les familles monoparentales avec deux enfants est de 2.599 euros dans un logement social (2.830 dans le privé). Les budgets de référence des retraités en couple sont de 2.187 euros (2.437 dans le privé), ceux des couples d’actifs sans enfant de 1.985 euros (2.133 dans le privé).
Ces budgets ont permis de déterminer la part des ménages qui sont en situation financière tendue. Ainsi, les familles monoparentales sont soit pauvres (55 %), soit disposent de moyens insuffisants pour vivre décemment (40 %). 14% des retraités seuls sont pauvres, 45 % en risque de restrictions. Seuls 12 % des couples d’actifs sans enfant sont dans cette situation (5 % sous le seuil de pauvreté, 7 % amenés à renoncer à certains biens et services jugés nécessaires pour vivre décemment). Il s’agit de la catégorie la moins en difficulté. 12 % des couples avec deux enfants vivent sous le seuil de pauvreté, 24 % doivent s’imposer des restrictions. Le seuil de pauvreté se situe à 60 % du niveau de vie médian (987 euros par mois), il concerne environ 8 millions de personnes.
Des millions de familles mangent des pâtes à partir du 10 du mois. Elles sont à découvert en permanence et sous menace vitale du banquier qui prend des agios disproportionnés. Elles ne peuvent vivre normalement : 40 % ne prennent pas de vacances. Impossible d’avoir accès au loisir et à la culture. Elles travaillent mais ne peuvent vivre de leur travail. Prés de 10 % des logements sont insalubres. Le nombre de SDF a augmenté de 50 % entre 2001 et 2014 et parmi eux, il y a des travailleurs pauvres. Le transport est une charge terriblement coûteuse. Il reste à voir, à la télévision, s’étaler les richesses des autres. Car les immenses richesses des 1 % y brillent de tous leurs feux devant les yeux miroitants des 99 %.
Les salaires, c’est une question française, pas européenne ni mondiale :
La Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) du ministère du Travail, publie une étude sur les salaires bruts et nets par secteur et par branche professionnelle en équivalent-temps plein (ETP). Extraits en janvier 2017 sur les rémunérations en 2014 :
> Boulangerie-pâtisserie artisanale :
- salaire brut mensuel : 1.923 euros
- salaire net mensuel : 1.445 euros
> Métallurgie et sidérurgie :
- salaire brut mensuel : 3.725 euros (dont métallurgie en Ile-de-France : 3.412 euros)
- salaire net mensuel : 2.778 euros (dont métallurgie en Ile-de-France : 2.525 euros)
> Banque :
- salaire brut mensuel : 5.158 euros
- salaire net mensuel : 3.669 euros
> Secteur sanitaire et social :
- salaire brut mensuel : 2.328 euros
- salaire net mensuel : 1.755 euros
> Immobilier :
- salaire brut mensuel : 3.279 euros
- salaire net mensuel : 2.481 euros
> Cabinets d’experts comptables
- salaire brut mensuel : 3.436 euros
- salaire net mensuel : 2.578 euros
> Hôtels cafés restaurants
- salaire brut mensuel : 2.168 euros
- salaire net mensuel : 1.651 euros
> Transport routier :
- salaire brut mensuel : 2.507 euros
- salaire net mensuel : 1.880 euros
Contrairement à un cliché répandu, ces niveaux de salaires ne sont pas liés à la « mondialisation » ni à l’Union européenne. Les salaires ont baissé et ce n’est pas eux qui freinent la compétitivité ! Ce qui coute le plus cher, ce ne sont pas les salaires, c’est le coût du capital et des marges qu’il exige. Le niveau de ces salaires s’apprécie encore moins à la nouvelle ou l’ancienne économie, mais ils dépendent bel et bien aux rapports de forces sociaux et syndicaux, internes à notre pays.
Ce n’est pas l’Union Européenne ni la mondialisation qui expliquent ce qui se passe dans une des plus grandes branches, la restauration. Car c’est bien là qu’il y a les durées du travail les plus longues, les salaires les plus bas, le turn over le plus important, les maladies professionnelles les plus nombreuses, la convention collective la plus faible, les contrats les plus flexibles, la précarité la plus fréquente, le travail dissimulé le plus important, la fraude la plus intense, et pourtant ni les 850 000 salariés ni les usagers, n’en ont profité, ni en salaires, ni en emplois, ni en conditions de travail, lorsque la TVA fut abaissée pendant cinq ans à 5,5%. C’est le patronat et l’inaction de l’état qui sont en cause.
Doit-on parler de la grande distribution, un secteur aux profits prodigieux, qui supprime des emplois, et précarise les employés, des sous traitants, des producteurs, et reçoit des aides du CICE, alors que ses « marges » sont infinies ?
C’est en faisant respecter les durées légales du travail en France, par exemple dans les transports routiers, qu’on créerait 40 000 emplois du jour au lendemain avec le meme volume de fret : les disques de contrôle existent, il ne manque que les contrôleurs du travail, ils couteraient moins cher, seraient efficaces et permettraient meme de « taxer » la pollution des gros « poids lourds » sans recourir à des portiques provocateurs inutiles et couteux. Mais macron n’a pas contestée la directive de 1996, qui permet a des chauffeurs bulgares de faire Sofia Lisbonne, ou Sofia Amsterdam, sans respecter aucune règle, et en étant payés 400 euros par mois.
C’est aussi faute de contrôle, comme nous ne cessons de le dire, s’il y a un milliard d’heures supplémentaires non déclarées, non payées, non majorées, en France même et c’est l’équivalent approximatif de 600 000 emplois ?
C’est aussi faute de contrôle public s’il n’y a pas plus d’embauche dans le bâtiment, et s’il y a 450 000 « travailleurs détachés » en dépit du droit français. Les « majors » du BTP s’enrichissent, tous chantiers confondus, dans une cascade de sous-traitance, qui nuit à l’emploi comme aux salaires, mais pas aux milliards de « marges » créés. C’est parce que les gouvernements français successifs le veulent bien et, celui de Macron aussi pour lequel les « marges » sont sacrées, et pas l’emploi.
Salaires fraudés, abaissés et « travailleurs détachés » :
Les patrons français trichent et utilisent le maximum de travailleurs dissimulés. Pas seulement par le truchement des heures supplémentaires impayées, mais aussi en ne déclarant pas les salariés, en étant nombreux à ne pas payer les cotisations sociales. Et il manque cruellement de syndicalistes et d’inspecteurs du travail pour rétablir la justice contre les patrons-voyous.
Emmanuel Macron tenait absolument à faire semblant de faire quelque chose contre l’infâme directive Union Européenne dite des « travailleurs détachés ».Même Valls en septembre 2016 avait menacé de la dénoncer unilatéralement, c’est dire. D’aout à octobre Macron a fait semblant, contre toute sa nature anti-salaires, de modifier la Directive sur les « travailleurs détachés ». Il a joué les « moulins à vent » il a échoué, bien sur, alors il a menti et masqué le fait qu’à la fin le patronat avait gain de cause, et le chômage et les bas salaires avaient gagné.
C’est une directive totalement discriminatoire en ce qu’elle permet à des patrons français, du bâtiment notamment, d’utiliser entre 350 000 à 450 000 travailleurs venus de différents pays d’Europe en les payant 15, 20, 25 ou 30 % moins cher, ici, que leurs confrères français qui sont sur les mêmes postes de travail. C’est une énorme mine d’or pour le patronat français qui les utilise ainsi de façon discriminatoire : sur 400 000, 25 % d’économie sur les cotisations sociales, c’est l’équivalent de 100 000 salariés gratuits. Les milliards coulent a flots.
Macron ne s’agite que sur les aspects superficiels de la discrimination :
1°) Il dit avoir obtenu que les salaires nets soient payés conformément aux conventions collectives en vigueur, primes incluses. En voila une porte ouverte enfoncée ! Mais légalement, cela aurait déjà du être le cas. On sait que le patronat en profitait pour ne pas respecter les différents niveaux de salaire qualifiés de ces conventions, mais c’était une fraude. Il va lui être demandé de ne plus frauder. C’est présenté comme une avancée.
2°) Le détachement est limité à 12 mois (a au lieu de 24), et c’est présenté comme une victoire, malgré le fait qu’il puisse y avoir une « dérogation possible pour 6 mois de plus ». Là c’est carrément ridicule : qui va contrôler et accorder la dérogation, sur quels critères et à quoi sert-elle sachant qu’on nous explique par ailleurs, que la moyenne réelle des détachements serait de 40 jours, et presque toujours inférieure à 4 mois. Que ce que donne la geste de Macron ? Des CDD successifs plus longs et plus fréquents allant jusqu’à 18 mois ! Il est certain que si le patronat français du bâtiment y parvient il se fera un plaisir d’allonger ces contrats avantageux pendant 18 mois.
3°) Il y aura une période de 4 ans, à partir de l’an prochain pour faire entrer en vigueur ce nouveau texte… soit 2022 ! C’est dire que rien ne change.
Le principe « à travail égal salaire égal » est toujours violé. La discrimination continue sur le non-paiement – au taux du pays où l’on travaille – des cotisations sociales : d’ailleurs comme Macron à l’intention de supprimer ces cotisations sociales en France (chômage et maladie) à partir du 1er janvier prochain, c’est tout sauf une surprise.
La Hongrie, la Lituanie, la Lettonie et la Pologne ont même refusé de soutenir ce médiocre accord, tandis que l’Irlande, et la Croatie se sont abstenues faisant état des conséquences négatives – pour le patronat – de cette éventuelle révision sur les entreprises de transport.
Lesquelles sont donc exclues de l’accord. Des dizaines de milliers de camionneurs vont continuer d’aller de Varsovie à Lisbonne et de Milan à Amsterdam, de Sofia à Bordeaux, de Riga au Havre, sans aucun contrôle, aucun horaire, à raison de 400 euros de « salaire » par mois. Cela viole toute les règles du travail, de la concurrence, et fait courir des risques énormes (accidents et pollution) sur les routes en accentuant délibérément un chômage de masse dans la profession. Les transports sont certes cités dans le compromis final, mais continuent à relever de la directive de 1996 jusqu’à l’adoption d’une loi spécifique, en cours de négociation, … c’est à dire « à la Saint Glinglin ». En France, la loi sur les transports de 2016, dite loi Macron, a réaffirmé la garantie évidente aux « routiers détachés » du bénéfice du droit social français et notamment du salaire minimum : mais qui s’en occupe ? Qui contrôle ? Qui sanctionne ? Personne. Si l’on se donnait les moyens de contrôle et de sanction en faisant respecter un maxima de 56 h tout compris (astreintes incluses) par semaine, et des salaires nets décents avec cotisations décentes, il a été calculé que cela ferait 40 000 emplois du jour au lendemain dans le transport pour le même volume de fret. Mais les sociétés concernées feraient moins de marges.
Macron s’est moqué de nous en saluant « un accord ambitieux » : « L’Europe avance, je salue l’accord ambitieux sur le travail détaché : plus de protections, moins de fraudes ». Mensonge : il n’y aura pas plus de protections et toujours autant de fraudes ! Muriel Pénicaud siffle les louanges de « la première victoire de la refondation de l’Europe (sic) voulue par le président de la République, dans une conception où l’Europe, pour être acceptable pour ses citoyens, pour être forte, doit protéger, doit avoir une dimension sociale à côté de sa dimension économique ». « La première avancée de ce texte, qui est fondamentale, c’est à travail égal, salaire égal sur un même lieu de travail » a-t-elle le culot de souligner. C’est faux. C’est encore un mensonge. Il n’y aura pas salaire égal à travail égal. Les salaires bruts restent payés, en théorie quand ils le sont, (et qui peut savoir s’ils le sont ? aucun contrôle réel n’existe) au taux du pays d’origine. A part confirmer qu’il faut condamner les évidentes fausses domiciliations, rien n’a été décidé pour interdire les doubles ou triples niveaux de sous-traitance, pas plus en Europe qu’en France.
On nous dit qu’il y aurait 2,05 millions de travailleurs détachés dans l’Union européenne en 2015, soit une augmentation de 41,3% par rapport à 2010. La Pologne se classerait comme le premier pays d’origine avec 463 000 salariés détachés dans d’autres pays de l’UE. L’Allemagne et la France seraient, de leur côté, les deux premiers pays destinataires avec respectivement 419 000 et 178 000 travailleurs reçus. Mais ces chiffres officiels sont contestables ; en 2013, Michel Sapin concédait un chiffre de 250 000 à 350 000 travailleurs détachés en France et admettait que c’était une estimation basse. Depuis cela n’a pu qu’augmenter tellement c’est juteux pour les patrons français, et on commence à trouver ce type de sous-salariés dans tous les secteurs (agriculture, restauration, transports, services, maisons de retraite) et pas seulement dans le bâtiment. En plus des routiers, on a maintenant des camionnettes qui font le cabotage final. Ce ne sont évidemment pas les 1600 agents de contrôle de l’inspection du travail qui ont les moyens de contrôler si les cotisations sociales sont payées à Budapest ou Bucarest !
C’est très grave pour l’Europe ! Mettre en concurrence sur notre sol, sur les mêmes postes de travail, des salariés français à cotisations sociales françaises, avec des salariés à cotisations bulgares, estoniennes ou polonaises, reste un pur scandale discriminatoire avec une portée politique et sociale fortement négative contre l’Union européenne qui le permet.
Invoquer l’Europe pour ne pas augmenter les salaires, et accepter une concurrence déloyale, ne tient pas debout. De façon évidente, à l’intérieur même de notre pays, il y a des marges de manœuvres considérables si au lieu de céder au Medef sans contreparties, on imposait une politique d’emploi, de contrôle des entreprises, de réduction du temps de travail, d’interdiction de la précarité, on aurait de meilleurs salaires tout en travaillant moins !
Mais évidemment cela aurait un résultat, c’est la baisse des fameuses « marges », des dividendes dont les patrons et actionnaires français sont si friands au détriment de nos concitoyens.
Discrimination salariale femmes – hommes :
De façon générale, la discrimination sexiste salariale est la plus importante de toutes. Là, il reste un véritable élément de disparité et division du salariat. « Dis moi combien tu gagnes, je te dirais comment tu vis » ? Même surqualifiées, les femmes gagnent moins, progressent moins dans leur carrière. Cette question structure toute la hiérarchie sociale, surdétermine tous les relations sociales, familiales et même les rapports intimes.
Aucun des pouvoirs qui se sont succédés n’a voulu y mettre un terme. Ils ne veulent pas augmenter de 27 % les salaires des femmes pour rattraper ceux des hommes pardi !
A temps plein, à travail égal, les différences atteignent de 10 à 27 % de salaires, en moins pour les femmes. Mais selon les différents types de contrats, c’est bien pire si on souligne que 85 % des 16 % de temps partiels sont des femmes et seulement 7 % des cadres supérieurs sont des femmes.
La petite tentative de l’ANI du 11 janvier 2013 et de la loi Sapin du 14 juin 2013 pour instaurer un « plancher » de « 24 h hebdomadaires minima » pour les emplois à temps partiels essentiellement féminins a été contrecarré par un tel nombre de dérogations que ce n’était plus un plancher mais une passoire. Les lois Macron du 8 août 2015 et El Khomri du 9 août 2016 ont fait disparaître ce plancher de la loi, en le soumettant au bon vouloir des employeurs branche par branche et entreprise par entreprise.
Comme dans le temps partiel, les questions des heures complémentaires ne sont pas réglées, ni les retraites, ni les conditions du retour au temps plein, les discriminations sont puissantes.
Les congés maternités sont l’occasion de freiner les carrières féminines : le code du travail prévoit que les femmes retrouvent un poste « identique » ou « similaire ». On pourrait enlever le mot « similaire » et imposer un statut temporaire de « salariée protégée » (non licenciables sans autorisation préalable de l’inspecteur du travail) : cela imposerait aux employeurs d’anticiper leur reclassement, et de ne pas pouvoir les écarter à leur retour de couches. Macron permet même dans ses ordonnances de modifier le congé maternité dans chaque entreprise.
La loi Rebsamen du 19 août 2015 a fait reculer les obligations de comparaison, d’information des employeurs sur les salaires femmes-hommes auprès des institutions représentatives du personnel. C’est aussi la voie choisie par Macron à travers ses lois et ordonnances anti code du travail depuis cinq ans : laissez faire c’est aussi laissez discriminer !
Il est amusant de voir Le Figaro lui-même récemment s’en inquiéter : « La parité salariale entre les hommes et les femmes, c’est pour quand ? La réponse a été donnée dans un récent rapport du Forum économique mondial: en 2186, soit dans quelque 170 années… « Trois lois (2006, 2012, 2014) ont été promulguées en faveur de l’égalité salariale durant ces dix dernières années » ca ne sert à rien puisqu’ aucune n’est contraignante. Que faut il faire ? Attendre 2234 pour réaliser l’égalité, ou bien prendre les mesures pour l’imposer maintenant ?
C’est une question tragique aux yeux de dérégulateurs patentés comme Macron, continuer leur addiction au « laisser-faire » libéral ou mettre enfin un terme à une discrimination millénaire ? Ils essaient de s’en tirer hypocritement depuis des décennies : en jurant qu’ils sont pour l’égalité salariale mais en refusant toute action concrète pour l’imposer.
En octobre 2016, en Islande, des milliers de femmes ont cessé le travail à 14 h 38 précises, heure à partir de laquelle elles commencent à travailler « bénévolement » par rapport aux hommes. En France, le collectif « Les Glorieuses » les a imité en appelant les salariées à cesser le travail le 7 novembre 2016 à 16 h 34 précises et à nouveau le 3 novembre 2017 à 11 h 44 en constatant que le fossé se creuse. Du fait de leur rémunération inferieure, les femmes travaillent bénévolement les 39,7 jours de l’année.
L’écart moyen de rémunération entre les hommes et les femmes reste de… 15, 8 % selon Eurostat, de 19 % selon l’Observatoire des inégalités, 26,3 % chez les cadres et 9,3 % chez les employés. En moyenne, lorsqu’un homme cadre perçoit un salaire mensuel net de 4380 euros, une femme cadre reçoit 3469 euros.
Et le même Figaro, (30 octobre 2017) pas soupçonnable d’être gauchiste, selon un rapport de la « Fondation Concorde » (Erwan Tison, auteur de cette étude) , précise qu’en cas d’égalité salariale stricte, du fait de la hausse de la TVA, la hausse des recettes de l’impôt sur le revenu et de la hausse des cotisations sociales et patronales, le gain de recettes pour l’état serait de 37,5 milliards d’euros, ce qui engendrerait une hausse de 6,16 milliards d’euros d’épargne et de la consommation de 21,98 milliards. Soit 168,74 milliards d’Euros en un quinquennat.
Ce raisonnement ne concerne pas seulement la hausse des salaires des femmes, mais toutes les hausses de salaires ; si les salaires augmentaient massivement, la protection sociale, l’économie, les carnets de commande iraient bien mieux. La finance s’y refuse, elle préfère « tenir » les salariés par le crédit, au risque de gonfler la « bulle financière » plutôt que d’accepter une redistribution par les salaires. Agent de la finance, Macron est co-responsable de cette politique austéritaire et sexiste, et de tous ses effets négatifs.
On peut et on doit donc, pour sortir de la fameuse « crise », faire le contraire de tous les préjugés stériles et de toute la politique de Macron : augmenter les salaires et baisser les dividendes !
Même le FMI démontre, avec quelque bon sens, qu’une hausse du revenu des plus riches provoque un déclin de la croissance et une pauvreté accrue des inégalités plus fortes de revenu, sans amélioration de la situation générale de l’économie (emploi, pauvreté, inégalités, croissance, progrès technique).
Quand ses interlocuteurs lui disent qu’il faut faire payer les riches, Macron répond : « – T’es jaloux ? ». Pas question pour lui de reconnaitre que l’argent des riches c’est sur la sueur des pauvres qu’ils l’ont gagné. Pas question d’admettre que la réduction des inégalités serait meilleure pour l’économie et l’emploi que les « aides » phénoménales versées aux chefs d’entreprise et aux financiers.
« T’es jaloux ? «
62 personnes possèdent à elles seules les mêmes richesses que 3,5 milliards d’humains, soit la moitié de la planète. Les 400 plus riches milliardaires du monde dépassent le PIB de l’Allemagne. Tous les actionnaires de la planète se sont partagés 372 milliards d’euros au cours du seul 2° trimestre de l’année 2016. Cela représente une hausse de 8,5 milliards, soit + 2,2%. Et les sociétés françaises sont en pointe dans cette hausse : 9 sociétés françaises sur 10 ont augmenté ou maintenu leurs dividendes, notamment dans le secteur bancaire ou du luxe. Alors qu’elles paient traditionnellement 75 % de leurs dividendes au 2° trimestre, la société de gestion britannique Henderson a calculé que les dividendes versés par les sociétés françaises ont bondi de 12,4 % par rapport au 2° trimestre 2015, pour atteindre 35,3 milliards d’euros au 2° trimestre 2016. Cela fait de la France le pays d’Europe où la croissance des dividendes a été la plus forte après les Pays-Bas.
L’étude d’Henderson pointe les banques françaises : Société générale, BNP et Crédit agricole ont aussi augmenté leur distribution de 50 à 70 % au dernier trimestre 2016, par rapport au 2° trimestre 2015. Une performance des banques hexagonales est assez atypique en Europe : les banques allemandes, espagnoles et belges ont au contraire réduit la voilure. L’Allemagne réalise d’ailleurs un piètre score, avec une progression de 2 % seulement des dividendes payés par les entreprises d’avril à juin. Une mauvaise performance imputable à la Deutsche Bank, qui a annulé son dividende, mais aussi à Volkswagen, qui a réduit le sien de 98 %.
« La violence des riches », comme l’analyse le couple de sociologues et militants Pinçon-Charlot, est sans limite. Ils n’ont aucune compassion et rien n’arrête leur morgue.
Le prix Nobel Joseph Stiglitz le clame : « 91 % de la croissance mondiale est capturée par 1 % en haut de l’échelle »
Les 500 plus grandes fortunes de France avaient déjà grimpé de 25 % en 2013. Un bond spectaculaire qui révèle les profits que tire de la crise une poignée de grands patrons, pendant que le pouvoir d’achat des Français reculait de 0,9 % cette année là. L’économiste Benjamin Coriat a étudié et comparé ces dividendes, dans le long temps historique : jamais les grandes entreprises françaises n’en ont perçu ni distribué autant. Si la courbe du chômage n’a pas été inversée, en voilà la cause et le résultat.
« Jamais, depuis 1996, année où Challenges a lancé son classement des “500”, leur fortune globale n’avait atteint de tels sommets », souligne le magazine. Elles représentent l’équivalent du budget de l’État, 16 % du produit intérieur brut et 10 % du patrimoine des Français, détenus par 0,001 % d’entre eux. Les dix plus riches « pèsent » à eux seuls 40 % du total amassé par les 500, soit 135 milliards d’euros (+ 27 % en un an). En tête, soulignait Sébastien Crépel dans l’Humanité du 12 juillet 2013, on retrouve des noms célèbres de l’industrie du luxe, de l’armement, de la grande distribution ou des nouvelles technologies : Bernard Arnault (LVMH, 24,3 milliards) ; Liliane Bettencourt (L’Oréal, 23,2 milliards) ; Gérard Mulliez (Auchan, 19 milliards) ; Serge Dassault (12,8 milliards) ; Vincent Bolloré (8 milliards) ; Xavier Niel (Iliad, 5,9 milliards). Des gens connus, aussi, pour leur propension à l’exil fiscal qui coûte 40 milliards d’euros annuels à la France, les familles Wertheimer (Chanel, 8e, 7 milliards de fortune), Castel (8e ex aequo) ou encore Peugeot (40e, 1,3 milliard) figuraient parmi les 44 Français présents dans le classement de décembre 2011 des 300 plus riches de Suisse. Il existe 78 milliardaires français dont 2 possèdent plus que 20 millions de nos concitoyens.
Chez les Français, Liliane Bettencourt, l’héritière de l’Oréal, était, avant son décès, la seule milliardaire dans le top 10 mondial, avec 40,1 milliards de dollars, mais une fortune en hausse de 5,6 milliards par rapport à 2014.
Viennent ensuite : - Bernard Arnault, (« Merci patron » Cf. film de François Ruffin) propriétaire du groupe de luxe LVMH, 13e, avec 37,2 milliards de dollars, contre 33,5 milliards en 2014. – Patrick Drahi, président de la multinationale des télécommunications Altice, 57e, avec 16 milliards de dollars. – Serge Dassault, sénateur UMP et patron du groupe Dassault, 62e au classement avec 15,3 milliards – François Pinault, ancien président de Kering (ex-groupe Pinault-Printemps-Redoute) arrive en 65e place avec 14,9 milliards. Parmi les Françaises, figurent aussi notamment Elisabeth Badinter (1.173e, 1,7 milliard) et Marie Besnier Beauvalot, héritière du groupe Lactalis (737e, 2,5 milliards).
En 2013, la France comptait 2,1 millions de millionnaires. Ils étaient 2,4 millions en 2014 et, si les prévisions sont exactes, le double en 2019, soit 4,2 millions. Non pas qu’ils méritent leurs énormes fortunes. Ca se saurait si en travaillant on pouvait acquérir de telles sommes, elles proviennent de la spéculation et du pillage du travail des autres.
La fortune des 500 français les plus riches a été multipliée par 7 en 20 ans (selon Challenges, juin 2017). En 2017, la fortune cumulée des Français les plus riches représente 25,7 % du PIB français. Elle ne représentait que 6,4 % du PIB en 1996. Merci MM Sarkozy, Hollande, Macron !
Des chiffres apparemment inouïs, mais qui ressortent aussi d’une très sérieuse étude du Crédit Suisse : 7 % des millionnaires de la planète sont des citoyens français, ce qui nous classe champion d’Europe et au 3° rang mondial. Certes, la France fait moins que les États-Unis (41 % des millionnaires soit 14 millions de personnes), mais elle talonne le Japon (8 %) et devance l’Allemagne et le Royaume-Uni (6 % chacun), loin derrière la Chine (3 %) et… la Suisse (2 %). Le nombre de très riches Français selon le Crédit suisse étonne : « Alors que les 48 millions d’adultes vivant en France ne représentent qu’à peine plus de 1 % du total d’adultes dans le monde, en termes de patrimoine agrégé des ménages, le pays se classe au 4° rang des nations ».
On nous anone tous les matins sur les radios des grands médias formatés que « c’est la crise », que la France « va mal », est « en déclin », « endettée, en déficit », que « les caisses sont vides » et autres scies ! Menteurs !
C’est faux, depuis des années, les Français « d’en haut » ne cessent de s’enrichir. Et le chômage et les petits boulots d’augmenter, salaires bas et bloqués. Alors pourquoi Macron supprime t il l’impôt sur la fortune en resserrant tous les budgets sociaux ? Il n’y a aucune explication un tant soit peu légitime. Selon l’Insee et de la Banque de France d’après les comptes nationaux depuis 1996 le patrimoine net des ménages a augmenté nettement jusqu’en 2007, avant de connaître un creux en 2008 et 2009, conséquence de l’explosion des « subprimes ». Mais depuis, la courbe a nettement repris vers le haut pour revenir au niveau atteint en 2007.
« En 2012, le patrimoine des Français atteint 10 544 milliards d’euros », précise l’Insee. À titre de comparaison, la dette publique (présumée) du pays – au nom de laquelle on nous serre la ceinture et on nous bloque le smic et les salaires -, s’élève aujourd’hui à 2 000 milliards d’euros. Les 4 principales banques du pays détiennent 8000 milliards d’actifs : c’est à elles qu’il faut rembourser en priorité et au détriment de la majorité de nos concitoyens, la « dette » officielle présumée (2100 milliards) du pays ?
Cette fortune des Français c’est d’abord leur patrimoine immobilier, environ 70 % de leurs actifs mais ce secteur a baissé depuis 2012 ce qui oblige à chercher une autre explication à la progression globale du patrimoine : c’est la forte hausse au cours des dernières années des actifs financiers : actions, obligations, encours des contrats d’assurance-vie et épargne bancaire. Et c’est prétendument pour favoriser la hausse de ces actifs qui haussent déjà… que Macron maintient la taxe du l’immobilier, mais supprime l’ISF ?
Tous les Français ne sont pas logés à la même enseigne face à la richesse : ainsi, selon le revenu médian qui partage la population en deux, la moitié de nos compatriotes ont un patrimoine inférieur à 111 000 €.
L’Insee est allée plus loin encore en divisant la population en dix parties, des plus pauvres aux plus riches. Le constat, établi en 2010, est frappant : les 10 % les mieux dotés possèdent 48 % de la richesse totale, tandis que la moitié la moins favorisée se partage à peine 7 % du patrimoine.
L’écart a-t-il diminué depuis 2013 ? Non. L’enquête 2014 sur les revenus et le patrimoine des ménages précise que « la plupart des indicateurs montrent une progression des inégalités », qui atteignent « leur plus haut niveau depuis 1996 ».
Il faut croire que les impôts qui concernent ces gens n’ont pas tant augmenté que cela. Alors pourquoi faire tant de tapage sur l’asphyxie, le matraquage fiscal ? A quoi ça sert de « rendre 400 millions d’euros aux 1000 premiers contributeurs de l’ISF » comme s’en vante Bruno Le Maire, ministre de l’économie de Macron ? A quoi ça sert de donner 7 milliards de cadeaux fiscaux aux plus riches ? (ISF, 3,5 milliards, impôts sur les revenus financiers réduits à 30 %, 1,5 milliard, suppression de la plus haute tranche de la taxe sur les salaires des banquiers, 300 millions, baisse des prélèvements sur les stock-options, 120 millions, suppression de la taxe sur les dividendes, 2 milliards – avec 10 milliards à rembourser sur les 5 dernières années du fait de l’illégalité de cette taxe retoquée par le Conseil Constitutionnel.
Outre ce record de dividendes français de 2015 et 2016, et ces 500 familles qui détiennent 460 milliards (Cf. classement annule de Challenges), on doit redire qu’il existe en France, 80 milliards de fraude fiscale avérée (Cf. affaire Jérôme Cahuzac), 600 milliards d’avoirs français dans les paradis fiscaux (Cf. Offshore-leaks, Panama papers) 58 multinationales qui « blanchissent » 100 milliards de nos impôts potentiels au Luxembourg (Cf. le scandale de Luxleaks) , soit 1 % de l’oligarchie potentielle qui détient tout. Cet argent, ils l’ont essentiellement par la spoliation, la spéculation, pas par leurs mérites.
Pareillement pour les entreprises, on ne le redira jamais assez : 1000 entreprises produisent 50 % du PIB de notre pays. Elles font la pluie et le beau temps, elles décident de tout, notamment de tout ce qui concerne les PME, PMI, ETI puisque 80 % de ces dernières ne sont pas indépendantes mais sous-traitantes. Sans omettre de mentionner à cette place, le million de TPE de moins de 10 salariés qui rament en dessous.
De l’autre coté, il y a les millions de travailleurs pauvres, retraités pauvres, jeunes en formation pauvres, 6,125 millions de chômeurs en majorité pauvres. Une fois de plus, les salariés, 93 % des actifs, 98 % d’entre eux gagnent moins de 3200 euros, le salaire médian stagne à 1700 euros. Les plus pauvres décrochent : le taux de pauvreté à 60 % du niveau de vie médian atteint son maximum – 18 % – dans les villes de 100 000 à 200 000 habitants. Dans les communes des banlieues défavorisées où les quartiers populaires des grandes villes, le taux de pauvreté dépasse souvent les 30 % : Grigny, 44,8 %, Clichy sous Bois, 44,5 %, Roubaix, 42,3 %, Aubervilliers, 41,9 %, La Courneuve, 41,7 %, Garges-lès-Gonesse, 41 %, Creil, 37,2 %, Saint-Denis, 36,7 % Villiers-le-Bel, 36,6 % Bobigny, 36,4 % Pierrefitte sur Seine, 36,1 %, Stains, 35 %, Maubeuge, 33,9%, Sarcelles, 33,9 %, Béziers, 33,2 %, Pantin, 33 %, Villeneuve Saint-Georges 32,3 % Vaulx-en-Velin, 31,9 % Lens, 31,8 %, Mulhouse, 31,6 %). 2,8 millions de jeunes sont en dessous du seuil de pauvreté.
Pas de quoi être « jaloux » des riches, mais de quoi être vraiment en colère.
Selon Louis Maurin, parmi les 30 % les plus riches, les revenus ont continué à progresser entre 2008 et 2012 : + 500 euros pour les 10 % les plus aisés.
La crise, les 30 % du haut de la pyramide, ne la connaissent pas vraiment. A ce niveau de vie (au moins 2 200 euros par mois pour une personne seule), on vit décemment et surtout on continue à gagner plus, même si on est loin des sommets. Les gains demeurent toutefois beaucoup plus faibles que ceux qu’on observe chez les 0,1 % les plus riches qui ont gagné (au minimum) 243 000 euros (avant impôts) de plus en 2011, qu’en 2004.
Les trois dixièmes de la population situés entre les 40 % les plus pauvres et les 30 % les plus riches ont vu leur situation stagner. Ces classes moyennes ne sont pas « étranglées » selon l’adage médiatique, leur situation n’est pas la plus difficile, mais cette stagnation constitue une rupture pour des catégories au cœur d’une société où l’on consomme toujours plus
Enfin, parmi les 40 % du bas de la hiérarchie sociale, les revenus ont diminué entre 2008 et 2012 de 300 à 500 euros. (4 juin 2015 – L’Observatoire des inégalités publie son premier « Rapport sur les inégalités en France ». Une analyse des données présentées dans ce document par Louis Maurin).
Comment supporter une politique qui aboutit à cela ?
L’anti Macron : smic à 1800 euros, baisse des dividendes.
La hausse des salaires et la baisse des dividendes, est un choix réaliste, modéré, juste, prioritaire.
C’est un choix contre la stratégie de François Hollande-Emmanuel Macron depuis 2012 et aussi contre ceux qui ont partagé cette erreur (Même l’ami Arnaud Montebourg dans sa déclaration de candidature, le 21 août 2016 à Frangy : « Il faut produire les richesses AVANT de les redistribuer »). C’était la thèse qui servait d’excuse à François Hollande : « Je rétablis les équilibres, puis je redistribuerais ». C’est toujours le même discours : on réduit les déficits, on assainit puis, après on fait du bien aux gens. Avec ces raisonnements libéraux ordinaires, les purges sont à perte de vue, et la fameuse redistribution promise ne pointe jamais à l’horizon.
Ce fut le cas de Jacques Chirac en 1995, qui fit campagne victorieuse « contre la fracture sociale » et qui, quatre mois plus tard, fit un tournant brutal « pour la réduction des déficits »
Là où les libéraux disent « il faut d’abord produire les richesses avant de les redistribuer », opposons frontalement : « il faut d’abord redistribuer les richesses avant d’en créer et même pour en créer de nouvelles ». C’est simple, mais ça change tout.
En défendant les petits salaires et les petites retraites, on prendra le contre-pied du système en place et notamment du quinquennat entier de François Hollande-Emmanuel Macron. C’est un choix totalement opposé aux idées dominantes néo-libérales actuelles : au lieu de « baisser le coût du travail » nous voulons « baisser le coût du capital » et nous servir de la hausse des salaires directement comme instrument de redistribution le plus simple, le plus rapide et le plus légitime.
Tout travail mérite salaire approprié, et s’il y a crise, que les accapareurs paient d’abord !
Ce sont les salariés qui produisent les richesses et n’en reçoivent pas, en retour, la part qu’ils méritent.
Le salaire c’est l’élément central, décisif, au coeur de l’activité économique et sociale dans toutes les entreprises, quelles qu’elles soient. Les salariés cherchent légitimement à vendre leur force de travail le plus cher possible, et les employeurs de leur côté, cherchent à l’acheter le moins cher possible. Le problème c’est que voilà déjà trente ans que la part des salaires a baissé d’environ 10 points et que la part des profits et dividendes a augmenté d’autant. C’est même là qu’il faut chercher l’origine de la « crise » économique et sociale dont les libéraux parlent tout le temps. Cette « crise » c’est leur crise.
Car à la place des salaires, en baisse, les banques ont effectués des crédits, elles ont spéculé dessus jusqu’à ce que la bulle financière artificielle explose. Les salariés pris à la gorge ont été jetés au chômage massivement, et empêchés de consommer ce qui a ruiné en cascade les carnets de commande et la production.
Dans les années 2012-2015, en France, le taux d’utilisation des capacités productives était de 70 % : tout s’est ralenti et dégradé. Délibérément, en dépit des sommes considérables dont il était abreuvé, le patronat produisait moins.
En haut, les banques, la finance prospèrent, accumulent, spéculent. En bas, niveau de vie, salaires, minimas sociaux, bien-être des travailleurs sont dégradés et bloqués empêchant tout redémarrage.
C’est un cercle vicieux que les libéraux aggravent de façon systémique tant que cela leur rapporte : ils gagnent plus à licencier qu’à embaucher, ils ont intérêt à spéculer plus qu’à investir, l’emploi rapporte moins que la rente.
L’aggravation des inégalités à atteint un point « anti économique » : il n’est question que de réduction des « déficits », réduction de la « dette », réduction des services publics, réduction de la protection sociale, réduction des salaires, réduction des minimas sociaux, tout ce qu’on ne cesse d’entendre dans les discours officiels de nos grands « médias » – et c’est encore le cas pour les budgets Macron de 2018, celui de la LFSS, et celui de l’état. En serrant la vis sous prétexte de rembourser la dette officielle présumée, en fixant le déficit à 2,7 %, l’effet est négatif.
Le chantage aux déficits et à la dette
Des millions de nos concitoyens ont fini par croire les sempiternels « les caisses étaient vides », « l’état dépense trop », il y a « trop de dettes », « trop d’impôts », il faut « se serrer la ceinture », on « ne peut pas gagner plus » à cause de la « crise ».
La propagande quasi totalitaire, car il faut l’appeler ainsi, des banques privées (elles ne sont hélas plus publiques) c’est « remboursez la dette » ou « payez (nous) des taux d’intérêts exorbitants ».
La Banque centrale européenne (BCE) n’a pas le droit de prêter des euros aux états (ce qui est une interdiction incroyable quand on y réfléchit) alors elle prête aux banques privées (à des taux dérisoires, même à 0,5 %) et puis les banques re-prêtent aux états à des taux plus élevés et des conditions draconiennes allant jusqu’à étrangler des pays entiers comme ce fut le cas, le pire exemple, de la Grèce (« faites des économies », « baissez les salaires » réduisez les frais de santé, des écoles, des équipements, des indemnités de chômage, des retraites, etc.).
Ainsi les banques n’ont jamais été sanctionnées pour leur rôle destructeur dans la crise de 2008 dites des « subprimes », ni pour leurs choix anti sociaux, anti emploi, anti droit du travail… mais elles ont reconstitué tous leurs avoirs, aucune mesure de contrôle sérieuse n’a été prise, et donc de nouvelles bulles financières peuvent éclater.
Le résultat en France c’est que les quatre principales banques ont des actifs à hauteur de 8000 milliards d’euros, que la « dette » (présumée) est à la hauteur de 2100 milliards d’euros (l’équivalent des trois budgets français, état, collectivités, protection sociale), et chaque année, puisque la « priorité » est donnée à la réduction des déficits, il leur versé plus de 50 milliards d’intérêts… Précisons bien « d’intérêts » : car la dette elle-même n’est pas remboursée, ne le sera jamais et elle continue de prospérer. Ce remboursement de la dette présumée, est ainsi devenu un artifice, un piège étouffant, un argument de propagande et de peur, qui légitiment de prendre de l’argent à des millions de salariés et de pauvres, pour le transférer à des centaines de milliers de rentiers et d’actionnaires accapareurs.
François Hollande, au lieu, comme il l’avait promis, de lutter contre la finance s’est rallié à elle et il l’a payé cher… Il a commis deux fautes énormes : il a réduit les déficits de façon nuisible pour l’activité économique, et il ré-endetté le pays en choisissant d’aider les employeurs à reconstituer leurs marges dans l’espoir qu’ils créent de l’emploi. (Cf. « Dette indigne » Ed. JC Gawsewitch, 2011)
La réduction des déficits a été drastique : il enlevait chaque année pas loin de 10 milliards à la protection sociale, 9 milliards au budget de l’état et autant aux collectivités territoriales.
Tout fonctionnait moins bien, et les services publics, et les entreprises voyaient des commandes disparaître. Ce remboursement de la « dette » accroissait… la « dette ». Cette opération est comparable à l’action d’un jardinier qui arroserait la rivière pendant que son jardin s’assèche. Ou à celle d’un commerçant qui se plierait aux exigences de la banque pour rembourser des traites au point de ne plus avoir de marchandises à vendre dans sa boutique.
Sous la droite et le quinquennat de Nicolas Sarkozy la dette était passée de 63 % du PIB à 86 % du PIB, sous le quinquennat de François Hollande, la « dette » est passée de 86 % du Pib à 98 % du Pib. Evidemment dans ces conditions, le chômage de masse, s’est accru au lieu de se réduire et toute la société en a pâti.
Le versement de 41 milliards de CICE par François Hollande est l’autre erreur majeure (on lui a dit dés le premier jour ! Il a refusé sur ce point d’entendre la gauche et a choisi ses conseillers maudits, Jouyet, Macron, Valls, etc.). il a eu tort à 100 % : les employeurs et actionnaires ne sont pas sociaux, ni de gauche, ni altruistes, ils ont siphonné ces 41 milliards de crédits et les ont placé à Panama aux Iles Caïman ou « blanchi » au Luxembourg et non pas dans l’emploi. Comme aucune contrepartie n’était exigée, aucune vérification, aucune contrainte exercée, ils se sont bien gardés d’embaucher.
On le savait déjà pourtant : quand la TVA avait été baissée à 5,5 % pour les restaurateurs, pendant cinq ans, il n’en était rien ressorti. Ils ont encaissé 5 milliards mais ils n’ont créé ni emploi, ni modernité, ni qualité supérieure, les employeurs se les sont mis dans la poche, ou, pour les plus riches, sont allés créer des restaurants à Tokyo ou Washington.
On a vu des entreprises majeures du pays, parmi les 58 grandes multinationales, et aussi, des entreprises publiques gérées selon les mêmes principes, encaisser ces aides sans vergogne et continuer systématiquement et massivement à licencier – au lieu par exemple d’en profiter pour réduire la durée du travail et garder, ou recruter des salariés. Nokia supprime 600 postes en France après avoir touché 67 millions d’euros de CICE et de CIR (crédit impôt recherche) en 2016 ce qui revient à dire que les actionnaires de Nokia ont reçu 100 000 euros d’argent public par poste supprimé.
Les 41 milliards sous Hollande, auraient été utilisés pour des investissements directs et des emplois publics (dans les écoles, les hôpitaux, les services publics, justice et police) pour augmenter les salaires et du même coup la protection sociale, cela aurait fait du bien aux gens, amélioré l’ensemble du développement du pays, et surement généré des gains, cotisations, impôts, qui auraient, ensuite diminué les déficits, et la fameuse « dette ». Mais ces 41 milliards ont été retirés des caisses publiques et donnés aux caisses privées, pour rien.
Le pillage permanent par les banques
Autrement on nous a affirmé hier avec Hollande –Macron et maintenant avec Macron seul, que les banquiers étaient là, menaçants et auraient dit : « - Si vous ne faites pas cela, si vous haussez les salaires, si vous ne faites pas ces cadeaux aux entreprises et aux banques, on augmente les taux d’intérêt, on bloque tout et ce sera pire ».
Ils ont ainsi torpillé à mort la Grèce pour servir d’exemple à tous les autres pays de l’Union européenne. Les banques sont plus fortes que des tanks pour exercer ce type de dictature. Les banquiers privés dirigent tout, ils ont plus de pouvoir qu’un ministre et plus de force que le gouvernement, ils dominent à Bercy, et font le siège de l’Elysée comme il leur plait. Ils décident de tout, ce qui fait du bien et ce qui fait du mal, et nos élus n’ont plus qu’à se soumettre (d’autant qu’il règne une discipline de fer dans les groupes parlementaires et que la moindre « fronde » devient la responsable… du désastre politique provoqué par ce qu’elle conteste).
Ils matraquent surtout les « petits » entrepreneurs, d’ailleurs, sévères au moindre découvert, excessifs dans tous les frais de gestion, partiaux et, sous couvert d’expertises, politiquement orientés dans toutes leurs transactions et diktats avec les entreprises, les ménages et les particuliers.
Pourquoi notre démocratie est-elle sous la coupe de banques privées, et notre état n’est il plus maitre souverain de sa monnaie, sous contrôle de ses élus, de ses orientations bancaires ? Pourquoi la banque centrale européenne ne peut-elle prêté aux états ?
M. Fréderic Oudéa dirigeant de la Société générale ment devant une commission du Sénat en prétendant qu’il a rompu avec toutes les filiales de sa banque placées dans des paradis fiscaux : lorsque le scandale des Panama’ papers, en explosant, révèle qu’en fait il y a 757 filiales de la Société générale dans ce pays, Fréderic Oudéa n’est même pas sanctionné alors que sa forfaiture est révélée. L’effet de ce système est terrible, car il décourage les citoyens de croire en l’action politique, en leurs votes, en leurs choix, ils se trouvent à leur tour, soumis, impuissants, manipulés, trahis.
Une entreprise comme Total a un chiffre d’affaire de 175 milliards alors que le budget de l’Etat français est de 300 milliards. On comprend pourquoi le défunt Pdg de Total, M. de Margerie, pouvait entrer comme il voulait dans le bureau du Premier ministre, et même arrivé en retard, commencer par se faire servir un whisky avant de commencer la réunion prévue. Le directeur de l’Elysée, ami intime de François Hollande et, comme ce dernier membre de la promotion Voltaire de l’ENA, Jean-Pierre Jouyet, a eu en charge le ministère des Affaires européennes sous Lionel Jospin, puis sous Nicolas Sarkozy, puis dirigea l’Autorité des Marchés Financiers (AMF, place de la Bourse à Paris) avant de diriger l’Elysée. Ajoutons que Jean-Pierre Jouyet est lié à la famille Taittinger, tout comme… M de Margerie et vous aurez une idée du cœur de l’oligarchie en France et de sa toute puissance.
Sous prétexte de réduire les déficits et de payer la dette, c’est la fameuse « austérité » ou « rigueur », ou « politique de redressement » prolongée depuis 2012 et encore en 2017 avec Macron sous le joug et les exigences de la finance qui a asséché, maltraité, mécontenté le pays et surtout les salariés, les chômeurs, les jeunes, les retraités, toutes les petites gens du bas de l’échelle…
Jusque dans les détails, les banques sont les ennemies des petites gens qu’elles accablent d’agios sans fin lorsqu’ils ont des découverts avec des fin de mois extraordinairement difficiles. Il circule le chiffre global de 27 milliards d’euros en frais de découverts par an, ce qui est intolérable et doit faire l’objet d’une loi sévère de régulation et de protections des petits comptes.
« Pas de bol ! »
On entend des défenseurs de cette politique gravement erronée ressasser : « on ne pouvait pas faire autrement », « la situation était très grave » « on n’a pas fait d’austérité comme ailleurs » ou « moins qu’ailleurs » et « grâce à cela ça va mieux ». François Hollande est même allé jusqu’à affirmer que cela aurait pu marcher mais qu’il « n’a pas eu de bol ».
Hé bien, non, ce n’était pas une « question de bol », c’était une orientation, une ligne politique, des choix mauvais qui ont eu des résultats mauvais : ils ont fait 1,3 million de chômeurs de plus toutes catégories confondues et ça, c’est la pire des austérités, la pire des souffrances pour des millions et des millions de familles, de jeunes sans avenir, de retraités sans joies.
Cela veut dire que pendant les cinq années écoulées, il y a eu transfert des maigres biens des pauvres (salaires, allocations, aides, droits sociaux) vers les riches, les injustices se sont aggravées, le pays a continué de stagner. Pas jaloux, Macron veut continuer.
Ce n’est pas une consolation de dire, « c’est moins pire qu’ailleurs » ou « avec la droite cela aurait été ou cela sera pire » : le fait que la gauche n’ait pas, en cinq ans, amélioré le sort des salariés tandis que les fortunés de l’oligarchie continuaient de se goinfrer au vu de tous, a été ressenti comme une profonde trahison.
C’est la première fois en cent ans, que la gauche au pouvoir n’a rien apporté, aucune loi progressiste, aucun progrès social de fond. Pire : dans le cas ignominieux de la destruction du code du travail – lois Sapin juin 2013, Macron (août 2015), Rebsamen (août 2015), El Khomri (août 2016) – les gouvernements Hollande-Valls-Macron sont allés bien plus loin que ce qu’avait osé faire la droite, ils se sont attaqués aux principes fondateurs, à cent ans d’histoire du Code du travail, et symboliquement ont même remis en cause la réduction de la durée du travail telle qu’elle avait été faite sous Léon Blum, sous François Mitterrand et Lionel Jospin. Ils ont libéralisé à tout va, détruit des protections, privatisé, vendu à des actionnaires cyniques des intérêts collectifs essentiels.
« Pas de bol », en fait c’est une politique qui marche pas : les riches s’enrichissent, les pauvres s’appauvrissent. Ca ne ruisselle pas. Les « premiers de cordée » se goinfrent, s’épaulent, se sauvent, et font chuter ceux qui les suivent.
Hausser le Smic, baisser les dividendes
Même du point de vue invoqué pour faire cette mauvaise politique (croissance, rétablissement des équilibres, réduction des déficits, inversion de la fameuse « courbe » du chômage) les objectifs ne sont pas atteints. Ils ne pouvaient pas être atteints comme cela.
Il faut rompre avec toutes ces théories affichées ou honteuses, de la fameuse « baisse du coût du travail », de la réduction des dépenses publiques, de la diminution de la protection sociale, de la fin « des statuts » et droits (dont on a pu vérifier que Nicolas Sarkozy, François Fillon, comme Emmanuel Macron au cours de leur campagne présidentielle, en ont fait leur cheval de bataille : qu’est ce qui a fait que des responsables de gauche ont cru à cela, sinon qu’Hollande les avait entrainé dans cette voie sans issue).
Au contraire, il faut repartir tout à fait autrement, il faut augmenter les salaires, il faut redistribuer les fruits du travail et ceux qui doivent payer pour la relance, pour la sortie de la crise, ce sera les riches, les actionnaires, les banquiers, les rentiers. Leur taux de marge, leurs profits scandaleux doivent être plafonnés, imposés, revenir dans le giron collectif. Le symbole sera que, en proportion du Smic, du salaire minima, nous instaurerons un salaire maxima. Nous instaurerons des tranches d’impôt directes qui corrigeront les criantes inégalités engendrées par la rapacité sans limites des financiers. Rien que cela est l’amorce d’un changement de société.
Contre Macron, avec le salariat, nous voulons une société de partage, une société d’économie mixte secteur privé et public, nous voulons contrôler les entreprises et non pas « laisser faire » leurs chefs et actionnaires.
Il est utile de bien comprendre que « les inégalités sont les meilleures ennemies de la croissance » ( Eric le Boucher, Le Monde, 27 06 2015). Ce n’est pas parce que les riches sont plus riches qu’ils vont se décider à sauver le monde et qu’un jour… ils vont généreusement se décider à investir et à faire de l‘emploi.
C’est une idée de la propagande des libéraux : aidez ceux d’en haut et ceux-ci aideront ensuite ceux d’en bas.
Il s’agit de la fameuse sottise connue sous le nom de théorème de Schmidt (Helmut Schmidt, un ancien chancelier allemand) « les profits d’aujourd’hui sont les investissements de demain et les emplois d’après demain ». Depuis que cette ânerie malintentionnée a été prononcée (et trop souvent et complaisamment citée comme aphorisme incontournable), on a bien vu les profits, mais guère les investissements et pas les emplois : tout ça s’est arrêté en route.
Comme ceux qui défendent la théorie du ruissellement : versez du champagne dans le verre du haut de la pyramide de verres et ca coulera dans les verres qui sont en-dessous. La vérité est que ça ne ruisselle pas, les verres du bas de la pyramide attendent toujours le champagne. Au contraire, ça siphonne, les profiteurs du dessus sont comme les célèbres Shadocks, ils pompent, ils pompent, ils pompent et n’en ont jamais assez. Quand les riches sont devenus riches, ils veulent devenir encore plus riches et la compétition, c’est entre eux. Sinon comment comprendre le monde actuel avec ses 62 hommes qui possèdent plus que la moitie des humains de la planète ?
L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) avait estimé en octobre 2015 que « l’énorme augmentation des inégalités globales de revenus » dans le monde était « l’aspect le plus significatif – et le plus inquiétant – du développement de l’économie mondiale au cours des 200 dernières années ».
Or même le FMI a publié une étude qui montre que les inégalités sont l’une des causes importantes du « mystérieux » ralentissement tendanciel de la croissance mondiale et des profits mondialement. Selon cette étude, augmenter de 1 point de PIB les revenus des 20 % les plus riches fait baisser la croissance de 0,08 point dans les cinq années qui suivent. En revanche, augmenter de 1 point les 20 % les plus pauvres l’accélère de 0,38 point. La raison est que les plus pauvres consomment plus de ce qu’ils gagnent que les plus riches, qui, eux, épargnent plus. Cette publication en confirme d’autres. L’OCDE a calculé que «le creusement des inégalités a coûté plus de 10 points de croissance au Mexique et à la Nouvelle-Zélande, près de 9 points au Royaume-Uni, de 6 à 7 points aux États-Unis, à l’Italie et à la Suède»
Où commence donc tout ça ? Quand ils vous disent que le « coût » du travail est trop élevé, que votre salaire est trop haut et qu’il les empêche de faire des profits ce qui les empêche de faire des emplois…
Pour le smic à 1800 euros
Les rumeurs prêtent à Macron l’intention de céder au Medef et d’accepter des Smic par branches ou par régions, y compris en mettant fin aux « coups de pouce » de revalorisation. Cela entre dans sa logique.
La logique opposée, celle des 1800 euros n’est ni excessive, ni révolutionnaire, ni spoliatrice, c’est simple justice, et en même temps simple régulation économique et sociale : ni la droite ni l’extrême droite, ni le capitalisme ne mettront cela en place naturellement, mais la gauche doit le faire, et c’est son rôle, son idéal, son efficacité.
Des journalistes non informés mais qui se croient chargés d’informer osent écrire d’un trait de plume que « la hausse du smic est une « solution simpliste ».
C’est d’autant plus facile et rapide à faire, en échappant aux pressions des lobbys, que la hausse du smic et des minimas sociaux dépend du gouvernement. Cela ne suffira pas mais cela donnera confiance tout de suite à des millions de gens sur le fait que leur vie change, que le nouveau pouvoir vraiment de gauche, agira pour eux.
Les actionnaires et financiers, et leurs 95 % de médias, organiseront une campagne immédiate contre cette mesure, mais cela aura l’avantage d’être clair : dans une bataille droite, Macron, Medef, banques, contre la gauche au pouvoir, la vie politique nationale se réorganisera, camp contre camp, salariat contre patronat et la suite des choix politiques que nous proposerons obtiendra un intérêt massif et un appui populaire.
En 2016, un salarié payé au SMIC pour un temps plein (35 h hebdomadaire, 151 h 66 mensuel) touche moins de 1.150 euros net par mois, 1 466,62 euros brut, ce qui porte le Smic annuel brut à 17.600 euros.
Il a été revalorisé au 1er janvier 2017 de seulement + 0,6 % pour passer à 9,67 euros brut (contre 9,61 euros en 2015) Pour rappel, en 2015, la revalorisation a été de 0,8 % (contre +1,1 % en 2014). En vérité, les gouvernements Hollande, Ayrault, Valls ont gelé le Smic aux seules augmentations légales.
Le SMIC ou salaire minimum interprofessionnel de croissance est le salaire horaire en dessous duquel l’employeur n’a pas le droit de descendre pour rémunérer un salarié et ce, quelle que soit la forme de sa rémunération (travail à la durée, au rendement, à la tâche, à la pièce, à la commission ou au pourboire). Le SMIC assure aux salariés dont les salaires sont les plus faibles la garantie de leur pouvoir d’achat.
Nous refusons la façon dont Macron veut reproduire ce qui se passe en Allemagne ou des “mini jobs” sont proposés aux immigrés, réfugiés à 80 centimes de l’heure. Nous refuserons aussi que les patrons appellent des “travailleurs détachés” sur notre sol, pour casser ce smic brut, avec des salaires bruts plus bas, fixés au niveau de leur pays d’origine. Le Smic brut s’appliquera à nouveau à tout salarié travaillant sur le territoire français.
Nous refuserons aussi qu’existent des conventions collectives et accords de branches ou d’entreprises, ayant des minima conventionnels inférieurs au Smic. La loi l’emportera, pas de minimas conventionnels inférieurs.
Pareillement pour les indices de base du statut de la fonction publique. Tout revalorisation du Smic l’emportera aussitôt sur toutes les négociations : la loi l’emportera sur le contrat, et celles ci devront reprendre à partir des niveaux du smic. Ce qui aura pour effet de booster les négociations salariales annuelles obligatoires et pousser les grilles de salaire a la hausse.
Le Smic net – qui correspond au salaire que perçoit effectivement le salarié – est en effet obtenu en déduisant du smic brut les différentes cotisations sociales salariales : ce ne sont pas “de charges” ce sont des “cotisations” et du “salaire brut”. Cela ne fait pas partie (contrairement aux “théories” et vocabulaire courant en usage chez les libéraux) des impôts ni des prélèvements obligatoires puisqu’il s’agit d’une part du salaire mutualisée entre tous les travailleuses et travailleurs, mise dans un pot commun, les organismes – de droit privé – de la protection sociale, collectés et redistribués pour la protection sociale, familles, logement, chômage, maladie, accidents du travail, retraite.
|
Macron propose de réfléchir sur la « participation » et « l’intéressement » : ce sont des mesures qui prétendent faire profiter les salariés des « bons résultats » d’une entreprise. Ce procédé est déjà obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés quels que soient leur secteur d’activité ou leur effectif.
La participation concerne tous les salariés, quel que soit leur contrat, elle se conclue par accord avec les délégués syndicaux, le CE et en outre l’accord doit être approuvé par les 2/3 du personnel. Le calcul de la participation se fait selon une formule complexe. Les sommes sont bloquées pendant 5 ans. S’il n’existe pas d’accord dans l’entreprise, elles sont même bloquées pendant 8 ans. La participation permet à l’employeur et aux salariés de bénéficier d’avantages sociaux et fiscaux. Ainsi, pour l’employeur, les sommes de la réserve de participation : - sont exonérées de la taxe sur les salaires ; - sont déductibles de l’impôt sur les sociétés ou sur le revenu. La réserve de participation est exonérée de cotisations sociales et patronales. Pour les salariés, les sommes dues au titre de la participation : - sont exonérées de cotisations sociales ; sont soumises à la CSG et la CRDS après un abattement de 5 % ; - sont non imposables. |
Pourquoi choisir la participation, et ne pas augmenter les salaires là où il y a en a le plus besoin : 23,6 % des salariés des TPE, (moins de 11 salariés, 18,6 % des salariés) sont rémunérés au Smic : commerce, restauration, tourisme, jeunes de moins de 25 ans, CDD, saisonniers, peu ou pas diplômés, femmes précaires, temps partiels… 27,4 % des employés et 20,2 % des ouvriers non qualifiés sont au Smic !
La participation n’est pas du salaire, pas davantage que l’intéressement : elle ne donne pas matière à cotisations, et ne contribue pas à remplir les caisses de protection sociale au même titre que le salaire brut. Elle est difficile à mettre en oeuvre et longue à donner des fruits. Au contraire, la hausse des salaires à cet effet bénéfique entre tous, d’aider à l’équilibre des comptes de la sécurité sociale puisqu’une partie de l’augmentation du salaire brut va alimenter notamment les caisses de retraite et d’assurance- maladie.
En les employeurs jouent à faire varier la participation et l’intéressement, en présentant leurs comptes de résultats différemment, en investissant, vendant, échangeant ou en rachetant leurs actions, être leurs différentes sociétés, au sein du groupe etc. ce qui fait qu’un salaire est plus « sûr ».
Le sens des 1800 euros
Et la hausse du Smic a un effet en cascade : elle bouscule la hiérarchie des grilles de salaires, niveau coefficient, échelon, et obligeant à renégocier, concerne tous les salariés et pas seulement ceux du bas de l’échelle. Ce que ne fera pas la participation !
Faire tout de suite du bien aux gens. Attacher la sympathie populaire au gouvernement de gauche unie que nous voulons substituer au gouvernement de droite Macron. Etre capable ainsi de résister aux campagnes de matraquage d’opinion anti hausse du Smic que les 95 % des grands médias des 7 milliardaires ne manqueront pas de faire aussitôt. (Avant qu’on ait le temps de faire une loi réglementant la presse, empêchant les concentrations, et le cumul des titres de journaux et des marchés publics, et privés : des mesures de démocratisation institutionnelle vers une 6° République).
Le Smic à 1800 euros c’est le meilleur gage de popularité, de dynamique garantie pour marcher ensuite par la loi vers le retour de la retraite à 60 ans, vers les 32 h, vers un salaire maxima à 20 fois le smic.
Macron a « l’argent au cœur », nous voulons « le social au cœur », c’est s’appuyer sur les acteurs principaux du pays, les salariés soit 93 % des actifs. C’est donner des garanties liées aux jeunes, aux chômeurs, aux handicapés, aux retraités, avec la hausse des minimas sociaux.
C’est pour cela que le Medef veut légiférer pour ôter au gouvernement la capacité de fixer le taux du Smic – à la façon dont ils lui ont déjà enlevé le contrôle de la monnaie et des banques. Il voulait une commission d’experts, puis des mécanismes incontournables à la façon dont l’ordo libéralisme a fixé des « principes » (inflation à 1,5 %, déficit à 3 puis 0 %, dette à 60 %). Le choix politique de peser sur les salaires au nom d’impératifs économiques supérieurs fixés par les patrons, (ses profits et dividendes) c’est un rêve de Medef.
Nous sommes au contraire national avec un Smic brut à 1 800 € (ce qui était la proposition de la Cgt, laquelle a ajusté en 2016 sa revendication à 2000 euros) par mois pour un travail à temps plein ce qui signifie un Smic net de 1 386 € par mois ce qui n’est pas très élevé contrairement aux cris du patronat.
En 2016, le Smic brut s’élève à 1 467 € par mois : il augmentera donc de 333 €
Le Smic net s’élevant alors à 1 129 € par mois : il augmentera donc de 257 euros
Le Smic n’a pas eu de coup de pouce depuis 10 ans, à l’exception de celui, dérisoire, de 0,6 % au 1er juillet 2012 : 6,46 € par mois et l’équivalent de moins de deux baguettes de pain par semaine. Le pouvoir d’achat du Smic n’a pas augmenté depuis 2007.
Or les femmes représentent 80 % des salariés au Smic et sont particulièrement touchées. Entre juin 2012 et mai 2016, le Smic a augmenté de 11,5 %, quasiment la même évolution que celle de l’indice des prix à la consommation : + 10,5 %.
Ce retard doit être rattrapé.
Objectif carnets de commande remplis
Nous fixerons donc l’objectif de permettre, tout d’abord, aux salariés de vivre décemment s’ils travaillent à temps plein mais aussi s’ils travaillent à temps partiel. Le seuil de pauvreté étant égal à 60 % du revenu médian, soit 975 euros par mois pour une personne seule, nous voulons déjà sortir 1,9 million de travailleurs… des travailleurs pauvres.
A ceux qui disent c’est impossible, rappelons-leur qu’en juin 1968 le Smig est devenu Smic en augmentant de 33 % et le Smag est aussi devenu le Smic en augmentant de 55 %. Les entreprises s’en sont trouvées mieux !
La hausse des salaires est consommée immédiatement par les salariés les plus pauvres. A l’artisan qui se plaindra d’avoir du mal à augmenter son seul compagnon, on lui dira, que si tous les salariés sont augmentés en même, certains feront enfin réparer leur gouttière, ce qu’ils avaient différé jusque-là. Pareil pour le petit éditeur qui souffre de ne pouvoir augmenter ses neuf salariés, il vendra plus de livres.
Certains économistes font encore allusion aux hausses du smic de 1981, et expliquent que cela a facilité les importations et non pas les industries françaises, « la Lire italienne de l’époque, plus basse, ayant facilité la chaussure italienne contre la française ». Mais ils devraient noter qu’aujourd’hui, il existe l’euro ! Et 85 % des échanges de la France sont avec le reste de l’Union européenne.
L’élément moteur de la croissance économique, reste l’augmentation de la consommation malgré la pression ininterrompue sur les salaires. Immédiatement des millions de salariés achèteront massivement des produits de première nécessité. C’est cela, les fameux « carnets de commande » des entreprises.
L’augmentation du Smic mettrait de l’énergie dans ce moteur et permettrait aux PME, notamment à celles qui sont indépendantes des grands groupes, de trouver un débouché à leur production et d’embaucher. On ne peut calculer le coût de l’augmentation du Smic sans tenir compte de la dynamique qu’elle entrainerait. On connaît le résultat tout au long des 4 dernières années : car le Smic a été bloqué et le chômage a quand même augmenté. Mais une hausse du Smic donnerait des retours en cotisations, impôts, commandes.
Arrêter de remplir le tonneau percé de notre ennemi la finance
Il existe au total 600 milliards d’avoirs français dans les paradis fiscaux : cet argent détourné de l’activité économique, par « fraude fiscale », ou par « optimisation fiscale », c’est le tonneau des Danaïdes ou fuient nos emplois, notre industrie, nos services publics.
Le taux de marge des entreprises (leurs bénéfices) continue d’augmenter et atteint 31,4 % son plus haut niveau depuis 2011. Les dizaines de milliards d’euros accordés aux entreprises par le CICE et les allégements de cotisations sociales ont avant tout servi à augmenter ce taux de marge.
Cette augmentation des taux de marge des entreprises françaises, voulue par Macron, ne va pas à l’investissement productif (une augmentation de 1 % seulement en 2015) mais va financer les dividendes, la spéculation financière et finit dans les paradis fiscaux. L’évasion fiscale représente une ponction considérable, de l’ordre de 80 milliards d’euros tous les ans, pour les ressources de l’État.
Il est facile de comprendre que tout ce que l’on récupérera, on va le voir, par réforme fiscale et réforme bancaire, de cet argent volatil, nous aidera à « sortir de la crise » qu’il provoque. Mais le plus simple et le plus direct pour « redistribuer » c’est, à la base, par le salaire versé pour le travail qui permet à ces sommes d’exister, captées, détournées.
Car s’en prendre à la « bulle financière » c’est protéger l’humanité d’autres crises terribles qui menacent. Nous ne sommes pas les seuls, mais de plus en plus nombreux, à poser cette question centrale de réhabiliter le travail et de taxer les dérives du capital.
En Allemagne, le Smic, ça marche
« Le smic, c’est le chômage ». C’était l’argument de la campagne électorale d’Angela Merkel en septembre 2013 : mais elle a perdu l’élection et obtenu 8 sièges de moins et 800 000 voix de moins que le total gauche SPD, Die Linke, et les Grünen. C’est parce que les leaders de la gauche allemande n’ont pas voulu faire une coalition ensemble qu’Angela Merkel est restée Chancelière : le Spd a préféré gouverner avec la droite qu’avec la gauche (ce qui s’est mal terminé pour lui aux élections suivantes en septembre 2017), mais, au moins a t il mis dans la balance la création d’un Smic allemand.
Les économistes libéraux prévoyaient des licenciements massifs si ce Smic était mis en place. Ils se sont encore trompés !
Le patronat allemand prétendait que cela aboutirait à la suppression de 200 000 emplois en 2016. Contrairement à ces mauvaises prophéties, le salaire minimum en Allemagne fixé à 8,50 euros de l’heure, depuis le 1er janvier 2015, n’a ni pénalisé l’emploi ni favorisé l’inflation, selon uneétude de l’IAB, institut de Nuremberg de recherche pour le marché du travail et l’emploi. L’institut a interrogé environ 16.000 entreprises, 20 % seulement ont affirmé avoir été affectées directement ou indirectement par la mise en place du salaire minimum. Seulement 18 % des entreprises ont augmenté le prix de leurs produits ou services. Seules 4,7 % des entreprises, soit moins de 1 entreprise sur 20, ont choisi de réduire leur personnel.
Voilà une expérimentation grandeur nature en faveur du Smic dont Macron devrait s’inspirer au lieu, chaque fois, de cherche dans un autre, pays ce qu’il de pire comme exemple.
La même étude montre que de nombreuses entreprises, par contre, ont tenté de déroger au Smic pour payer moins leurs salariés : apprentis, stagiaires et chômeurs chroniques, peuvent, temporairement, percevoir moins de 8,50 euros de l’heure. Beaucoup d’entreprises ont opté pour la sous-traitance, le CDD ou la réduction des heures de travail. Et enfin se sont multipliés les « travailleurs détachés » qui sont de facto une fraude aux Smic.
Ce smic doit être adopté par tous les employeurs, hormis ceux évoluant dans certains secteurs, ayant signé des accords préalables. Les stagiaires et les personnes embauchées suite à un chômage de longue durée, ne sont pas pris en compte pour ce smic. Mais il a augmente els salaires pour 3,7 millions de travailleurs en 2015 et pour 4,7 millions de travailleurs en 2017.
Le SMIC allemand doit être réajusté tous les deux ans, en fonction des prix du marché. Il est passé à 8,84 brut de l’heure. Et la grande nouvelle c’est qu’il a dépasse celui de la France et atteint 1498 euros.
Ce qui n’empêche pas les patrons français de prétendre que « la France est malade du smic » et Macron de leur tendre l’oreille attentive.
Salaires minimum dans l’Union européenne et aux Etats-Unis
L’Allemagne n’est pourtant pas seule à avoir introduit une loi pour le salaire minimum : 22 États membres de l’UE sur 28 ont un Smic. Seuls Chypre, Danemark, Autriche, Italie, Finlande et Suède n’ont pas de Smic.
En 2017, les pays ayant le Smic horaire le plus élevé sont le Luxembourg, avec 1998,59 euros, l’Irlande avec 1563,25 euros, la Belgique avec 1531,93 euros, les Pays-Bas avec 1551,60 euros, l’Allemagne, on l’a vu avec 1498 euros, et la France, en 7° position avec 1480,27 euros. (Le Smic du Royaume uni atteint 1396,90).
Ensuite viennent l’Espagne 825,65 €, la Slovénie 804,96 €, Malte 735,63 €, la Grèce 683,76 €, le Portugal 649,83 €, l’Estonie 470,00 €, la Pologne 453,48 €, la Slovaquie 435,00 €, la Croatie 433,35 €, la Hongrie 411,52 €, la République tchèque 407,09 €, la Lettonie 380,00 €, la Lituanie 380,00 € , la Roumanie 275,39 €, la Bulgarie 235,20 €.
L’Italie a pris la décision d’instaurer un Smic, elle aussi.
Première réflexion, en 7° position, la France, paie 10 ans de blocage du Smic.
Mais pour rendre la comparaison possible, Eurostat a calculé ce que représentent les salaires minima allemands et français en standard de pouvoir d’achat. Résultat : 1443,17 euros de l’autre côté du Rhin contre 1391,18 en France. Le salaire minimum allemand est donc plus élevé que le Smic français ce qui contredit bien des idées macroniennes reçues.
Ensuite, l’écart est de 1 à 9 entre le smic luxembourgeois et le smic bulgare. Encore faut-il les comparer en « parité de pouvoir d’achat » : là les écarts sont plus resserrés, de 1 à 5, et surtout la France se trouve en 12° position (situation qui n’est compensée que de façon relative grâce à de meilleures prestations sociales, liés au cotisation sociales… que Macron veut supprimer !) !
Dans ce contexte, l’augmentation du Smic que nous préconisons en France sera « en phase » et aura un effet stimulant sur la mobilisation de tous les salariés européens qui ne supportent plus l’austérité sans fin et l’accroissement inouï des inégalités.
Revendiquer un Smic européen, même en tant que mot d’ordre, comme « perspective » unificatrice, joue un rôle : cela sert à combattre le « dumping social » et donc les déplacements frauduleux de population salariée type travailleurs détachés. Si le niveau des salaires se rapproche dans l’UE, à quoi bon s’exiler ? A quoi bon délocaliser ?
On peut et on doit « aimer » le plombier polonais, le maçon portugais, l’ouvrier du bâtiment letton, le sidérurgiste tchèque, le chauffeur bulgare, le docker maltais, les aimer au point de vouloir qu’ils gagnent autant qu’un salarié français sans que celui-ci perde son niveau de salaire. Cela revient à lutter pour un « Smic européen » aligné progressivement et de façon dynamique par le haut.
Encore de l’anti-Macron !
Pour un Smic unique européen :
En Europe, encore, où l’essentiel de notre sort économique se joue, (c’est pourquoi nous sommes favorables à des États unis d’Europe, à une Europe fédérale, mais avec harmonisation fiscale et sociale « par le haut », pas par le bas à la façon Macron), non seulement notre salaire brut annuel moyen est proche de celui de l’Europe des 27 et inférieur à celui de l’Europe des 15, mais les écarts avec les plus « compétitifs » diminuent de moitié si l’on tient compte du pouvoir d’achat respectif des salaires, et sont encore plus réduits si l’on « rapporte les coûts salariaux à la valeur ajoutée produite pour obtenir une mesure de la productivité de travail » ! Si l’on introduit une dimension temporelle depuis dix ans, on constate qu’une dynamique de rattrapage est à l’oeuvre.
Car si les écarts sont grands (de 1 à 9) entre les salaires moyens de l’UE des 15 et ceux des 10 nouveaux entrés en 2004, ils s’atténuent de 1 à 5 si l’on compare en « parité de pouvoir d’achat »,
Ils sont divisés de moitié lorsque les salaires sont exprimés en « unités de standard de pouvoir d’achat ».
Avec ce mode de calcul, le salaire moyen polonais qui était de 6,6 fois inférieur au salaire moyen britannique exprimé en euros n’est plus « que » 3,3 fois inférieur à ce même salaire exprimé en « unités de standard de pouvoir d’achat ».
Si ces écarts salariaux sont appréciés « par rapport à la valeur ajoutée produite pour obtenir une mesure de la productivité du travail », ils sont encore considérablement réduits.
C’est réaliste (et nécessaire) de combattre pour un Smic européen. De même qu’il est réaliste de combattre pour un droit du travail européen aligné vers le haut, selon le principe de faveur, et d’empêcher le « dumping social » que Macron, lui, veut généraliser. Le désordre de la pensée que Macron traine sur tous les sujets que nous sommes en train d’examiner, le chômage, l’emploi, les salaires, l’empêche d’avoir une quelconque vision à proposer contre les libéraux à l’Europe, il se situe même a leur tête, « premier de cordée ».
Pour mémoire, exemple et réflexion, il existe une tentative de quasi Smic mondial… pour les marins. Étonnant, non ? Et avant-gardiste. Reconnu par seulement 48 pays, il a été négocié entre la Fédération patronale des armateurs et la Fédération internationale des transports, et installé en 1994. Il est réajusté tous les deux ans en « parité de pouvoir d’achat » et il atteignait 600 dollars à son origine. Sur les 48 pays signataires (ce n’est pas assez) 18 pays sont européens : il existe donc une ébauche de Smic européen, au moins dans une branche.
Ce n’est qu’un exemple de ce qui pourrait être (mieux) fait dans bien des secteurs : par exemple les routiers. Si la perspective en était politiquement tracée, (quand nous aurons minorisé et battu Macron c’est ce que nous ferons) un calendrier de négociations et de lois pourrait être planifié et mis en œuvre par branches puis par régions, puis par pays, dans l’Europe des 27 pour aligner les différents Smic progressivement au niveau le plus élevé, d’abord en parité de pouvoir d’achat puis en euros.
Dés qu’une telle perspective existe, délocalisations et « principe du pays d’origine » (ex-directive Bolkestein devenue à 80 % la directive MacCreevy, puis des « travailleurs détachés ») perdraient de leur intérêt : pourquoi emmener les machines là-bas s’il est prévu que le salaire de là-bas rattrape celui d’ici ? Pourquoi s’exiler pour venir travailler de Pologne en France, si le salaire polonais est programmé pour un même Smic européen ?
Si le seul horizon d’un Smic européen était fixé, par exemple pour 2025 ou 2030… tout change en Europe : le dumping social perd de son intérêt, délocalisations et trafic de main d’œuvre sont condamnés à reculer à terme… Ensuite, négocier par branche, par paliers, par zone géographique, par groupes de pays, dans la perspective d’un Smic, cela s’est toujours fait ainsi : le Smig en France a pris du temps avant de devenir le Smic, les abattements de zones ont été supprimés et nationalement le Smic a été aligné, mensualisé, hier sur 173 h 33 h, puis sur 169 h, aujourd’hui sur 151 h 66.
En 2004, le programme du Parti socialiste défendait encore « l’harmonisation progressive des droits sociaux au niveau le plus haut et l’instauration d’un salaire minimum européen et l’Europe des 35 h« . Il appelait aussi à une « nouvelle hiérarchie des règles internationales, des droits environnementaux, sociaux et humains devant être prioritaires sur le droit des affaires et de la concurrence ». Il obtint alors 30 % des voix aux élections européennes du 13 juin 2004. Hélas, il renonça à cette juste et populaire position lors du débat, en 2005, sur le « TCE » (traité constitutionnel européen) ce qui lui valut d’en payer le prix électoral en 2007. Revenu au pouvoir en 2012, il renonça, avec Hollande et Macron, a tout objectif progressiste et il perdit les élections européennes de 2014, où le Front national fut pour la première fois en tête.
Il faut tirer l’humanité et l’Europe vers le haut, et non pas l’abaisser au nom de la prétendue « concurrence » et du pseudo « libre-échange ». « L’OIT et l’OMC doivent devenir deux organismes agissant à parité de façon à introduire le droit du travail comme élément constitutif du droit de la concurrence ». (In « Avis » du Conseil économique et social, pour Seattle, nov. 1999). L’OMS (organisation mondiale de la santé) et une OME (organisation mondiale de l’environnement) devraient voir, au même titre que l’OMC, leurs recommandations s’imposer, et susceptibles de sanctions.
Qui ne voit pas la dynamique salariale possible dans l’Europe des 15 puis des 25 et 27 ? Qui croit que l’impressionnante envolée de la croissance en Chine, Inde ou en Russie ne va pas déboucher sur des revendications des salariats de ces pays ? Le choix est partout entre une politique qui fait régresser et épouse les pires déréglementations de la mondialisation financière libérale et une politique qui contrecarre les ravages antisociaux, les pillages des richesses produites par les salariés, qui défende protection sociale et environnement.
Faute d’ouvrir de telles perspectives, ce sont celles du désespoir et du nationalisme, de la « concurrence internationale » qui resurgissent : l’UE après le Brexit s’en trouve menacée d’éclatement.
Raisons de plus pour rompre avec Macron et l’étroitesse de ses visions de start up européennes, de baisse du cout du travail, de soumissions aux critères des libéraux et des banques.
La compétitivité ne se limite pas au coût du salaire
L’argument est toujours le même : « votre hausse du smic à 1800 euros portera atteinte à la compétitivité ». Mais la compétitivité par les coûts des produits ne se limite pas au coût du salaire, elle doit intégrer le coût du capital, celui des dividendes distribués.
Et tout dépend encore des choix des 1000 entreprises de plus de 1000 salariés qui produisent 50 % du PIB, et des 80 % des PME, PMI, ETI, nous ne cessons de le dire, en dépendent. Et le million de petites entreprises TPE de moins de 11, dépendent aussi davantage de celles d’en-dessus, des donneurs d’ordre que de la part direct des salaires dans leur chiffre d’affaires. Ces choix c’est à l’état social, et stratège de les encadrer,
La compétitivité est liée à la qualité, au niveau de gammes des produits et donc aux investissements de recherche et développement réalisés par les entreprises.
Et, de ce point de vue, notre pays est très en retard sur l’Allemagne. En 2010, les entreprises allemandes ont consacré 31 milliards d’euro à la recherche- développement, les entreprises françaises seulement 15 milliards. Entre 2001 et 2010, trois fois plus de brevets ont été déposés en Allemagne qu’en France. Les grandes sociétés françaises ont fait le choix d’augmenter la distribution de dividendes plutôt que d’augmenter la recherche-développement.
Cette dernière s’élevait à 42 % des dividendes versés en 1992 et seulement à 25 % en 2010. Comment s’étonner, dans ces conditions, du manque de compétitivité de l’économie française ? Le rôle de l’État est déterminant pour remédier à cette situation. Verser 61 milliards de crédit d’impôts sans « contrepartie », sans contrôle des embauches correspondantes, c’est du « laisser faire », et ce laisser-faire, on en a le résultat, employeurs et actionnaires n’ont pas embauché mais spéculé.
Et la responsabilité du patronat français, du Medef, de ceux là meme qui ont mis en place Macron, est terrible ! C’est le plus rapace, le plus assisté, toujours à se plaindre toujours à réclamer, toujours a menacer, mais le plus médiocre quant aux résultats obtenus.
La compétitivité « hors coût » est, enfin, très importante. Cette compétitivité passe par les infrastructures, les transports, l’enseignement, les services publics et donc par les investissements publics. Le rôle de l’État, là encore, est déterminant. Les 61 milliards donnés l’ont été à court terme au secteur privé au détriment du secteur public – ce qui à long terme affaiblira l’environnement des entreprises.
Cette hausse du smic à 1800 euros va t elle « nous affaiblir dans la mondialisation » ?
S’il y a bien une bêtise répandue, c’est celle là : a-t-on remarqué que la précarité et les bas salaires étaient s’installés dans des secteurs qui ne sont pas soumis à la concurrence internationale ? C’est le cas pour les 850 000 salariés de la restauration, de même que pour les 1,1 million de salariés du bâtiment, et pour quantité de services aux personnes.
Le secteur ou il y a la précarité la plus grande, le turn over le plus important, les durées du travail les plus longues, les flexibilités les plus fortes, les maladies professionnelles et la pénibilité parmi les plus élevées, et les salaires les plus bas… n’est pas soumis a la compétition internationale, ce sont les HCR (hôtels, cafés, restaurants).
Comment les « majors » du bâtiment, les Bouygues, Vinci, Eiffage, Lafarge, extraient-ils tant de milliards d’euros des… travailleurs du bâtiment ? Eux non plus ne sont pas soumis à la mondialisation ! Au contraire, ils l’organisent à l’inverse, en faisant venir des centaines de milliers d’immigrés sous-payés, et « détachés » sans cotisations sociales de notre niveau.
En matière de concurrence internationale et d’emploi, les entreprises ne sont pas, en France, défavorisées par le poids de prétendues « charges sociales » ! Surtout quand la France est au 7° rang du smic européen au 12° rang en pouvoir d’achat.
Des milliards d’exonérations de cotisations sociales ont été accordées depuis vingt ans aux entreprises françaises : elles n’ont nullement débouché sur la baisse du chômage. Pas plus avec le CICE de 61 milliards. Toues les études montrent que cela a été une gabegie, un fiasco total.
On pourrait faire autrement : « - Haussez les salaires, baisser le poids des dividendes » et les entreprises françaises resteraient aussi « compétitives » pour le coût de leurs produits, non ? Au lieu que ce soit les salariés qui se serrent la ceinture, ce serait les capitalistes qui le feraient. Envisageable, non ?
Guillaume Duval d’Alternatives économiques l’écrivait : « Si, à niveau de richesse comparable, le chômage est le plus important chez nous que chez nos voisins, c’est justement parce que ceux qui ont un emploi en France, sont particulièrement productifs. »
Rajoutons : c’est aussi parce que leurs employeurs sont particulièrement rapaces.
Ce sont en effet, les salariés français qui sont les plus productifs au monde selon les chiffres du BLS, Bureau of Labor Statistics, organisme américain peu suspect de sympathie syndicale, ni de francophilie. « Un Français produit 71 900 dollars de richesse en moyenne au cours de l’année 2005, certes moins que les 81 000 dollars produits par un salarié américain mais beaucoup plus que les 64 100 dollars d’un Anglais, les 59 100 des Allemands, les 56 300 dollars des Japonais ». (Article dans Libération le 7 mai 2007 : « Les Français ne sont pas des paresseux »).
Aux Etats-Unis, la Californie (devenue, en 2016, la 6ème puissance économique mondiale, devant la France) a décidé d’augmenter son salaire minimum de moitié, à 15 euros de l’heure à l’horizon 2022. L’État de New-York s’est fixé le même objectif pour 2018. Les démocrates d’Hillary Clinton, il est vrai sous la pression de Bernie Senders, ont proposé proposent une hausse de 44,7% du Smic américain en le portant à 15 dollars. Six états américains ont vote en faveur de cette proposition en novembre 2016, dont la Californie, New York, le Michigan, le Wisconsin…
Qui peut prendre de haut, qui a des arguments pour refuser notre proposition circonstanciée anti Macron et anti Medef : augmenter massivement les salaires ?
Peu importe qu’il n’y ait aucun risque de « délocalisations », le chantage de la propagande totalitaire façon Medef et Macron est utilisé quand même : il faut flexibiliser l’emploi pour « s’adapter à la mondialisation ». Il faut « adapter le droit du travail aux besoins des entreprises » (F Hollande conférence de presse septembre 2015). Or 85 % de nos échanges sont en Europe, et les secteurs concurrencés par la « mondialisation », ne sont pas si nombreux ni si importants qu’on ne puisse agir.
Elle a bon dos, la mondialisation !
Si nous pouvons renverser Macron et sa politique, nous proposerons d’augmenter le smic à 1800 euros et par exemple d’interdire dans toute entreprise, sauf dérogation préalable et exceptionnelle de l’inspection du travail, plus de 5 % de CDD ou d’intérim : la précarité reculerait aussi rapidement qu’elle a progressé.
Si au lieu de reprendre le discours fataliste de la précarité induite par la mondialisation, la prochain quinquennat réglementait le temps partiel, réinstaurait un contrôle de la puissance publique sur les licenciements abusifs et boursiers, encadrait la sous-traitance et prenait des mesures législatives pour rapprocher la durée réelle du travail de la durée légale (en rendant les heures supplémentaires plus coûteuses que l’embauche et en instaurant les deux jours de repos consécutifs pour tous), le progrès de la précarité s’inverserait.
En quoi la mondialisation nous empêcherait-t-elle de hausser le smic et de mieux partager les richesses… en France ? Le présent plaidoyer écarte tous les mauvais arguments de la propagande libérale et de l’horreur économique qu’elle impose à notre monde.
Qu’est-ce qui nous empêche de majorer les impôts justes, c’est-à-dire les impôts sur le revenu, progressifs et redistributifs (et l’impôt sur la fortune, l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur les profits pétroliers) et de baisser les impôts injustes (TVA, taxe d’habitation, redevances diverses) ?
Qu’est-ce qui nous empêche de majorer les salaires, de restaurer ainsi nos caisses de protection sociale et de relancer la consommation, l’économie du pays ? Sinon l’égoïsme du patronat et des banquiers français ?
Rien en Europe, rien dans le monde ne nous contraint à développer la précarité, à attaquer le droit du travail et à liquider nos services publics…
C’est criminel de favoriser les 363 000 familles riches payant l’impôt sur la fortune (ISF), et aucune exigence « mondiale » ne nous l’impose : même pas le chantage à leur « départ », car s’ils fraudent ou fuient, nous les rattraperons, aucun n’échappera au fisc, aujourd’hui chaque centime est localisable, identifiable dans n’importe quelle banque de la planète.
En quoi, alors, le refus d’augmenter le Smic serait-il dicté par les impératifs de la mondialisation ?
La France est le deuxième ou troisième pays importateur et exportateur de capitaux, tant la confiance mondiale dans son économie est grande.
Cinquième puissance mondiale, jamais elle n’a été aussi riche : il serait possible, redisons-le face aux chantage a la mondialisation, de redistribuer ces richesses – par le smic à 1800 euros, les 32 heures, la retraite à 60 ans – pour sortir nos banlieues du chômage et de la misère, relancer l’emploi, soutenir la santé pour tous, l’école, la formation, la recherche, la culture et l’ensemble des services publics.
Ce n’est pas la concurrence internationale qui nous impose des choix politiques contraires, mais une conversion idéologique au néolibéralisme régnant outre-Atlantique et à l’ordo-libéralisme allemand.
Ce ne sont pas les effets implacables de la mondialisation qui expliquent le développement de la précarité en France depuis vingt ans, mais des choix politiques.
D’ailleurs, on va le vérifier, Macron fait du zèle, plus que ce que les libéraux européens lui demandent ; on va le prouver, « les recommandations européennes du 27 mai 2017 concernant la France sont bien en deçà des ordonnances scélérates « anti travail » que Macron impose à notre pays.
Oui l’état peut beaucoup. Oui les lois et les décisions juridiques peuvent s’imposer aux entreprises. Oui, la puissance publique peut encadrer celles ci (puisque le patronat en est incapable). Le volontarisme mérite un éloge.
Prenons l’exemple, de l’entrée des femmes sur le marché du travail dans les années 1970, progressivement et assez rapidement, mais à temps plein, jusqu’à aujourd’hui.
Si un changement est intervenu, si, aujourd’hui, 85 % des temps partiels sont dévolus à des femmes à 80 % non qualifiées, c’est essentiellement à la suite de mesures juridico-politiques.
À la veille des élections législatives de 1993, Pierre Bérégovoy croyait pouvoir baisser le taux de chômage en autorisant 50 % d’exonérations de cotisations sociales pour tout emploi à temps partiel. Même Édouard Balladur, en lui succédant, trouvera la mesure excessive et ramènera l’exonération à 30 %. Mais le mal était fait, et l’on passa, entre 1993 et 1995, de 11 % de temps partiels à 17 % : des métiers entiers sont concernés comme dans la branche de la grande distribution qui se rue sur l’aubaine.
On ne dit plus « caissier » mais « caissière » et le temps partiel y devient la règle avec tous ses aléas (des journées d’une amplitude de 12 heures pour 6 heures réellement payées au Smic).
De même, ce sont les « allers retours » juridiques sur la définition et l’usage des CDD, entre les lois Auroux, les lois Chirac-Séguin (1986-1988), les lois Rocard (1989), la loi quinquennale Balladur-Giraud (janvier 1994) qui ont facilité leur expansion. La loi Sapin du 14 juin 2013, fait mine de modifier cela et impose des temps partiels « plancher à 24 h par semaine », mais les lois Macron (8 août 2015) puis El Khomri (12 aout) suppriment à leur tour cela. Il s’agit bel et bien de mesures politiques successives, pas de fatalité ni d’impératifs catégoriques économiques.
Pareillement, le travail de nuit des femmes, a été imposé par la Cour de justice européenne en 1990, au nom « de l’égalité professionnelle femmes-hommes ». Le ministère du travail français en 1992 avait cédé à tort sur ce point, à la pression de l’UE. Cette flexibilité cruelle a créé de l’emploi. Pourtant cette égalité professionnelle aurait du se réaliser en limitant encore le travail de nuit des hommes aux seules contraintes absolue où il était impossible de faire autrement. Et voilà, depuis plus de 25 ans, il y a un million de salariés de plus la nuit et ce sont des femmes. Et il y a davantage de souffrance au travail (le travail de nuit ça nuit et ça fait mourir plus tôt) et aussi davantage de chômage.
Dans un livre collectif de débat Travail flexible, salariés jetables [1], le mensuel Alternatives économiques jugeait bon d’écrire qu’il n’y avait que « Gérard Filoche qui croyait que la lutte contre la précarité et la flexibilité pouvait se régler par des mesures juridiques ». C’est pourtant bien de cette façon qu’elles se sont développées et, réciproquement, c’est par volontarisme politique que le gouvernement Jospin est parvenu, un temps, à les faire reculer avec les 35 h.
Quand on veut, on peut. Surtout quand les mesures qu’on prend vont dans l’intérêt de dizaines de millions de salariés. Quand elles vont à l’encontre, comme les mesures libérales a répétition de ces dernières décennies, elles échouent toutes.
Si, de 1997 à 2001, la France a accumulé les records de créations d’emplois et de baisse du chômage avec 2,1 millions d’emplois créés et 750 000 chômeurs en moins, si elle a connu une période de croissance plus importante que des pays de même niveau et si le taux de chômage des jeunes est passé de 28 % en 1997 à 18,7 % en 2000, c’est bien le résultat de mesures politiques et juridiques. Les trois années 1998-1999-2000, sous Lionel Jospin, sont les plus exceptionnelles de l’histoire du XXe siècle en matière d’emploi, de droit du travail, de développement du salariat et de recul de la précarité. Si bien que lorsqu’on souligne les reculs des trente ans écoulés, il faut préciser : en dépit de ces trois années-là. Au cours de cette période, la masse salariale a augmenté, les caisses de protection sociale sont devenues excédentaires, la précarité a même légèrement reculé (- 0,4 % environ), de même que les CDD (- 33 000, soit une baisse de 1,5 % entre mars 2000 et mars 2001), les temps partiels (- 0,6 %) et les emplois aidés (qui sont passés de 455 000 à 408 000), le chômage partiel a quant à lui fortement baissé (- 64 % en 1999). L’intérim baissait au début de 2001 mais il avait ré-augmenté au second semestre 2001.
Dans le mouvement socialiste mondial de l’époque, le gouvernement « rouge-rose-vert » de Lionel Jospin avait des caractéristiques plus avancées qui le distinguaient significativement des tenants de la « troisième voie » Clinton-Blair et aussi totalement opposé dans l’esprit et la pratique, à toute la politique conduite à partir de 2012.
Davantage proche de ce que fut le premier gouvernement de la gauche en 1981-1982, Lionel Jospin avait opéré certains choix volontaires que le reste de la social-démocratie européenne avait refusés : les 35 heures sans perte de salaire, des droits nouveaux du travail, le maintien des retraites, la couverture maladie universelle (CMU), l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour les personnes âgées…
En 2002, la France était alors, de façon relative, l’un des pays au monde les plus avancés socialement. La droite se plaignait qu’il y ait trop d’argent dans les caisses, et brocardait, tout le monde l’a oublié, la « cagnotte publique » du gouvernement Jospin. Selon la droite, il y avait trop d’argent dans les caisses ! Pas assez de dettes sans doute ?
Cette parenthèse heureuse a été refermée à partir de 2002 avec l’avènement d’une « droite décomplexée » appuyée par un patronat Medef « refondé », financiarisé, décidé à imposer un aggiornamento en matière de droit du travail.
Et c’est François Hollande trahissant tous les espoirs liés au retour de la gauche en mai juin 2012 qui a cassé tout cela, et sur certains points, le code du travail, de façon plus terrible que les droits de Chirac et Sarkozy.
Il faut pour résister à la mondialisation, non pas déréglementer mais au contraire un droit du travail strict, contrôle et sanctionné qui appuie et s’appuie sur le rapport de force social, et abroger pour cela la scélérate loi El Khomri de 2016.
Cette question du code du travail, de l’ordre public social ou non, aggravée par Macron, est maintenant un enjeu social, théorique, pratique, entre la gauche et la droite, elle a crée un fossé entre socialistes et ex-socialistes, ceux qui se sont adaptés quasi totalement aux théories libérales macroniennes, et ceux, la gauche socialiste qui se sont acharnés à essayer de sauver un minimum de transformations sociales.
Hollande lui, a choisi, avec Macron, de casser ce qu’avaient fait Léon Blum, François Mitterrand et Lionel Jospin en matière de réduction du temps de travail, des 40 h aux 39 h et aux 35 h. Macron a entrainé un certain nombre d’ex socialistes, vite désarçonnés, repentants mais trop tard. La gauche socialiste, avec le reste de la gauche maintient l’alternative : 1800 euros, 60 ans, 32 h, 5 % de précaires, pas de salaires supérieurs à 20 fois le Smic…
Travailler pour le prix des ouvriers chinois ?
On ne cesse de nous asséner qu’il faudrait baisser le coût du travail pour « adapter la condition salariale à la mondialisation » et cela, au moment où les salariés chinois ou coréens se soulèvent contre leurs conditions de travail et où les smic haussent aux USA, en GB et en Allemagne ?
Les Sud-Coréens, à force de grève et de conflits héroïques, sont passés en vingt ans d’une durée de travail de 55 heures à une durée légale de 40 heures – bien qu’on puisse soupçonner qu’elle est autant fraudée que la nôtre. Pourquoi faudrait-il, ici, revenir sur les 35 h vers les 39 ou 40 h ?
S’agit-il d’adopter le système Wal-Mart, la grande enseigne de distribution américaine qui, derrière le slogan « Buy American », revend surtout du « made in China » ?
Bien qu’elle dégage 11,2 milliards de dollars de bénéfices par an, l’entreprise interdit tout syndicalisme, méprise les droits de ses 1,8 million de salariés, ignore toute protection sociale et impose des salaires de misère. « À force d’importer de Chine des montagnes de T-shirts et de fours à micro-ondes, d’asphyxier le petit commerce et de tirer les coûts vers le bas, la modeste entreprise fondée en 1962 à Rogers (Arkansas) par Sam Walton n’a-t-elle pas déréglé l’American way of life ? » s’interroge Bertrand le Gendre [2]. Ce système n’a rien de « nouveau » ; il ne fait que pousser à l’extrême la rapacité d’une logique capitaliste classique. Wall Mart, c’est quoi comme « système » ? Celui des ordonnances Macron poussées au bout, une grande start up dérégulée.
Lawrence Summers, professeur à Harvard, démontrait il y a 20 ans déjà que le partage profit-salaire suscitait de plus en plus d’inquiétude et de mécontentement aux États-Unis : les salaires, qui absorbaient auparavant les trois quarts des revenus des entreprises n’en représentaient plus qu’un quart, l’évolution du ratio étant inverse pour les bénéfices et les intérêts.
Si les salaires, disait-il, ne suivent plus la croissance de la productivité, cet écart entre les revenus du capital et ceux du travail n’a rien à voir avec la mondialisation : « On ne peut pas imputer cette tendance aux entreprises qui dégageraient plus de bénéfices à l’étranger : les comptes nationaux qui tiennent compte uniquement des bénéfices des entreprises réalisés sur le territoire, montrent que les bénéfices ont atteint leur plus haut niveau dans le PIB depuis deux générations et continuent à croître. »
La hausse de la part des profits dans la valeur ajoutée est également pointée par un rapport de la Banque des règlements internationaux (BRI). Selon les deux auteurs de l’étude, ce ne sont ni la concurrence des pays à bas salaires en Europe de l’Est ou en Asie ni la dérégulation du marché mondial des capitaux qui expliquent cette pression accrue sur les salariés, mais l’accélération des innovations technologiques. Ce phénomène est à l’origine du renforcement du pouvoir de négociation des entreprises qui leur permet d’accaparer une part plus importante de la richesse produite. Ce ne sont pas les travailleurs ni leurs salaires qui sont en concurrence mais la rapacité des actionnaires des entreprises.
Quand on compare les salaires européens (85 % de nos échanges sont en Europe) il faut prendre les salaire bruts (donc cotisations sociales incluses). Alors on ne peut alors prétendre que le niveau des salaires Français est trop élevé et constitue un handicap pour l’économie française et son niveau d’emploi. Pas davantage si on augmente le Smic : car les effets bénéfiques interviendraient rapidement en relance de la consommation.
Cotisations sociales incluses, on l’a vu, le salaire brut annuel moyen des salariés français, est proche du niveau moyen des 25 pays européens ! En matière de concurrence internationale et d’emploi, les entreprises ne sont pas, en France, défavorisées par le poids de prétendues « charges sociales » ! De surcroît, des milliards d’exonérations de cotisations sociales ont été accordées depuis vingt ans aux entreprises françaises : elles n’ont nullement débouché sur la baisse du chômage.
On pourrait faire autrement : « - Haussez les salaires, baisser le poids des profits » et les entreprises françaises resteraient aussi « compétitives » pour le coût de nos produits, non ? Au lieu que ce soit les salariés qui se serrent la ceinture, ce serait les capitalistes qui le feraient. Envisageable, non ?
Guillaume Duval l’écrit : « Si, à niveau de richesse comparable, le chômage est le plus important chez nous que chez nos voisins, c’est justement parce que ceux qui ont un emploi en France, sont particulièrement productifs. »
Rajoutons : c’est aussi parce que leurs employeurs sont particulièrement rapaces.
Ce sont en effet, les salariés français qui sont les plus productifs au monde selon les chiffres du BLS, Bureau of Labor Statistics, organisme américain peu suspect de sympathie syndicale, ni de francophilie.
« Un Français produit 71 900 dollars de richesse en moyenne au cours de l’année 2005, certes moins que les 81 000 dollars produits par un salarié américain mais beaucoup plus que les 64 100 dollars d’un Anglais, les 59 100 des Allemands, les 56 300 dollars des Japonais ». (Article dans Libération le 7 mai 2007 : « Les Français ne sont pas des paresseux »).
Oui, nous méritons un smic à 1800 euros. Et c’est ce niveau de smic qui relancera et sauvera notre économie, qui fera du bien, qui redonnera le moral, réduira les inégalités, obligera la finance et le patronat à partager…
Lutter contre les contrefaçons sociales et salariales…
Le 25 juillet 2006, sur la muraille de Chine, on me proposait un T-shirt à 10 yuans : je refuse. À 5 yuans, je refuse. À 2 yuans, j’accepte. Deux yuans, c’est 20 centimes d’euro. Je reviens à Paris : le même T-shirt au Forum des Halles vaut 20 euros. Que dire ? Le Yuan est sous-évalué. L’ouvrier chinois qui a fabriqué le T-shirt n’a presque rien reçu en retour et se bat pour un meilleur salaire et une protection sociale. Pour sa part, même en déduisant quelques frais, le commerçant français qui importe le T-shirt fait cent fois la « culbute ». Pour augmenter sa marge au maximum, sans doute a-t-il d’abord licencié en France ou a-t-il contourné les droits de ses salariés. Il est pourtant bien citoyen français, relevant du droit français. Que n’est-il contrôlé et taxé ?
Lorsque Nicolas Sarkozy évoquait les 20 000 fonctionnaires des douanes afin d’illustrer sa politique de suppression d’un poste sur deux dans la fonction publique – « À quoi servent-ils depuis qu’il n’y a plus de frontières ?» –, il choisit un très mauvais exemple. Sans corps de contrôle de l’État, fisc, douane, concurrence et consommation, inspection du travail, sans règle d’échanges internationaux, le chantage aux salaires et à l’emploi s’organise tranquillement. (Le journal mensuel Fakir avait publie un excellent numéro sur les douanes, leur fonction, les effets négatifs de leur disparition).
On n’hésite pas à dénoncer la contrefaçon des grandes marques et à déployer des efforts considérables pour lutter contre les filières d’acheminement. Pourquoi ce contrôle ne peut-il pas s’exercer sur des produits ne respectant pas des normes de qualité de travail ? Il ne s’agit pas ici de protectionnisme, mais de respect des conventions de l’OIT qui, rappelons-le, l’emportent en droit universel sur les décisions de la Commission européenne.
Décider de les appliquer en instaurant des sanctions dissuasives, des taxes et des procédures de contrôle peut permettre une politique de défense de nos salaires et de notre système de protection sociale. Un tarif douanier unique européen à caractère social et environnemental peut être défendu sans que l’on parle de « protectionnisme ».
Qu’est-ce qui nous empêche de contrôler les délocalisations, sinon l’absence de volonté politique ? Le « contrôle administratif sur les licenciements économiques » a été abandonné en 1986 après avoir fonctionné pendant dix ans. Pourquoi ne pas le restaurer ? Il permettrait à la puissance publique, en fonction de la situation, d’empêcher une délocalisation si elle l’estime injustifiée. La délocalisation, motivée par le seul calcul boursier, d’une entreprise qui a profité d’aides publiques pourrait être sanctionnée : trente mois de salaire à payer aux salariés, trente mois aux Assedic, multipliés par le nombre d’emplois concernés… cela fait réfléchir les actionnaires lorsqu’il s’agit de gagner 2 ou 3 % de marge de profit.
Même dans une économie mondialisée, même face aux libéraux de l’UE, l’État républicain français n’abdique que parce qu’il le veut bien. Macron, lui, fait de l’abdication, sa praxis.
Si nous décidons de vaincre Macron en proposant une politique alternative, nous pourrons prendre les mesures nécessaires sans fermer ses frontières, ni menacer les échanges commerciaux. Le « libre-échange » n’a rien de libre : il relève partout de négociations, de règles autant acceptées que subies. La défense des salaires et de la protection sociale font partie des tractations. Prétendre le contraire et proclamer l’impuissance de l’État, c’est contribuer au chantage et céder au déferlement néolibéral. C’est un choix politique, pas une fatalité.
Dans le monde comme en Europe, le droit du travail doit être constitutif du droit de la concurrence et non pas « exclu » de celle ci.
Mesures d’accompagnement
Un autre argument contre la hausse du Smic, est le risque de grignotage des salaires par les coûts du logement, de la nourriture, de l’eau, du gaz ou de l’électricité. Il y a ceux qui opposent « hausse du pouvoir d’achat » et « hausse des salaires ». Mais ceux-là ne vont pas souvent ou rarement jusqu’à prendre des mesures de contrôle ou de blocage des prix.
Pourtant c’est un risque à considérer aussi. Les usages sont différents d’un pays à l’autre, et dans notre pays, comme partout, les capitalistes veulent gagner non pas seulement du « profit » mais le « maximum de profit » : c’est le système qui veut ça. Et dés qu’il y a des « aides » ou du salaire en plus, les détenteurs du capital, prêteurs, bailleurs, loueurs, qui ne sont ni altruistes, ni généreux, cherchent immédiatement comme le capter.
Là encore au lieu de laisser faire, comme Macron qui casse le système des logements sociaux et des HLM, la régulation équitable l’emportera.
La vie à Paris est 35 % moins chère qu’à New-York mais le prix des loyers est plus cher qu’en Allemagne. Les variations de loyers peuvent mettre à mal les hausses de salaires. Pareil pour les circuits de distribution : les agriculteurs savent comment ils sont pillés par les Auchan, Leclerc, Carrefour, etc.…
Avec un salaire moyen de 36.000 euros, la France est juste derrière l’Allemagne, mais loin du Royaume-Uni ou des Pays-Bas. Il faut donc réfléchir et agir aussi en « parité de pouvoir d’achat » et veiller en parallèle à ce que des hausses de loyers ou des factures d’eau, de gaz, d’électricité, de transport, et aussi tout ce qui relève de la grande distribution, des banques et assurances ne viennent pas obérer ces augmentations.
Des politiques coordonnées seront nécessaires pour y parvenir : nous proposons d’accompagner la politique de hausse des salaires :
- d’un blocage des loyers sociaux pour 3 ans sur tout le territoire et dans tous les secteurs locatifs pour compenser les surprofits immobiliers considérables engrangés ces dernières années.
-d’une la fixation de tarifs sociaux pour les transports, l’eau, le gaz, l’électricité, (quantum de mètres cubes, de kWh gratuits, gratuité des premières tranches de consommation de l’énergie, des premiers m3 d’eau,
- d’un tarif social des transports collectifs publics de proximité (y compris Sncf), pour les ménages en difficulté et les jeunes.
Nous l’avons déjà argumenté en partie ci dessus : nous préférons une hausse des salaires et un partage concomitant du temps de travail, plutôt que le « revenu universel d’existence ». Parce que la société peut et doit donner une place active, une fonction sociale, équivalente à tous et à chacun.
Bien sur, et ce n’est pas la même question, un minima social est impératif, chaque personne non insérée, doit pouvoir subvenir à ses besoins vitaux élémentaires, et celles qui disposent d’un revenu trop faible doivent toutes avoir droit à un soutien décent de l’Etat. Il s’agit alors d’une base incompressible qui peut garantir à la personne le revenu considéré comme minimum, auquel tout le monde a droit. C’est une forme de redistribution des richesses qui bénéficie à la catégorie la plus pauvre de la population, mais qu’il ne faut pas confondre ni avec le salaire ni avec le service de protection sociale qui constitue un système d’assurance financé par cotisations.
Il existe en France toute une panoplie d’aides sociales : ASS, AAH, APL, RSA, et diverses allocations. Il est tentant d’étendre ces allocations ou indemnités à toute la population et de les transformer en un revenu de base attribué sans condition. A lui seul, il attribuerait à la personne le revenu considéré comme minimum et remplacerait la panoplie d’allocations diverses. Les autres revenus (du travail, de placement) viendraient en plus. Serait ainsi établi un « revenu universel d’existence » (RUE) qui permettrait de survivre tout en étant au chômage, bien qu’en vivant dans l’austérité. Selon ceux qui prétendent que reste chômeur qui le veut bien, il n’y aurait plus de raison de déplorer le manque d’emplois. Mais on aurait une « société à deux vitesses ». C’est pourquoi l’instauration du RUE est surtout souhaitée par ceux qui considèrent que ce volant de chômage est nécessaire pour maintenir à la baisse le coût de la force de travail !
C’était l’opinion des principaux partisans du néolibéralisme, qui refusaient la réduction du temps de travail, en premier lieu Milton Friedmann et Friedrich Von Hayek. C’est, par exemple, aussi le cas de Christine Boutin et d’Alain Madelin. D’Attali et de Macron.
Mais son instauration est aussi maintenant, attendue par certains sceptiques qui ne croient plus qu’on puisse réduire le chômage de masse installé depuis plus de trente ans. C’est pourquoi le RUE a trouvé des partisans à gauche : c’était le cas d’André Gorz.
Si on voulait lui donner un montant vraiment suffisant pour subvenir aux besoins vitaux, le RUE présenterait coupe la société en deux parties à la coexistence conflictuelle : d’un côté les bénéficiaires inactifs du seul RUE, et de l’autre les actifs, bénéficiaires du RUE et d’un revenu d’activité. Mais ce dernier serait forcément peu élevé car victime d’un prélèvement important pour financer un RUE distribué à tout le monde. Le revenu du travail serait peu attractif et l’hostilité entre travailleurs et non travailleurs deviendrait problématique.
C’est pourquoi le caractère universel du RUE le contraindrait à être d’un faible montant, très insuffisant pour répondre aux besoins vitaux. A productivité égale, moins il y a de travailleurs, moins de richesse produite, puisque seul le travail est productif. Et moins de richesse est alors redistribuée.
Des revenus complémentaires ont été expérimentés dans divers pays. Mais, sauf en Alaska, ils n’ont pas le caractère universel d’un RUE, ils sont versés sous conditions et concernent un public restreint, comme toutes les allocations spécifiques. En Alaska, le RUE est très faible (moins de 200 euros par mois) et n’est pas disponible immédiatement ; c’est une épargne forcée qui ne peut pas assurer l’existence de son bénéficiaire.
Augmenter le Smic de 333 euros mensuels bruts, et le porter à 1800 euros, cela correspond à une enveloppe d’environ 8 milliards. Les petites entreprises y trouveront leur compte par de nouveaux carnets de commande, mais pas toutes : c’est la raison pour laquelle nous créerons un fonds de soutien aux très petites entreprises qui seraient en difficulté du seul fait de cette mesure (TPE). Ces « aides » ne seront plus versées à l’aveugle, mais seront ré organisées selon les seuils et liées à des contreparties vérifiables et contrôlées en embauche et emplois de qualité et en CDI.
Les effets sur l’égalité salariale femmes homme
Avec la hausse du Smic, ce seront essentiellement les femmes qui seront concernées. Ce sera l’occasion de la bataille dont nous avons parlé ci dessus, pour l’égalité des rémunérations femmes et hommes dans toute la grille des salaires et dans tous les métiers, tous les âges et toutes les qualifications.
Voilà 60 ans que le principe « a travail égal, salaire égal » a été voté et intégré dans le Code du travail, mais il n’est jamais entré en application. Or les femmes sont devenues 43 % de la population active. Et elles sont toujours les premières victimes de l’exploitation, des discriminations, de la précarité, de la pauvreté en termes de condition de vie, de déséquilibre familial et de trajectoire professionnelle. C’est aussi une pression qui sert à tirer à la baisse le salaire de tous. Donc pas d’émancipation sociale sans égalité femme-homme. La hausse du smic en sera l’occasion et du même coup, nous ferons avancer toute la société. « À travail égal, salaire égal »
Nous proposons :
– Égalité salariale entre les femmes et les hommes par l’introduction systématique dans l’année qui suivra la loi, de contrôles, et de sanctions financières dissuasives.
– dans toutes les entreprises de plus de 50 salariés les institutions représentatives du personnel et l’inspection du travail doit pouvoir doivent exiger un bilan annualisé et comparatif des salaires femmes/hommes poste par poste, qualification par qualification, et selon l’ancienneté
- Les organisations syndicales, les IRP auront la possibilité de saisir un juge en référé lorsque la discrimination salariale sera constatée et non corrigée dans un délai préfix
- L’inspection du travail pourra verbaliser et saisir les tribunaux en référé pour sanctionner et corriger les discriminations salariales dans toutes les entreprises, et dans tous les métiers.
Les juges pourront agir en référé et imposer sous délais préfix des astreintes financières lourdes qui seront prélevées si l’entreprise ne régularise pas.
Et il restera à protéger les femmes de retour de congé maternité dans des conditions consolidées : elles sont censées actuellement retrouver un poste « identique ou similaire » : le mot « similaire » sera enlevé. Et il sera interdit de les muter ou de les licencier pendant 18 mois après leur retour de couches.
Salaire maxima < à 20 smic
Il faut donner un signe clair et simple pour la répartition des richesses : l’instauration d’un salaire maxima comme il existe un salaire minima.
Puisque nous sommes « jaloux » et « partageux » nous proposerons qu’aucun humain ne puisse accéder à un salaire ou une rémunération supérieure à 20 fois le Smic.
Pourquoi 20 smic ? Disons-le, c’est une proposition initiale arbitraire, et qui peut évoluer à la baisse. Aucun humain quelque soit son talent, son génie, ne mérite et surtout n’a besoin de gagner 20 fois plus qu’un autre. 20 smic c’est déjà énorme ! Pour quoi faire ? Pour acheter 3 maisons, 5 villas, 3 yachts, 6 voitures, un avion et du caviar tous les soirs ? Puisque cela ne s’auto régule pas, il faut empêcher, interdire par les états, par la loi, que 62 humains possèdent plus que 3,5 milliards d’humains, il faut organiser collectivement ce pas vers un progrès géant pour toute l’humanité : cette horreur économique est intolérable, il est insupportable que l’exploitation, le pillage du travail des autres, la rente sans travail atteignent de tels sommets.
Salaire maxima à 20 smic, c’est la revendication de la Confédération européenne des syndicats.
A l’école, on vous note de 1 à 20 pourquoi on vous paierait de 1 à 600 ensuite ?
Le Medef a toujours promis l’autorégulation. Mais s’il y avait un doute sur eux, il suffit de voir qu’elle ne se fait jamais. La rapacité, la cupidité, la « violence des riches » comme l’ont étudié les sociologues Pinçon-Charlot sont sans limites. Ils n’en ont jamais assez.
« Oui, mais il y a des mécènes » nous dit-on. Mais nous ne sommes plus dans l’Ancien régime. Nous ne voulons pas dépendre des Seigneurs. Ni vivre de charité. S’ils donnent de façon arbitraire, selon leurs bons plaisirs, à « leurs » pauvres, « leurs » institutions, « leurs » musées, « leurs » fondations, « leurs » maladies, pourquoi ne le donnent ils de façon organisée, partagée, maitrisée, par l’impôt, par les cotisations sociales, la sécurité sociale, les caisses de retraites ?
La rémunération des patrons en France, et notamment leurs bonus d’arrivée ou leur « retraite chapeau », fait régulièrement polémique. En mars 2013, les Suisses ont ainsi voté une limitation des hauts revenus, largement popularisée par la polémique née des 58,5 millions d’euros de prime de départ de l’ancien patron de Novartis, Daniel Vasella. Depuis l’an dernier, le « Say on Pay », vote consultatif des actionnaires lors des AG annuelles, est ainsi arrivé en France.
Le total de la prime de départ de Michel Combes, ex patron d’Alcatel Lucent était de 13,7 millions d’euros. Un montant comparé par Le Monde à 218 années de travail d’un salarié de la firme, qui a choqué le ministre de l’économie Emmanuel Macron jusqu’au MEDEF, d’autant plus que les critères d’attribution de cette prime étaient surprenants, avec par exemple une prime de non concurrence … décernée après la nomination de Michel Combes à SFR ! Après deux semaines de polémique qui ont engendrées près de 30 000 tweets, Alcatel a décidé de diminuer de moitié la prime : la polémique est retombée juste après un second pic de tweets commentant cette annonce. Mais finalement, pour qui aura-t-elle été la plus violente ? Qui, entre le patron Combes, l’entreprise Alcatel, le syndicat MEDEF ou encore le gouvernement, aura-t-il le plus pâtit de cette affaire ?
Il n’y a pas une année sans scandale de rémunérations indécentes des dirigeants d’entreprise alors que l’austérité est imposée à 99 % de la population. Il y a eu les retraites chapeaux, il y a eu les stock-options, il y a maintenant les rémunérations délirantes des dirigeants des entreprises du CAC 40.
A chaque nouveau scandale des mesures sont promises. A chaque fois il faut se plier à des règles fixées par les entreprises elles-mêmes. Il est temps que la puissance publique reprenne sérieusement la main !
Des rémunérations indécentes
Le total des salaires des patrons du CAC 40 s’élève à 93,6 millions en salaire fixe et variable en 2015. Soit une moyenne de 2,34 millions chacun ! Un peu plus de 134 Smic ! Si l’on regarde d’un peu plus près ce que gagnent réellement les dirigeants du CAC 40, il n’est pas difficile de constater que salaire fixe et part variable ne sont qu’un élément de leurs rémunérations. Avec les distributions d’actions, les stock options … on passe de 2,34 millions en moyenne par dirigeant à 4,2 millions.
Quel devrait être l’écart raisonnable de rémunération entre les salariés et leur patron ? Dans les années 1930, l’industriel Henry Ford, grande figure du capitalisme, estimait que pour être « admissible », l’échelle des salaires au sein d’une entreprise ne devait pas dépasser 1 à 40. Un bon demi-siècle plus tard, suite à la crise financière de 2008, le président Barak Obama propose de plafonner à 500 000 dollars la rémunération annuelle des dirigeants des entreprises renflouées par l’État. Soit un écart d’environ 1 à 25 avec le salaire minimum.
De son côté, le gouvernement français décide en juin 2012 d’encadrer les rémunérations des dirigeants des entreprises publiques, sur une échelle de 1 à 20 comparé au salaire moyen. Soit 450 000 euros maximum – 37 500 euros par mois – pour les PDG d’Areva, d’EDF ou de La Poste. Promise par François Hollande avant son élection, la mesure est entrée en vigueur en 2013. Nos voisins suisses pourraient même aller plus loin encore, puisqu’ils doivent se prononcer par référendum populaire, le 24 novembre prochain, sur une restriction de l’écart des salaires au sein d’une même entreprise de 1 à 12.
Le « marché » est, lui, beaucoup plus généreux avec les dirigeants d’entreprises cotées que ne le sont Barack Obama et François Hollande, ou que ne l’était Henry Ford, pourtant très éloigné de l’idéal socialiste. Au sein des 47 grandes entreprises du CAC 40 et du SBF 120 (Société des bourses françaises, un indice qui prend en compte les 120 premières capitalisations boursières) que Basta ! et l’Observatoire des multinationales ont étudié (voir notre tableau ci-dessous), seules 13 entreprises pratiquent un écart de salaire « admissible » au sens où le concevait Henry Ford. Toutes les autres sont au-dessus. L’écart moyen entre les rémunérations et avantages des PDG et les dépenses moyennes consacrées aux salariés – salaires bruts, cotisations patronales, primes, heures supplémentaires, plans d’épargne retraite et mutuelles d’entreprise le cas échéant – est de 77 : un PDG gagne en moyenne 77 fois plus que ses salariés ! Et cette échelle prend en compte tous les éventuels « avantages » dont bénéficient, en plus de leurs salaires, les employés. Toutes les données sont issues des documents de référence remis par les entreprises à l’Autorité des marchés financiers.
La finance appelle la finance
Ces sommes ont augmenté régulièrement. La financiarisation de l’économie n’y est pas pour rien. Dans ce monde de traders ou la City de Londres fait la guerre aux places financières de Paris ou de Francfort, le montant des salaires fixes et des parts variables est devenu un critère de bonne santé de l’activité financière ou industrielle.
Les rémunérations excessives – liées en grande partie aux résultats – sont un élément de concurrence entre entreprises et dirigeants, entretenant et développant les logiques financières au sein de leurs entreprises. Et la finance appelant la finance, cela devient une partie conséquente de leur activité.
L’autorégulation des actionnaires a fait mille fois la preuve de son inefficacité.
L’incitation des conseils d’administration à se réguler eux-mêmes comme le préconise le « code de conduite » du Medef et de l’AFEP (1) ne fonctionne pas. Le Conseil d’administration de Renault a mis sur la place publique les limites étroites de ce « code de bonne conduite » en votant une rémunération annuelle de 7,2 millions d’euros pour Carlos Ghosn, malgré le refus de 54 % de l’Assemblée générale des actionnaires.
Respecter le vote des assemblées générales d’actionnaires ne fonctionne pas non plus. C’est pourtant la solution préconisée par Manuel Valls qui veut l’inscrire dans la loi. Avec cette loi, l’augmentation de 18 % de la rémunération annuelle du PDG de Capgemini, votée à 91,55 % par l’assemblée générale, ne serait pas remise en question et Paul Hermelin pourrait parfaitement percevoir sa rémunération de 4,43 millions d’euros.
Voilà pourquoi ca suffit ! La loi doit fixer une limite aux rémunérations annuelles des dirigeants d’entreprises : pas plus de 20 smic par an !
Ce n’est pas Carlos Ghosn qui fait gagner Renault. Quels résultats Carlos Ghosn pourrait-il obtenir, sans tous les salariés qui s’échinent sur les chaînes de production, dans les bureaux d’étude de Renault, dans les ateliers des sous-traitants ?
La fuite des « cerveaux », brandie par le Medef et Emmanuel Macron, ne serait pas une tragédie. La seule véritable compétence de ces « cerveaux » est de se montrer plus habiles que d’autres pour spéculer, augmenter la valeur boursière de l’entreprise qu’il dirige en délocalisant, en exploitant et licenciant les salariés, afin d’augmenter toujours plus les profits et les rémunérations des actionnaires. Ils seraient faciles à remplacer. Encore une fois, les cimetières sont pleins de patrons irremplaçables.
Notre gouvernement de gauche, soucieux d’égalité sociale, proposera au vote du Parlement une loi limitant la rémunération maximale d’un dirigeant d’entreprise (salaire fixe, salaire variable, primes diverses, stock-options) à 20 smic.
Qu’en est-il des entreprises publiques ? En juin 2012, le gouvernement a pris un décret limitant la rémunération des entreprises où l’État est majoritaire, à 450 000 euros par an. Deux entreprises de notre tableau sont concernées : Areva et EDF. Henri Proglio, le patron d’EDF, devra diviser par trois son salaire en 2013, et Luc Oursel, celui d’Areva, par six [3]. Si ce plafond est respecté, Areva et EDF deviendront les entreprises cotées les plus égalitaires, avec un écart entre patrons et dépenses moyennes par salarié allant de 1 à 6 pour Areva et de 1 à 11 pour EDF. Pas sûr que cela suffise à redorer le blason du nucléaire.
Battre la théorie libérale en brèche
Des études nombreuses viennent briser le fondement du laisser-faire dominant depuis vingt ans, selon lequel les inégalités sont un mal nécessaire. Elles seraient inévitables et elles sont même souhaitables, car la croissance vient de l’innovation, dont l’enrichissement est le moteur. Les richesses produites par le haut viendrait accélérer la croissance et du même coup bénéficier à tous. Les friches finiraient par faire du bien aux pauvres. On verse le champagne en haut de la pyramide des verres, le liquide à bulles déborde et remplit toutes les coupes à la fin. Si la situation de toutes les catégories s’en trouve améliorée alors la justice sociale s’en porte bien, on peut laisser faire.
Contrairement à cette théorie inlassablement sous-jacente à toutes les litanies libérales, les 60 % du bas de l’échelle ne goûtent jamais au champagne qui coule d’en haut. Ils voient leur situation stagner ou même régresser
Cette philosophie libérale est battue en brèche de deux façons. D’abord, parce que dans le 1% des nouveaux Gatsby, il y a certes des innovateurs comme Bill Gates, mais il y a surtout les banquiers de la tour du port de New York, dont l’apport de productivité à l’économie réelle est plus qu’incertain. « La place démesurée de la finance dans certains pays », selon Christine Lagarde, est l’un des facteurs explicatifs de la poussée inégalitaire, à côté de l’innovation et du progrès technologique. L’autre défaillance de la théorie du laisser-faire est l’arrêt du champagne à mi-hauteur. Contrairement à la théorie, les 60 % du bas de l’échelle n’y goûtent jamais, ils voient leur situation stagner ou même régresser.
Le « coefficient de Gini », qui mesure les inégalités, a fortement crû partout, à l’exception notable de l’Amérique latine et de l’Afrique. Ces deux régions n’empirent pas, mais elles demeurent les plus inégalitaires au monde. Le coefficient a crû dans 16 pays de l’OCDE sur 21, passant en moyenne de 0,29 à 0,32. La cause est l’effet d’étirement vers le haut des revenus explosifs du 1% des super-riches, mais pas seulement. Le coefficient monte aussi à cause de la stagnation des 4 déciles du bas de l’échelle dans de nombreux pays. Or, ces 40% de «pauvres» et de classes moyennes inférieures sont devenus vulnérables, ils peinent à instruire leurs enfants. Voilà l’origine du manque de croissance : le gâchis en capital humain. Une trop grande part de la population, une petite moitié, est privée des fruits de la croissance mais aussi des moyens éducatifs pour apporter sa contribution.
Un « nouveau consensus » se dessine, selon madame Lagarde, appuyé sur trois principes. D’abord, la politique économique doit assurer la stabilité et une bonne gouvernance. « La corruption est un indicateur avancé d’inégalités.» Ensuite, « la mesure ». L’innovation a besoin d’une rémunération, il faut que les gouvernements restent prudents. Enfin, il n’existe pas de solution universelle, les réponses sont diverses et nationales, selon l’état du pays, son histoire, ses habitudes. Mais les transferts par des hausses d’impôt « ne sont pas forcément nuisibles à la croissance […] pour peu que les mesures soient bien pensées et correctement mises en œuvre ». Surtout, il faut « privilégier les familles avec enfants et les jeunes » et « encourager la formation tout au long de la vie ». L’OCDE précise : les programmes de lutte contre la pauvreté ne suffisent plus. « Renforcer l’accès aux services publics d’éducation, de formation et de soins de qualité» constitue «un investissement social essentiel » pour la croissance et pour l’égalité des chances.
Que ce soit le FMI qui le dise, de même que l’OCDE, est instructif quant à l’abîme des réflexions essayant de comprendre pourquoi la croissance ne repart pas fortement au sortir de la crise financière. Il est significatif que ces institutions en viennent à remettre en cause la doxa libérale sur un sujet aussi central, aussi tabou, que les inégalités et l’enrichissement. Et cela se passe aux États-Unis, et à Wall Street même.
Joseph Stiglitz, prix Nobel en 2001 critique cette « idée vraiment stupide selon laquelle baisser les impôts sur les entreprises stimulerait l’économie », jugeant que cette « politique de l’offre » mise en oeuvre par Ronald Reagan aux Etats-Unis dans les années 1980 est aujourd’hui « totalement discréditée ». « Ce n’est même plus un sujet de débat pour les économistes, seulement pour les Allemands et pour quelques personnes en France ». Hélas, en France, après François Hollande, Emmanuel Macron, compte parmi ces quelques personnes.
Mais où en sommes nous ?
Car toute cette vision sociale se heurte frontalement aux ordonnances Macron. Les ordonnances Macron sont anti femmes, anti salariés, anti travail, pro finance. Elles aggravent donc encore plus les lois d’Hollande, Sapin, Rebsamen, El Khomri. Du Medef presque pur : le Medef en a encore sous le pied et inventent sans cesse d’autres exigences.
Voilà l’argumentaire pour les décortiquer, les combattre, les abroger, et pour reconstruire un code du travail et une société du travail digne du XXI° siècle. Ce travail inédit ci dessous a été réalisé au cours de l’été et de l’automne 2017 en collaboration avec Richard Abauzit, lui aussi inspecteur du travail en retraite.