L’Union européenne continue sa « stratégie du nœud coulant ». Elle veut non seulement faire en sorte que Grèce accepte de se pendre mais qu’en plus, elle tresse elle-même la corde. Elle fait tout pour que ce soit le Parlement grec qui adopte des mesures de réductions des salaires, des pensions et accélère les privatisations. Les mêmes recettes que celles qui ont conduit la Grèce dans la situation catastrophique où elle se retrouve aujourd’hui.
Les concessions faites par le gouvernement grec pouvaient laisser croire que l’UE allait arriver à ses fins mais le rapport de forces paraît, aujourd’hui, nettement plus équilibré, la population grecque appuyant, dans sa grande majorité, la politique de Syriza.
La « ligne rouge » de Syriza
Le gouvernement grec a accepté de faire de nombreuses concessions. Il avait envoyé, le 24 février, la liste des « réformes » qu’il comptait mettre en œuvre. Il en a envoyé trois autres depuis.
Mais Syriza s’est fixé une « ligne rouge » qu’il ne veut pas franchir, la remise en question du cœur de son programme : mise en œuvre d’un plan d’urgence humanitaire, refus de nouvelles coupes dans les salaires, les pensions ou la Sécurité sociale, refus d’une nouvelle « libéralisation » du marché du travail.
Alexis Tsipras déclarait le 31 mars devant le Parlement grec : « Nous cherchons un compromis honnête avec nos partenaires, mais ne vous attendez pas à ce que nous signions une reddition sans condition. C’est pourquoi nous sommes attaqués sans pitié mais c’est la raison pour laquelle la société nous soutien ».
Il précisait, ensuite, la politique du gouvernement grec : « il est crucial que les recettes provenant de l’utilisation de la propriété publique ne soient pas jetées dans un gouffre sans fond pour le remboursement de la dette mais placées là où le pays en a besoin, la sécurité sociale, la croissance ».
Le gouvernement grec refuse la « diplomatie secrète » et vient de publier (dans le Financial Times) les 26 pages de la nouvelle liste des réformes qu’il propose pour qu’enfin, l’UE accepte de lui verser une tranche de prêt de 7,2 milliards d’euros, reliquat des 240 milliards d’euros que la Troïka (BCE, UE et FMI) s’était engagés à versés à la Grèce, au fur et à mesure de l’avancée des réformes exigées par la même Troïka.
La nouvelle liste des réformes proposées par la Grèce prévoit un total d’économie de 4,6 à 6,1 milliards d’euros grâce à l’intensification des « audits » sur les fraudeurs fiscaux, un contrôle accru sur le commerce illégal du tabac, de l’alcool et des carburants, une lutte plus efficace contre la fraude à la TVA, un impôt sur les jeux en ligne et le secteur du luxe. Des réformes qui, pour l’essentiel, frappent des secteurs que la Troïka avait toujours épargnés. Le gouvernement grec s’engage, également à honorer les contrats de privatisation existant, mais se refuse à aller au-delà.
Syriza n’est pas Nouvelle Démocratie ou le PASOK
Ces deux partis qui avaient gouverné la Grèce entre 2009 et 2014 avait fini par accepter toutes les « réformes » que leur avait imposées la « Troïka ». Georges Papandréou, alors Premier ministre, avait menacé d’organiser un Référendum en novembre 2011, pour tenter d’établir un rapport de forces avec l’UE et le FMI. Il avait été aussitôt « démissionné » par la majorité du Parlement grec, avec l’appui de son propre parti, le PASOK. Un banquier, Loukàs Papadimos, l’avait remplacé et la « Troïka » avait pu dicter ses quatre volontés à la Grèce. Antonis Samaras, devenu Premier ministre en 2012, avec le soutien de François Hollande, avait continué dans la même voie que le banquier.
Syriza n’est pas fait du même bois et a tiré les leçons des politiques menées par le PASOK et Nouvelle Démocratie. Il a été élu pour redonner à la Grèce sa « dignité » et n’est pas prêt à accepter d’appliquer les « remèdes » de la Troïka qui ont entraîné la Grèce dans une telle catastrophe. Son cran, le « non » résolu qu’il oppose à l’UE après avoir fait toutes les concessions possibles, sans remettre en cause l’essentiel de son programme, lui ont acquis le soutien d’une très large majorité de Grecs. Il a donc, maintenant les coudées franches pour s’opposer plus frontalement à l’UE.
Tous les Grecs ont pu voir comment agissait l’UE. La liste des « réformes » proposées par Athènes n’est jamais satisfaisante, elles sont, selon les caprices des fonctionnaires bruxellois et des dirigeants de l’UE, trop complexes, trop floues, à trop longue échéance… La BCE verse au compte-gouttes les euros indispensables (comme pour tous les États de la zone euro) au fonctionnement du système bancaire grec. Le président de l’Eurogroupe Jeroen Dijsselbloem s’en félicitait, estimant « bienvenue toute pression qui accélèrera le processus de réforme en Grèce ». Pour accentuer encore la pression et accélérer la fuite des dépôts des banques grecques (25 milliards d’euros depuis décembre 2014) il faisait référence à la crise chypriote de 2011 et la saisie de tous les dépôts bancaires au-delà de 100 000 euros afin de les faire contribuer à financer la faillite des deux principales banques de Chypre. Wolfgang Schäuble, le ministre des Finances allemand, évoquait, tel Ponce Pilate, un « Graccident », une sortie, « par accident », de la Grèce de la zone euro.
Le gouvernement grec peut ainsi, ouvertement, se préparer au pire, même si ce n’est pas la solution qu’il souhaite. Il sait ce que coûterait à la Grèce la sortie de la zone euro et des dévaluations de la drachme qui s’en suivraient. Mais Syriza estime que ce coût serait moins lourd que celui qu’il devrait assumer s’il renonçait à ses engagements et mettait fin à toute possibilité de se relever pour l’économie et la société grecques.
Le gouvernement grec se prépare donc à un « Grexit ». Ce n’est pas pour lui la meilleure solution. Il préfèrerait un accord sans rupture, sur la relance de l’économie grecque et la restructuration de sa dette. Mais il ne peut exclure la sortie de la Grèce de la zone euro, dans le cadre de la stratégie de tension qui l’oppose à l’UE. Il prépare le terrain pour l’émission de « lettres de crédit » auprès d’États (tels la Chine ou la Russie) qui trouveraient leur intérêt à les accepter. La BCE a même, de ce point de vue, donné un coup de main à Syriza en annonçant la mise en place d’un contrôle des capitaux (comme à Chypre) qui protégerait la Grèce en cas où elle serait obligée, du fait de la seule intransigeance de l’UE, de revenir à la drachme. Le gouvernement grec prépare également l’impression de reconnaissance de dettes « I owe you » (IOU) pour payer les retraites et les traitements des fonctionnaires. Le gouvernement grec a également mis en place une « Commission d’audit » de sa dette publique. Zoe Kostantopoulou, la présidente du Parlement grec a clairement annoncé qu’il s’agissait d’un « outil qui permettra de rétablir une injustice majeure commise à l’encontre du peuple grec ».
La Grèce et l’UE s’affrontent dans une double bataille
La première bataille est celle qui se mène aujourd’hui, c’est celle de la méthode qui devrait permettre la relance de l’économie grecque.
L’UE veut imposer sa méthode qui a, pourtant, échoué partout et infligé une triple catastrophe (économique, sociale, financière) à tous les pays qui l’ont mises en œuvre, qu’il s’agisse de la Grèce, de l’Irlande, du Portugal ou de l’Espagne. Cette méthode consiste à couper dans les dépenses, en particulier les dépenses sociales, à baisser les salaires, les retraites, les allocations chômage, pour rendre un pays « attractif » pour les investisseurs, sans se soucier des effets désastreux d’une telle politique. En cinq ans, l’économie grecque a subi des effets aussi dévastateurs que ceux d’une guerre. Cette méthode ne peut de toute façon pas fonctionner car aucun investisseur n’a envie de risquer ses capitaux dans un pays dont l’économie est en ruine.
Il faut d’abord reconstruire l’économie. C’est la méthode que préconise Syriza : une politique d’investissement et en premier lieu d’investissement public, accompagnée de l’augmentation des salaires et du pouvoir d’achat pour que les entreprises grecques (notamment les PME) puissent trouver un débouché à leur production.
La bataille suivante est celle de la restructuration de la dette publique.
L’UE affirme toujours, mordicus, que la Grèce doit rembourser tout ce qu’elle doit. Tout le monde sait pourtant que c’est impossible, qu’aucun pays, surtout pas la Grèce dans l’état où l’a plongé la Troïka, ne peut consacrer 6 % de son PIB, pendant des dizaines d’années au remboursement de sa dette publique. Tout le monde comprend qu’il faudra bien, un jour, restructurer cette dette et que le mieux serait que cela ne se produise pas dans la précipitation ou le chaos. Tout le monde sait qu’avant la première restructuration de la dette publique grecque en 2012, la Commission européenne jurait (sur ce qu’elle avait de plus cher, sans doute les banques) que jamais la dette grecque ne serait restructurée.
Dans ces deux batailles, la Grèce n’est pas seule en cause, tous les pays européens sont concernés.
C’est pourquoi, d’ailleurs, la bataille est aussi âpre. L’UE ne veut rien lâcher en Grèce car c’est les politiques d’austérité et de « réformes structurelles », au service de la Finance, des spéculateurs et des patronats européens, qui serait remise en cause dans tous les pays européens, en Espagne, au Portugal, en Italie, en France…
Cela a déjà commencé en Espagne. Le parti de droite au pouvoir, le PPE de Manuel Rajoy, a subi, le 22 mars, lors des élections en Andalousie, un recul considérable (de 41 % des voix en 2012 à 26 %). Le Parti socialiste espagnole, le PSOE est arrivé en tête avec 36 % et Podemos réalisait une percée avec 15 % des suffrages.
Syriza se cherche des alliés
Ce n’est pas encore, malheureusement, parmi des pays de l’Union européenne que Syriza peut trouver des alliés. Tous, y compris la France, se sont ligués contre la Grèce. Comment un gouvernement de gauche peut-il accepter de participer à une telle ignominie ?
Il ne s’agit pas non plus du FMI dont le gouvernement grec ne cherche que la neutralité, refusant de mener une « guerre sur deux fronts », contre le FMI et contre l’UE. Yanis Varoufakis, le ministre grec des Finances, a donc annoncé, après son entretien avec la présidente du FMI, Christine Lagarde, le 5 avril, que la Grèce allait rembourser les 460 millions d’euros d’un prêt du FMI, dont l’échéance tombe le 9 avril.
Il s’agit des États-Unis, inquiets à la fois des tensions ukrainiennes et des risques qu’une nouvelle crise grecque ferait courir à l’économie européenne et donc à celle des États-Unis.
Il s’agit aussi de la Russie. Alexis Tsipras a avancé d’un mois sa visite à Moscou. Les décisions, en matière de politique étrangère, ne peuvent être prises qu’à l’unanimité des États de l’Union européenne. La Grèce pourrait donc à elle seule, remettre en question les sanctions européennes envers la Russie, d’autant qu’elle pourrait entraîner à sa suite Chypre et la Hongrie. Alexis Tsipras a déjà annoncé la couleur en annonçant que « les sanctions contre la Russie ne mènent nulle part ».
L’UE est aujourd’hui devant un dilemme
Ce dilemme est le suivant : soit accepter que la Grèce bénéficie de l’aide européenne sans remplir les « conditionnalités » imposées par Bruxelles ; soit prendre le risque d’une sortie de la Grèce de la zone euro (un « Grexit ») et du défaut de la dette publique grecque qui suivrait rapidement.
La première solution présente bien des inconvénients pour les gouvernements européens et tout particulièrement pour Angela Merkel.
Tous les États européens exigeraient le même traitement que la Grèce, le TSCG serait remis en cause, les gouvernements qui ont imposé des politiques d’austérité à leur population risqueraient gros lors des prochaines échéances électorales. Angela Merkel aurait beaucoup de mal à expliquer aux « contribuables allemands » qui lui sont si chers, comment il est possible de prêter des milliards à la Grèce sans exiger que ces « fainéants de Grecs », dénoncés par une bonne partie des médias allemands, soient remis au travail et au pain encore plus sec.
La seconde solution est encore plus risquée.
Certes, les grandes banques européennes sont moins vulnérables, qu’avant la restructuration de 2012, à un défaut de remboursement de la dette grecque. Mais les banques privées ont réussi, lors de cette restructuration, à transmettre l’essentiel de leurs créances à des institutions publiques. Aujourd’hui, 223 milliards d’euros de la dette publique grecque (selon les chiffres d’Henri Sterdyniack et Anne Seydoux [1]) sont détenus par la BCE, le FESF et les autres États-membres européens. Il faut ajouter 32 milliards par le FMI.
Comment Angela Merkel a-t-elle pu oublier la redoutable formule du milliardaire américain, Paul Getty « Si vous devez mille dollars à votre banquier, il vous tient. Si vous lui devez un million de dollars, c’est vous qui le tenez » ?
Comment les dirigeants européens arriveront-ils à convaincre leurs contribuables que, du fait de leur politique qui a obligé la Grèce à sortir de l’euro et à faire défaut sur sa dette, il va falloir encore accentuer les politiques d’austérité pour diminuer une dette publique qui vient brusquement de s’accroître ?
Jean-Jacques Chavigné
Notes
[1] La Tribune du 27/01/2014



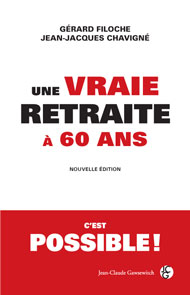






7 Commentaires
Bonsoir à tous,
En complément de ce qu’a écrit notre camarade Jean-Jacques Chavigné, je vous invite à lire l’article intitulé « Grèce, l’heure des choix », disponible à l’adresse suivante : http://www.fondation-copernic.org/spip.php?article1175
Solidairement.
juste une question, et qui ne mèrite pas le ciseau
en cas d’adoption de la motion B, que se passe-t-il?
est ce que Valls démissionne, est ce que le gouvernement est remercié, est ce que Hollande abandonne le CICE, l’ANI, les macronades?
il me semble qu’ils ne se sentirons obligés en aucune manière et qu’ils traiterons les militants comme ils traitent les électeurs, mais je peux me tromper
« Comment un gouvernement de gauche peut-il accepter de participer à une telle ignominie ? »
parce qu’il n’ai pas de gauche !
Le PS c’est le PASOK, et ce n’est qu’à la disparition de celui-ci que SYRIZA a pu prendre le pouvoir….
Mais bon vivement le congrès!
@Sans Ressources
Vous avez raison, ce n’est pas comme ça que ça marche en Vème République. Ce n’est pas le parti majoritaire qui fixe le cap au gouvernement mais l’inverse
L’argent est là!Il suffit d’aller le chercher… Gérard FILOCHE…Antoine PEILLON Hervé Falciani …La croissance de la finance ce fait Sur le dos de l’ensemble de l’humanité … le LuxLeaks…
Les accords secrets Entre les entreprises multinationales et les administrations fiscales du Luxembourg Pour minimiser Les recettes fiscales Et payer le moins d’impôts ! 340 multinationales …Délocalisation des bénéfices …Du grain à moudre
Vous avez raison, ce n’est pas comme ça que ça marche en Vème République. Ce n’est pas le parti majoritaire qui fixe le cap au gouvernement mais l’inverse…OK pour moi
Bonsoir à tous,
En complément de ce qu’a écrit notre camarade Jean-Jacques Chavigné, je vous invite à lire la note intitulée « Ne laissons pas l’Europe écrire sa tragédie grecque », disponible à l’adresse suivante : http://www.atterres.org/article/ne-laissons-pas-l’europe-écrire-sa-tragédie-grecque
Solidairement.