en cette année 1973 :
Nixon allait-il être chassé à la suite du scandale du Watergate ?
Le 4 février, 331médecins reconnaissaient, dans Le Nouvel Observateur, avoir pratiqué des avortements, ils risquaient de un à dix ans de prison. Le Mlac (Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception) se créait le 9 avril, en même temps que se développait le MLF (Mouvement de libération des femmes).
Le CES Pailleron brûlait.
Le journal Libération cherchait de l’argent pour paraître régulièrement.
Au Chili, l’Unité populaire de Salvador Allende approchait de sa fin.
Au Vietnam, le cessez-le-feu devançait la défaite et la fuite paniquée des soldats américains.
En France, le grand Picasso venait de mourir.
Les luttes ouvrières « exemplaires » continuaient, le gouvernement de Pierre Messmer se voulait de plus en plus répressif, les provocations se multipliaient. Un ouvrier, Pierre Maître, fut tué près de Reims par des commandos armés par un patron. Des défilés se terminaient par des « casses », si bien que les organisations politiques traditionnelles, PCF, PS, et les syndicats décidèrent une grande journée unitaire contre la répression, le 20 juin 1973.
Le 21 juin 1973 et la dissolution de la LC
Cette grande manifestation du 20 juin 1973, personne ne devait s’en souvenir. Je fus chargé par le BP d’organiser, avec Jean Métais, la participation de la Ligue à ce cortège très unitaire. Pour cette initiative, nous avions publié une belle affiche et fabriqué de belles banderoles.
Il y eut 30 000 à 40 000 participants. Toute la gauche était là. La Ligue défila, mais sans enthousiasme particulier, en queue, jusqu’à la gare de l’Est. Nous avions une puissante sonorisation et lancions surtout des slogans pour appeler à l’« autre » manifestation, le lendemain même, pour laquelle nous n’avions pas imprimé d’affiche ni même tenté de faire participer la gauche et les syndicats.
Ce contraste entre les deux initiatives provenait directement des « démons » qui travaillaient à la Ligue.
Il s’agissait d’interdire, ce soir-là, un meeting d’Ordre nouveau, les successeurs d’Occident et les prédécesseurs de Le Pen, à la Mutualité. Les groupes fascistes avaient mis le paquet : depuis plusieurs semaines, ils préparaient ce rassemblement « contre l’immigration sauvage » en collant massivement des affiches. Selon eux, des « hordes d’étrangers » déferlaient illégalement sur la France et ils se proposaient de mobiliser pour s’y opposer.
Alain Krivine, dans le bureau du premier étage de Guéménée, avait griffonné dans son éphéméride : « 20 juin, responsable Roger ; 21 juin, responsable Ludo. » Et la manifestation du 21 comptait bien davantage dans les préoccupations de la majorité du BP. Pour elle, elle était bien plus décisive que le cortège unitaire traditionnel de la gauche la veille.
C’était l’occasion à saisir pour appliquer nos théories sur les « actions exemplaires », imposer par l’autodéfense ouvrière que les fascistes ne puissent tenir le haut du pavé.
BI 30 contre BI 33.
La majorité de l’organisation LCR était depuis plusieurs années, surtout dans la partie activiste responsable du service d’ordre, engagée dans sa logique guérilleriste : préparation à la clandestinité, aides aux groupes latino-américains, espionnage des fascistes, coups de main, formation des chefs de groupe aux sports de combat, à la fabrication de cocktails Molotov, accumulation de matériels, de « planques », écoutes des ondes de la police, etc. Il fallait bien qu’une telle énergie, une telle patience, un tel investissement chez des jeunes trouve son débouché. L’organisation de commandos qui partaient un jour pour Nice « faire la peau aux fachos en fac de droit », qui s’attaquaient à la fac d’Assas, qui allaient aider les copains de Rennes dans une vaste opération contre les fascistes de la CFT (Confédération française du travail) et leurs commandos propatronaux de Citroën, qui rentraient dans un local d’extrême droite pour rafler le fichier de leurs militants, qui lançaient des « bombes » de peinture rouge sur le général sud-vietnamien Ky ou qui envoyaient du matériel d’impression caché dans le moteur d’une voiture jusqu’en Pologne, tout cela constituait autant d’exercices, mais n’était pas à la hauteur des théories professées et des attentes entretenues.
Moi, j’appréciais qu’on envoie un groupe, avec Alex, en Pologne pour monter une opération de sauvetage des archives de Léopold Trepper, l’ex- chef de l’Orchestre rouge, dont Gilles Perrault avait relaté l’histoire50. Cela me semblait utile. Patrick Rotman obtint ainsi la mission d’écrire les Mémoires de celui-ci 51.
Mais je protestais contre l’énergie, que j’estimais gaspillée, mise dans d’autres « travaux » moins bien orientés. Des « commissions spécialisées », comme la CT (commission technique), s’étaient mises en place depuis longtemps, avec différents services et un budget – confidentiel lui aussi – qui ne cessait de grossir. Le BP et plus encore le CC étaient tenus dans l’ignorance de ces activités, pour des « raisons de sécurité », me disait- on. Seuls des camarades comme Alain Krivine ou Daniel Bensaïd, outre ceux qui étaient directement impliqués, comme Michel Recanatti, n’ignoraient rien.
C’est ainsi que je n’ai pas « vu venir » la manifestation du 21 juin 1973.
Ce n’est pas très fort, pour un responsable politique, je l’avoue, mais mon activité principale, à ce moment-là, consistait à préparer les stages de l’été 1973 à Bièvres. Il était prévu, comme l’année précédente, six semaines de formation par groupes de 100 personnes, sur des thèmes très divers, pour des catégories différentes de militants.
Nous faisions les inscriptions, préparions les lieux, les sujets, prévoyions les orateurs… Si les choses avaient été explicitement présentées en BP, j’aurais voté contre le sens qui allait être donné au 21 juin.
J’ai commencé à me douter de quelque chose seulement à la dernière réunion préparatoire de la manif dans un amphi de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Nous y étions plus nombreux que d’ordinaire et il régnait une fébrilité exceptionnelle dans la direction du service d’ordre. Je ne sais plus si Daniel Bensaïd dit : « Inch Allah » ou : « Alea jacta est », mais c’était quelque chose dans ce genre. Alain Krivine, lui, était parti pour un meeting à Nice, ce soir-là. Je compris immédiatement, mais tardivement, ce qui allait arriver, quelques heures après, sur la place du métro Censier, rue Monge, en voyant débarquer les caisses de cocktails Molotov, tandis que se formait le SO du cortège, archi-motivé, casqué et armé de manches de pioche. Direction : la Mutualité.
Même nos partenaires de Révolution !, ce soir-là, cosignataires avec nous de l’appel à interdire la réunion d’Ordre nouveau, furent, d’après certains d’entre eux qui me le confièrent, surpris.
Il est difficile de dire le nombre de « cocks » qui furent lancés, mais sûrement plusieurs centaines, d’après ce qu’on m’avoua longtemps après. Évidemment, aucun militant ne rentre chez lui avec un tel matériel, il fallait donc s’en servir. Et se servir d’un tel stock implique une véritable bataille. C’est ainsi que le militaire l’emporte sur le politique : avec 300 cocktails Molotov au lieu d’une dizaine…
Le cortège remonta la rue Monge jusqu’à hauteur de Jussieu et enfonça le service d’ordre de la police, une fois, deux fois. Il y avait des flammes partout, et un peu d’inquiétude, car parfois les bouteilles incendiaires étaient lancées de trop loin, par certains camarades encore inexpérimentés, et avaient tendance à passer par-dessus nos têtes, arrivant trop près non pas des flics, mais des manifestants. Mais l’ardeur était telle, apparemment, que ce fut la police qui recula… D’ailleurs, elle recula toute la soirée et en plusieurs endroits.
Car si elle finit par nous empêcher d’approcher de la Mutualité, à force de lacrymogènes (l’air était irrespirable), elle ne put disperser le cortège. Nous nous sommes regroupés en bas de Mouffetard et de Monge. C’est alors que nous avons vu venir de Gay-Lussac et d’Ulm un sombre cortège, une masse d’individus casqués, noirs, formant bloc. Nous avons craint le pire, avant de constater, en nous approchant, que c’étaient les nôtres, qui eux-mêmes avaient peur, tellement, de loin, nos propres cortèges ressemblaient… à ceux des CRS. Nous avons fusionné joyeusement pour repartir à l’assaut des vrais CRS, vers Censier, Monge.
La direction de la manif était éclatée. Les informations captées par la CT qui écoutait les radios de la police ne nous parvenaient plus.
Je commençai à chercher une issue avec le secteur du cortège qui était le mien. Nous avons fait demi-tour et mon idée a été de défiler le plus loin possible du théâtre direct des opérations pour limiter les dégâts, déjà importants. Ce n’est pas que je n’aimais pas la bagarre, au contraire, sur le plan physique j’étais excité comme tout le monde, mais encore fallait- il qu’elle ait un objectif utile, compréhensible par les gens « normaux ».
Nous avons remonté le boulevard Étienne-Marcel, tourné boulevard de l’Hôpital. Las, il y avait encore des cars de policiers, ceux-ci curieusement non informés, mais embusqués et coincés là, à Austerlitz, prenant peur et traversant, pour fuir, les rangs de manifestants. Les cars furent chahutés, cabossés, avant de finir contre un poteau de feu rouge, enflammés par les cocktails Molotov. Une fois la Seine traversée, mon objectif de diversion avait pris corps : il consistait en l’attaque du local d’Ordre nouveau, rue des Lombards. Avant d’y parvenir, il y avait encore des cars de police, et l’un, coincé place de la Bastille, prit carrément feu. Là, c’était vraiment trop, nous avons décidé d’aider les policiers affolés à sortir de leur car, assurant l’extinction des flammes et leur sécurité. Je me demandais quand et comment cela s’arrêterait. Alors que nous remontions jusqu’au local de la rue des Lombards, nous étions encore très nombreux. Nous avons réussi à enfoncer la porte, quelqu’un tira et un manifestant à côté de moi reçut des chevrotines dans la tête. Nous avons trouvé des caisses de cocktails Molotov dans ledit local, je me rappelle bien les avoir fait sortir et, dans un instinct de contre-propagande, les avoir exposées pour que des photographes puissent les prendre et témoigner que les autres, en face, étaient armés…
Dans ma tête, ce soir-là, en insistant pour que ces photos soient prises, j’essayais naïvement d’inverser les preuves. Je comprenais tous les effets politiques de ce qui se passait, nous étions tout à fait à découvert, dans une action totalement minoritaire, étrangère et incompréhensible pour des millions de gens qui n’y participaient pas et ne pouvaient la comprendre, donc la défendre. Quelque part, le débat, hier abscons, entre les BI 30 et 33, était tranché, ceux concernant la réintroduction de la violence aussi, l’impatience gauchiste juvénile vis-à-vis d’un Mai 68- qui-devait-resurgir-armé-de-pied-en cap également.
Nous avions aidé « l’histoire à nous mordre la nuque ! »
Le lendemain, toute la presse titrait sur l’émeute. Les photos des cars enflammés s’étalaient partout.
Il fallut attendre Le Canard Enchaîné pour que soit dénoncé l’étrange attentisme de la préfecture de police, qui avait laissé faire, et le curieux manque de consignes et de communication entre les cars de police, qui tombaient à tour de rôle dans des traquenards, face à des segments de manifestations armés.
Les policiers perquisitionnèrent à l’aube au local de l’impasse Guéménée et y arrêtèrent les militants de garde, dont Pierre Rousset. Ils cassèrent tout. Ils trouvèrent les bouteilles placées au premier étage pour la défense du local contre une attaque fasciste. Et aussi, comble de désordre, deux vieux fusils de guerre, archaïques, apportés quelques semaines plus tôt par un individu mal identifié et que la CT avait oubliés là… Les flics mirent aussi la main sur l’éphéméride dans lequel Krivine avait écrit : « 20 juin, responsable Roger ; 21 juin, responsable Ludo. » Le juge lança un mandat pour retrouver « Roger » et « Ludo ». Mais surtout « Ludo », évidemment.
Pendant quelques jours, il y eut incertitude sur ce qui allait arriver de la part de Marcellin et du gouvernement. Une conférence de presse fut organisée dans nos locaux dévastés. Mais nous attendions la décision gouvernementale. Une enquête était ouverte. Serions-nous tous arrêtés ? Ou seulement quelques-uns ? Krivine était à Nice le soir du 21, c’était bien intentionnel, il ne pourrait être accusé…
La décision fut prise au BP de ne plus habiter dans nos appartements habituels. Et même de se dissimuler. Hubert Krivine insistait surtout pour que nous changions de visage, notamment « Ludo ». Celui-ci, au bout de huit jours, se fâcha tout rouge. Il se laissait pousser la moustache avec obstination, mais vu qu’il était imberbe, cela ne se manifestait que par un mince filet de poils. Nous tenions nos réunions chaque fois dans un lieu différent. Nous voilà comme les maos deux ans plus tôt. Belle affaire !
C’est ainsi que nous étions, le 28 juin, dans l’appartement de Jacques Charby (j’appris à cette occasion son aide au FLN pendant la guerre d’Algérie), près de Montparnasse, lorsque le communiqué du conseil des ministres tomba. Nous venions de faire un sondage informel au sein du BP réuni : qui pariait que nous serions dissous ? « Non, ils n’oseront pas », avait répondu la majorité écrasante des camarades, excepté Hubert Krivine et moi. J’étais très pessimiste. En effet, nous avons appris notre dissolution à midi pile, par la radio.
Silence. L’affaire était bouclée. Nous nous sommes regardés. Chacun pensait aux conséquences : le débat national, le débat international, l’organisation, les militants. Comment justifier une telle « connerie » ?
Le BP fit aussitôt bloc pour survivre. La polémique ne devait éclater que quelques mois plus tard, dans un CC clandestin réuni à Gand, en Belgique. En attendant, il fallait prendre des mesures, de sécurité, de défense de l’organisation, de défense démocratique.
La première mesure consista à cacher Krivine et Recanatti. Alain irait chez Michel Piccoli, Michel en Belgique. Il fallait éviter que tout le BP ne subisse le sort de Pierre Rousset.
La seconde fut de contacter toutes les organisations de gauche pour organiser une contre-campagne vis-à-vis du gouvernement. Cette fois, nous allions avoir besoin du « front unique ».
Je m’y collai : je pris mon bâton de pèlerin pour rencontrer tous les syndicats, tous les partis de gauche. Une camarade, notre trésorière, permanente, qui avait une moto, fut chargée de me véhiculer dans Paris. C’était « Thalou », de son vrai nom Sybille Fasso. Elle me convoya avec patience pendant les semaines suivantes. Dans le cadre de mon mandat pour organiser une défense démocratique unitaire, je rencontrai Louis Astre pour la FEN, rue de Solferino (ce n’était pas encore les locaux du Parti socialiste). Je fus reçu au Colonel-Fabien, mais seulement en bas, dans le hall, par un secrétaire responsable du Bureau politique qui m’écouta poliment sans rien medire.CitéMalesherbes,auPS,Claude Estierm’accueillitchaleureusement et je serrai la main de François Mitterrand. Je fus également reçu square Montholon par des responsables de second rang de la CFDT et me rendis à Louis-Blanc, rue Lafayette, alors local confédéral de la CGT.
Tous les permanents (environ vingt-cinq à l’époque) étaient ventilés dans des locaux différents, le PSU nous prêta deux pièces et un téléphone. Françoise quitta ainsi, forcée et contrainte, la librairie de Guéménée et alla travailler là-bas. Les cellules de militants étaient organisées avec tout un système de « rendez-vous secondaires » rapidement mis en place. Mille militants, sur Paris, plongèrent, de façon parfois très excessive, dans la clandestinité. Nous étions censés prendre des précautions, éviter d’être suivis quand nous nous rendions d’un point à un autre. Nous devions changer de lieu chaque nuit. Je n’allais plus à l’appartement où je logeais, rue Borda, après avoir quitté la rue Saint-Guillaume. Une fois, je fus hébergé pour la nuit, avec « Ludo », du côté de Château-Rouge, une autre fois chez une artiste sympathisante du côté de la Gaîté, ou encore dans un studio de la rue des Arquebusiers, dans le IIIe arrondissement.
Il fallait organiser une réunion unitaire : ce serait au local du PSU, rue Borromée, dans le XVe arrondissement. Je représentais la Ligue. Mais si tous les groupes d’extrême gauche étaient présents, les grandes forces démocratiques manquaient à l’appel. Charles Berg (plus tard connu, nous l’avons mentionné, sous le nom de Jacques Kirschner) était là, pour l’OCI. Ironique, il me faisait des « vannes » privées, hors sujet, mais bien informées, sur les conséquences de notre aventure dans les débats du SU (le Secrétariat unifié de la IVe Internationale devant assumer notre ligne guérilleriste face à la fraction dirigée par le Socialist Worker Party, qui y voyait déjà la conséquence concrète de notre ultra-gauchisme).
Il y avait Alain Geismar, pour moi, un revenant. Il me prit à part pour me donner des conseils fraternels et un peu paternels à partir de son expérience personnelle, quand il s’était retrouvé dans la même situation : comment ne pas se faire prendre ? Que faire ?
Finalement, un curieux meeting unitaire nous serait imposé par le PCF qui sentait le vent : l’opinion de gauche était pour nous. Les staliniens, c’était une première, allaient donc défendre les trotskistes. Ce serait au Cirque d’Hiver, le 4 juillet.
La réunion au local du PSU fut interrompue, on annonçait que la police était là. Les écoutes de la CT qui me parvenaient le confirmèrent. Il fallait que je parte car, apparemment, le seul but de cette présence policière, pour cette réunion-là, c’était moi. On me fit sortir à toute vitesse et enfourcher la moto du jeune Christophe Aguiton (dit « Vartang »), venu me chercher.
En fait, jamais la police n’a vraiment cherché à nous arrêter.
Nous avons eu le temps de lancer un « appel de personnalités » contre la dissolution, pour la libération de Krivine et de Rousset : Michel Rocard, Claude Estier, Jean Poperen, Albert Detraz, Louis Astre, Juliette Gréco, Michel Piccoli, Simone Signoret, Costa-Gavras, Robert Enrico, Laurent Schwartz, Alain Touraine, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Michel Foucault, Michel Leiris, des centaines de noms prestigieux s’alignaient en bas du texte en notre faveur.
Nous avons réussi à ressortir Rouge et une revue spéciale sur les événements, contre Ordre nouveau, contre Marcellin, et nous avons réoccupé les locaux ravagés de Guéménée.
Semi-clandestins, semi-plébiscités
Nos lieux secrets de réunions de BP devenaient de plus en plus « huppés ». Henri Weber avait trouvé un appartement avec piscine sur le toit aux Champs-Élysées. Nous nous retrouvions aussi chez Michel Piccoli, Juliette Gréco. En fait, tout cela représentait pour la police un secret de Polichinelle.
Nous devions trancher : la Ligue serait-t-elle « clandestine », comme les maos, ou allions-nous choisir d’assumer notre défense publique ? C’était absurde de militer clandestinement dans la France de 1973, nous n’étions ni en Argentine ni en Uruguay. Un BP spécial, très tendu, se réunit, rue de l’Université. Il fut décidé qu’Alain Krivine tiendrait une conférence de presse, le lendemain, et qu’il se ferait arrêter s’il le fallait. Il y eut un vote très majoritaire, explicite sur ce point : « pour » qu’Alain se fasse arrêter.
Nous avons appelé le PS, sans nous interroger, cette fois, sur sa nature de classe, pour demander à Charles Hernu de nous prêter le local des élus socialistes et républicains, place de l’Hôtel-de-Ville. Il accepta. À l’aube, Henri Weber réveilla François Mitterrand et Edmond Maire, il leur expliqua à tous deux séparément que Krivine parlerait à la presse et qu’il serait sûrement arrêté. La réponse des deux fut : « Ils n’oseront pas. » Henri insista. François Mitterrand et Edmond Maire se consultèrent et décidèrent, finalement, de venir en personne place de l’Hôtel-de-Ville, mais de n’apparaître que s’il se confirmait que le gouvernement voulait vraiment l’arrêter.
Alain Krivine parla ce jour-là devant une nuée de micros et de caméras. Nous écoutions les radios de la police retransmises par la CB de la CT au Bureau politique, depuis la rue de l’Université. Les abords de la conférence de presse grouillaient de policiers, leur mission était claire : l’arrestation. Avertis par nous, Mitterrand et Maire choisirent alors d’apparaître par une porte de côté, en cours de conférence de presse, et la presse, stupéfaite, les vit soutenir Krivine. Tout s’agitait, c’était l’événement, le maximum de remous. Bien joué ! François Mitterrand demanda à Krivine ce qu’il voulait faire après son speech à la presse. Il offrait, si Krivine l’acceptait, de le faire venir au local du PS, cité Malesherbes. Après consultation par CB et téléphone, notre réponse fut « oui ».
Le cortège de voitures partit de l’Hôtel de Ville pour le local du PS, Krivine entre Mitterrand et Maire. Affolement dans les radios de la police. L’ordre était d’attendre, Alain arriva libre cité Malesherbes. Mais là, que faire ? Y rester ? Mitterrand l’avertit que c’était possible. Nouvelles consultations par téléphone : nous avions voté pour qu’Alain se fasse arrêter, il devait se faire arrêter. Quel sens de rester à Malesherbes au local du PS ? Il devait donc sortir, puisque les flics n’osaient pas le prendre dans les locaux. Alain transmit sa décision à Mitterrand et à Maire, qui montèrent avec lui ce scénario : il sortait, les deux leaders l’accompagnaient jusqu’à la porte de la cité, puis Charles Hernu et Claude Estier iraient avec Alain jusque chez lui, puisqu’il habitait un peu plus bas, rue Saint-Georges. C’est ce qui se passa, on vit Alain Krivine entre François Mitterrand et Edmond Maire sur toutes les photos. Tandis qu’ils marchaient tous les trois, le premier secrétaire du PS commentait sur un ton amusé les détails de l’architecture de la cité, pour, comme il l’avait expliqué auparavant à Alain, « faire naturel » devant les photographes.
Tous les médias retransmirent directement les événements. En descendant la rue Saint-Georges, Alain fut interpellé par un passant solidaire qui lui demanda : « Qu’est-ce que je peux faire pour vous ? » « De l’argent pour l’organisation », répondit-il, et la personne lui en donna. Alain était arrêté chez lui, quelques instants plus tard, par la police enfin décidée à appliquer sa mission. Il resterait à la Santé jusqu’au milieu du mois d’août.
L’opinion évoluait. Le Monde, Le Nouvel Observateur, Le Canard enchaîné, L’Humanité dénonçaient maintenant « le piège de Marcellin ». La Fédération autonome des syndicats de la police, par la voix de Gérard Monatte, s’interrogea aussi sur ce qu’avait vraiment voulu faire le pouvoir.
Les révélations se multipliaient, qui nous rendaient victimes d’une volonté manichéenne du pouvoir. La thèse de la provocation policière prenait une telle importance que la police dut réfuter les arguments un à un. Le ministre de l’Intérieur en personne dut intervenir sur la première chaîne de la télévision : il contre-attaqua et accusa Mitterrand et Marchais de faire le jeu des gauchistes en défendant la Ligue communiste dissoute. Dans ces conditions, le meeting du 4 juillet du Cirque d’Hiver rassembla toute la gauche et fit le plein. « Le Parti communiste français proteste contre la dissolution de la Ligue communiste. » L’Humanité précisait : « La dissolution de la Ligue communiste, l’arrestation de ses principaux dirigeants, c’est d’abord une atteinte aux libertés de tous. » Le seul hic était le veto du PCF au fait que nous parlions au cours du meeting. Ils nous défendaient tout en nous faisant taire.
Il y avait eu beaucoup d’hésitation dans notre BP : une partie des camarades voulait s’orienter vers une activité clandestine prolongée, en attendant, sans doute, le grand soir qui n’allait pas tarder… Il fallait donc mesurer qui d’entre nous allait apparaître en public. Comme j’avais déjà eu la charge de la conférence de presse à Guéménée, comme j’avais pris les contacts unitaires, on m’y colla encore.
Il fut décidé que je me tiendrais à l’intérieur du Cirque d’Hiver avec Jean Métais, qu’Henri Weber serait à l’extérieur avec le SO. Quand j’arrivai dans la salle, derrière la tribune, alors que tous les acteurs se répartissaient l’ordre de parole, j’essayai de négocier encore notre intervention. Jacques Duclos, que j’interpellais, me tourna grossièrement le dos aussitôt. C’est Daniel Meyer, embarrassé, qui me prit par la manche pour me rassurer : « On ne parlera que de vous ! » Certes, mais en nous censurant ! J’interpellai Jean Le Garrec qui allait parler, comme les autres, six minutes au nom du PSU, et lui suggérai de partager la parole à ce moment-là, depuis la tribune. Il refusa. Dans la salle archi-bondée et dehors, où se massaient des milliers de personnes, les cris fusèrent : « Libérez Krivine », « La parole à la Ligue. » Ce fut un chahut monstre. Au fur et à mesure que se succédaient les orateurs, la salle se divisait pour ou contre la « parole à la Ligue ». Je tentai, quand ce fut au tour de Jean Le Garrec, de monter sur une chaise, dans un brouhaha indescriptible, pour demander modestement « trois minutes ». Rien. Seul Duclos, excellent orateur, vieux routier stalinien, força l’attention et les applaudissements de la salle. Mais il est vrai que nous avions la vedette et que la censure nous concernant choquerait ; nous y gagnerions un statut confirmé de double victime de l’ostracisme à la fois du pouvoir et des staliniens. Ces derniers avaient été amenés à nous défendre et à ne pas se rendre sympathiques. Je sortis du Cirque d’Hiver alors qu’Henri Weber, dehors, essayait de parler à la sono, le SO m’entoura et m’emmena jusqu’à la fuite programmée sur la moto de « Thalou ». Nul ne fut poursuivi.
Belle histoire ! Partout en province nos camarades rencontraient une solidarité active, tenaient des meetings nombreux et combles, en cette période de juillet où normalement les gens partaient en vacances. Ils étaient ravis, on parlait de nous partout, nous recrutions, nous nous renforcions spectaculairement.
Ce qui me vaudrait, deux mois plus tard, à la réunion nationale de bilan, un isolement total quand je voudrais critiquer notre « action exemplaire du 21 juin ».
Joe Baxter
La police fit une seule enquête sérieuse. J’avais hébergé, rue Borda, pendant quelques mois, un militant argentin en exil, Joe Baxter, connu comme l’un des fondateurs des Tupamaros, puis comme l’un des dirigeants de l’ERP. Hubert Krivine l’appelait « El gordo » et le respectait infiniment, c’est pourquoi j’étais ravi de le loger. Il était au demeurant fort sympathique, bon vivant et intéressé par la politique « rationnelle » telle qu’on la vivait, selon lui, en France. En fait, il avait plus ou moins rompu avec l’ERP, avec son chef Roberto Santucho, lequel se réclamait davantage de Kim Il-Sung, de Mao Zedong, de Hô Chi Minh et de Castro que de Trotski… et des nôtres. Il me raconta l’histoire de l’ERP et j’appris avec stupéfaction les dégâts idéologiques du militarisme terroriste, les « revues » sur la fabrication des armes « terre-mer » façon armée française, la discipline militaire, les « gradés », les « prisons du peuple » où l’on enfermait les mauvais guérilleros, les sanctions internes, etc.
Joe Baxter avait prévu de quitter Paris le 20 juin 1973 pour Santiago du Chili. Je le vis une dernière fois avec sa compagne, Rosa, place Clichy, avant qu’il ne prenne l’avion pour le Chili où, nous le savions, les choses se gâtaient. Un peu après son arrivée, le 29 juin, il devait y avoir le tancazo, la première tentative de coup d’État de l’armée contre Salvador Allende. C’était une sorte de répétition générale de la droite militaire pour vérifier comment réagiraient les forces vives de l’Unité populaire si les chars sortaient dans les rues. Joe Baxter s’était aussitôt, en bon combattant, rendu dans les entreprises, aux côtés d’Hugo Blanco, et avait constaté l’impuissance dans laquelle se trouvaient les travailleurs pour résister, sans organisation, sans directives et… sans armes ! Les guérilleros locaux ne lui avaient guère inspiré confiance : « J’ai vu des têtes moustachues circuler dans des mini- Austin », disait-il cyniquement en parlant du service d’ordre du MIR allant d’une entreprise à l’autre. Dans son récit téléphonique du 30 juin, il était sévère et désespéré sur les conditions dans lesquelles le mouvement ouvrier chilien pourrait résister si l’armée décidait véritablement de faire un coup d’État. Hélas, on allait le vérifier soixante-dix jours plus tard, quand Kissinger donnerait le véritable ordre de la tuerie à Pinochet.
Mais lorsque, de notre côté, nous avions averti Joe Baxter que nous étions « dissous », il avait hurlé qu’il ne fallait pas plaisanter, que le téléphone coûtait cher… Lui, grand admirateur de la politique rationnelle conçue par les Européens, parti le 20 juin de Paris, le jour calme de la manifestation unitaire contre la répression, ne pouvait imaginer que le lendemain 300 cocktails Molotov brûlaient dans Paris et que le 28 juin Marcellin nous interdisait ! Nous avons dû l’assurer que nous ne plaisantions pas. Il reçut les journaux français, nous rappela… et nous promit une surprise, pour quelques jours plus tard.
La surprise fut amère. Le 5 juillet, l’avion de la compagnie brésilienne Varig devait s’écraser à Orly, faisant près de 300 morts. Les passagers furent asphyxiés par un gaz dégagé à cause de l’incendie d’une matière toxique contenue dans les parois.
La seule enquête sérieuse de la police après le 21 juin fut de chercher à savoir pourquoi le corps de Joe Baxter se trouvait à bord de cet avion en possession d’un faux passeport appartenant à un membre de la IVe Internationale britannique et d’une mallette contenant 40 000 dollars. Les policiers interpellèrent plusieurs de nos camarades, montrant des photos où Joe Baxter sortait du local, impasse Guéménée, en compagnie d’Alex, de Jean-Pierre Beauvais, de moi…
Que s’était-il passé ? On nous l’expliqua ensuite. Joe Baxter, qui était l’un des responsables de l’enlèvement et de la mort de Sallustro, événement que nous avions si bien « suivi » lors de notre IIe congrès à Rouen, avait appris que la Fiat avait passé dans les journaux, en Argentine, des petites annonces pour chercher à contacter la guérilla, les ravisseurs. Elle souhaitait prendre une « assurance » pour que ses cadres et responsables ne soient plus menacés. Joe Baxter, à l’annonce de notre dissolution, était tout simplement allé « vendre » cette assurance et avait pris l’avion de Santiago, puis changé pour la Varig, afin de nous venir en aide… Ce geste et ce sacrifice ne nous servirent pas.
Isolé
Alain Krivine sortit, en pleine forme et rayonnant, de la Santé, sans être autrement poursuivi, au bout de quatre semaines. Toujours chargé de l’apparition publique, porte-parole de remplacement, j’allai le chercher à la porte de la presse, avec la presse. Nous nous sommes aussitôt rendus chez Jean Daniel, au Nouvel Observateur, sur l’entregent de Gilles Martinet, pour rédiger un article sur le marbre avant le bouclage (l’hebdomadaire avait déjà donné un coup de pouce en racontant que Krivine, s’il était à Nice, au fond, c’était parce qu’il n’était pas d’accord avec ce qui se passait ce soir-là dans les rues de Paris…). Puis nous sommes allés chez les parents Krivine fêter la sortie du rejeton.
Le Comité central de la Ligue dissoute se réunit à Gand. Les camarades belges nous firent traverser la frontière séparément sans problème, louèrent une salle et créèrent les meilleures conditions de travail. Sauf que nous ne pouvions conserver les textes soumis au vote, pour des raisons de sécurité. Comme j’en avais gros sur le cœur, j’écrivis une contribution de rupture, très critique, avec ce que nous avions fait. Je voulais que non seulement nous dénoncions les dérives du fameux BI 33, mais que nous en revenions à une orientation de construction sérieuse pour un nouveau parti tourné vers les masses – et non pas soumis aux pulsions gauchisantes.
Je croyais le moment venu de le dire. Mal m’en prit, car il y avait enthousiasme et quasi-unanimité pour approuver l’action du 21 juin ! Je fus maltraité, sinon tout à fait méprisé. Les camarades étaient ravis d’avoir eu l’occasion d’être au centre de l’actualité, ils avaient été fêtés partout en province, traités en héros grâce à notre « hardiesse », s’étaient attiré une sympathie inouïe. Pour la première fois, le PC avait été obligé de nous défendre, de nous soutenir, pas seulement le PC, toute la gauche. Nous avions défié le gouvernement et qu’avions-nous perdu ? Rien, Rouge paraissait, nous étions rentrés dans nos locaux, nous agissions sous le nom du journal, nous recrutions. Certes, nos stages d’été avaient été annulés et nous avions un problème d’identité à terme, mais à quoi bon se plaindre, le bilan était positif !
Il y eut bien quelques nuances. D’une part, les plus gauchistes, partisans du BI 30, voulaient que nous profitions de l’occasion pour nous structurer clandestinement. Puisque, de toute façon, l’explosion sociale était proche, autant transformer un inconvénient en avantage ! La grève de Lip montrait, selon eux, le degré de maturité des travailleurs, l’intervention de la police le 15 août à Palente prouvait la violence du capital, il fallait parfaire l’éducation des militants, des cellules, renforcer le rôle de la CT, lancer de nouvelles « actions exemplaires ». À l’inverse, inclinant plutôt de mon côté, les responsables du « travail ouvrier », Janette et « Radot », minimisaient le rôle des « actions exemplaires », les subordonnant à notre travail syndical, mais ne voulaient pas s’opposer sérieusement, ni surtout engager un débat avec toutes ses conséquences prévisibles.
J’obtins une voix, une seule, la mienne, sur mon texte.
J’étais isolé.
Presque dix ans de militantisme, une grande crise révolutionnaire sans
précédent et c’était, pour moi, l’échec. Que faire ? Baisser les bras ? J’y songeais.
Nous avons tous changé nos pseudos. À l’heure où, trente ans après, la Ligue a abandonné ceux-ci, il n’y a plus guère de mystère, sauf, un peu de jeu, de mémoire, de sourires, à ce propos. Nous nous appelions toujours par nos pseudos dans les réunions, dans les BI, si bien que, de longues années après, je reconnais certains visages sans avoir jamais su le vrai nom correspondant. On me dit : « Mais si, Untel, tu sais, qui a été longtemps à la Ligue… » Et je ne sais pas du tout qui est Untel. Parfois, je mélange, ou je confonds, à cause des changements consécutifs aux dissolutions de 1968 et de 1973. Façonné, j’ai encore des scrupules réflexes, alors que ça n’a plus d’importance de donner à la fois le nom et le pseudo.
Dans une réunion de BP clandestine… sur les Champs-Élysées, je choisis « Matti » à cause de mon admiration pour ce héros de Brecht. Charles Michaloux s’emballa : « Alors, je choisis Puntila. » « Chiche ! » Il y renonça pour le nom d’une ville où il avait été élevé enfant.
La Ligue issue du Mai du quartier Latin était morte, mais elle ne le savait pas encore.
Interdite en symétrie d’Ordre nouveau, rangée dans l’extrémisme, elle était certes sympathique à de petites franges, mais étrangère à la grande masse de ceux qui allaient, peu à peu et de plus en plus, placer, de 1973 à 1981, leurs espoirs dans l’Union de la gauche.
La dissolution officialisait pour nous la fin de ces cinq années de bouillonnement où nous espérions que Mai 68 allait reprendre à tout moment.
Nous vivions dans une illusion de Mai des barricades, alors que le Mai massif, ouvrier et jeune survivait en profondeur. Nous avions fini par nous identifier au Mai mondain dont la presse nous renvoyait l’image, car il parlait de nous. Nous désespérions de comprendre le Mai social et de nous y mêler.
Même Alain Krivine ou Daniel Bensaïd expliquaient dans les médias que nous étions « nés en mai », alors que la LC était une section de la IVe Internationale créée en 1939 par la volonté de Léon Trotski. Nous passions ainsi plus pour des étudiants que pour un courant du mouvement ouvrier. Le pire, c’est que nous avions rompu avec le mouvement traditionnel des étudiants en rêvant chaque matin du grand soir. Sans doute, par ces impatiences, ce gauchisme, avions-nous gâché les chances de construire un nouveau parti de gauche. Car s’il y a eu une « fenêtre » pour y parvenir, ce fut bien dans ces années 1968-1973. La LC, hélas, s’est mise dans une mauvaise voie, dans un mauvais réseau, et a raté tous les wagons et trains successifs.
La Ligue, avec retard sur les éphémères maos, se trouvait confrontée au mur de la réalité. Non, le « vieux » mouvement ouvrier n’était pas relégué dans les poubelles de l’histoire. Non, la social-démocratie n’était pas définitivement morte. Et nous n’allions pas mordre la nuque de l’histoire ni ranger le mouvement étudiant puis la classe ouvrière directement – universités rouges et usines rouges – sous notre bannière triomphante !
Le Chili, Lip, le Mlac, l’antimilitarisme et une nouvelle élection présidentielle allaient encore nous occuper avant qu’au congrès de décembre 1974 une autre page de l’histoire de la Ligue ne s’ouvre, celle du débat de tendances et de l’Union de la gauche.
une autre version gauchiste de l’évènement :
21 juin 1973 : quand l’extrême gauche écrasait le fascisme dans l’œuf (vraiment ultra gauche)
Le 21 juin 1973, à l’appel de la Ligue communiste, des milliers de manifestants casqués et armés prennent d’assaut un meeting raciste d’Ordre nouveau protégé par la police. Tournant dans l’histoire de l’extrême gauche de l’après-1968, cette manifestation reste un souvenir vivant de l’antifascisme et de son actualité.
par. Mathieu Dejean
15 janvier 2023 à 11h18
IlIl est minuit passé, au soir du jeudi 21 juin 1973, quand les membres de la « commission technique » (CT, ancienne CTS, « commission très spéciale ») de la Ligue communiste se retrouvent à leur point de rendez-vous, une brasserie parisienne en face de la gare de l’Est. La CT est la direction du service d’ordre de la Ligue, qui s’occupe des actions extralégales. Michel Recanati (pseudonyme : Ludo), en charge de la manifestation coup de poing contre le meeting d’Ordre nouveau à la Mutualité, attend ses camarades de pied ferme.
Ils arrivent au compte-gouttes. Michel Angot (Laszlo, pour les camarades) fait son entrée. Recanati l’envoie aux toilettes se laver le visage, noir de la fumée des cocktails Molotov – 400, saura-t-on plus tard – qui ont déferlé sur les policiers durant les heures précédentes, faisant 76 blessés. Le militant avait traversé tout Paris en métro sans s’en rendre compte. Les huit membres de la CT sont dans un état second, dopés à l’adrénaline.
La une de « Rouge » en 1973, après la manifestation du 21 juin et la dissolution de la Ligue communiste. © Illustration Simon Toupet / Mediapart
L’analyse des événements commence, dans une odeur d’essence suspecte. « Une analyse militaire », précise aujourd’hui Michel Angot, le regard aussi clair que sa mémoire. Sur une feuille, dans son appartement parisien, l’ancien militant de la Ligue dessine un plan du Quartier latin, de l’arrêt de métro Censier-Daubenton à la Mutualité, que relie la rue Monge – le terrain des affrontements. Tout avait été méticuleusement planifié.
Cinquante ans plus tard, c’est tout un monde enfoui qui resurgit. Une époque où le consensus social pour interdire la parole à l’extrême droite était acquis, où une extrême gauche aux méthodes de plus en plus musclées rayonnait au point d’obtenir le soutien de la gauche officielle, du Parti socialiste à la CFDT. Et où les actions de cette journée déboucheront sur la dissolution, ordonnée le 28 juin 1973 par le gouvernement, de la Ligue communiste (LC) et d’Ordre nouveau.
Une « petite déviation militariste »
Gérard Chaouat, spécialisé dans les « aspects techniques », avait mis au point des appareils récepteurs pour écouter les communications de la police. Des camarades avaient discrètement dissimulé du « matos », la veille de la manifestation, sur l’itinéraire prévu – barres de fer et autres pieds de biche, déposés dans de fausses caisses du service de la voirie de la Ville de Paris. Une voiture amènerait des bouteilles derrière les arènes de Lutèce, pour les cocktails Molotov. Avec les nouvelles chaussettes en nylon et un mélange d’essence et de pétrole testé préalablement, l’explosion à l’impact est spontanée.
La CT, composée de militants triés sur le volet, baigne dans une culture révolutionnaire mâtinée de violence politique. Celle-ci est omniprésente dans le contexte post-68. Dans les débats de la Quatrième internationale, l’influence de la « guerre de guérilla » en Amérique latine ou des Zengakuren au Japon (des fédérations étudiantes organisées en redoutables commandos casqués) est palpable. Avec les Brigades rouges en Italie et la Fraction armée rouge en Allemagne, l’escalade de la violence déborde l’extrême gauche.
En France, le service d’ordre (SO) de la Ligue affronte déjà depuis quelques années des milices patronales aux méthodes musclées, comme la Confédération française du travail aux usines Citroën de Rennes. L’assassinat du militant maoïste Pierre Overney, tué par un vigile de Renault en 1972, a jeté un froid. Les groupes maoïstes, la Gauche prolétarienne en tête, analysent la situation comme « préfasciste ». Sa « branche armée », la Nouvelle Résistance populaire, dirigée par Olivier Rolin, passe à la clandestinité.
C’est dans ce contexte bouillant que la CT a travaillé. A posteriori, Michel Angot reconnaît, en euphémisant, une « petite déviation militariste ». « À partir du moment où tu fais des opérations de plus en plus professionnelles, où tu chiades l’armement des camarades, tu structures les troupes, tu parles avec un langage militaire, on peut dire qu’il y a eu cette tentation militariste », dit-il.
Le 21 juin 1973, donc, les manifestants arrivent par groupes de vingt, avec des rendez-vous secondaires pour perdre les policiers. Place Monge pour le SO, métro Censier-Daubenton ou Cardinal-Lemoine pour les autres. Un ultime « PC » (poste de coordination) est prévu rue Monge, dans l’appartement d’une camarade situé, idéalement, au cinquième étage. C’est de là que sont filmées les images aériennes de la manifestation dans le film de Romain Goupil (un des dirigeants du SO à l’époque) Mourir à trente ans. « Notre stratégie était de descendre la rue Monge vers la Mutualité : elle présente l’avantage d’être en pente, assez large pour faire une manif de front, et il y a deux lignes de métro, la 7 et la 10, dont une ne serait pas surveillée », raconte Michel Angot.
Article du journal « Rouge » le 15 juin 1973.
L’ancien du lycée Buffon (XVe arrondissement) – où il se bagarrait déjà avec le futur secrétaire général d’Ordre nouveau, Alain Robert –, un des rares du SO à ne plus être étudiant en 1973, avait posé trois jours de congés en amont. Rouge, l’hebdomadaire de la Ligue, avait appelé, dans son édition du 15 juin, « tous les antifascistes à exiger en commun l’interdiction du meeting prévu le 21 juin à Paris par les nazis ».
« Si le pouvoir laisse faire, nous prendrons nos responsabilités […] : le meeting d’Ordre nouveau ne se tiendra pas », prévenait le journal. Le groupuscule d’extrême droite, adepte des ratonnades, et qui faisait office de service d’ordre du tout jeune Front national, comptait lancer une campagne sur le thème : « Halte à l’immigration sauvage ».
Le Bureau politique (BP) de la Ligue, dont plusieurs membres sont issus de familles juives portant la mémoire du génocide, répond par le mot d’ordre : « Écraser la peste brune ». « La décision unanime du BP a été d’empêcher le premier grand meeting fasciste après 68 de se tenir. C’était en plus une vraie provocation, car il devait avoir lieu au Quartier latin, c’est-à-dire chez nous », rapporte Janette Habel (pseudonyme de Jeannette Pienkny), la seule femme membre du BP.
Les maoïstes de La Cause du peuple, de L’Humanité rouge et de Prolétaire-Ligne rouge, ainsi que Révolution ! (dite « Révo », une scission de la Ligue), ont répondu présents – ils auront une place dans le SO de tête. On leur prête un rôle important dans l’avalanche de cocktails Molotov, qui a surpris même les plus aguerris. « Sur la nécessité d’écraser le fascisme dans l’œuf, il n’y avait pas l’ombre d’une divergence entre nous », rapporte un des dirigeants de Révo à l’époque, qui préfère taire son nom.
La gauche officielle, liée depuis peu par le Programme commun, préfère défiler calmement le 20 juin contre le racisme et pour « l’élargissement de la liberté » – « un sommeil organisé, avec pour fin les élections », raillera quelque temps plus tard Philippe Gavi, fondateur deux mois plus tôt de Libération, quotidien d’obédience mao.
Le BP de la Ligue donne des consignes claires : un affrontement limité, qui marque le coup. La CT prend la tâche très au sérieux. Elle peut s’appuyer sur un SO digne d’une véritable organisation bolchevique, composé d’anciens lycéens de Mai-68, qui ont souvent fait leurs armes au Front universitaire antifasciste (FUA). Certains ont côtoyé Pierre Goldman, connu pour son expérience des combats de rue. Il aurait sûrement été de la partie s’il n’avait pas séjourné en prison en 1973.
Débordement général
Le soir du 21 juin, entre 3 000 et 5 000 personnes font irruption rue Monge, casquées pour la plupart et le visage dissimulé derrière un foulard. L’esthétique zengakuren saute aux yeux. « Quand on a appelé à cette manif, les gens savaient pourquoi ils venaient, la violence était prévue. Les gens venaient là pour interdire un meeting, pas que pour dénoncer », analyse Alain Cyroulnik, « Cyroul » pour les intimes, membre de la CT. Quelques slogans sont lancés : « Ordre nouveau, ordre fasciste ! » Les minutes d’attente des derniers arrivants avant l’assaut semblent longues.
À l’avant, les militants de Révo s’impatientent de ce désordre un peu trop ordonné à leur goût : « On se demandait quand la LC allait déclencher les hostilités », rapporte l’un d’eux. Le SO de la Ligue, informé de la structuration du cortège par des estafettes à mobylette, finit par sonner la charge. « On se tenait par les coudes, très serrés les uns derrière les autres. On a avancé, c’était fort et massif. Il devait y avoir quinze ou vingt rangs de gens casqués, alors qu’il n’y avait que cinq ou six rangs de SO ! », s’étonne encore Michel Angot. La première rangée de brigades spéciales qui barre la rue ne fait pas le poids. Elle éclate. Des deux côtés de la voie, des groupes de lanceurs de cocktails Molotov, commandés respectivement par Alain Cyroulnik et Michel Angot, font leur œuvre incendiaire.
« Les cocktails Molotov pleuvent, c’est un miracle qu’il n’y ait pas eu de morts dans l’affrontement, ç’aurait été possible », se remémore Janette Habel. Certains policiers, tombés entre les trotskistes, sont exfiltrés tant bien que mal. Le SO a interdiction absolue de faire des « victimes de campagne ». « Je suis personnellement intervenu quand j’ai vu un flic par terre, j’ai dit aux camarades que c’était la peste brune qu’on voulait écraser », rapporte Cyroulnik.
Après le choc contre le deuxième barrage policier, obligé de reculer, la manifestation se disperse progressivement, sous la protection du SO. Un peu plus tard, deux cents militants qui ne s’étaient pas dissous franchissent le pont d’Austerlitz pour faire une descente au local d’Ordre nouveau, rue des Lombards, près des Halles. Romain Goupil et Alain Cyroulnik, qui sont du commando, rapportent les faits à Recanati dans le bistrot de la gare de l’Est, au milieu de la nuit. Personne ne bronche.
Le meeting contre l’« immigration sauvage » a eu lieu en très petit comité. Les « rats noirs » ont rasé les murs.
Dans le chaos, alors qu’une chaîne retenait la dernière porte blindée, un coup de fusil a été tiré par un des membres de l’organisation d’extrême droite – un militant de quatorze ans. Un document interne d’Ordre nouveau parle d’une main arrachée côté trotskiste. Cyroulnik dément : « Ils avaient un fusil, un militant paniqué a tiré, mais il n’y a pas eu de blessés. » « On a tous entendu parler de ça, mais on n’a eu aucun camarade blessé le 21 juin, c’est d’ailleurs complètement dément », assure Michel Angot.
À chaud, gare de l’Est, les membres de la CT font un bilan globalement positif. Certes, ils n’ont pas atteint la Mutualité, mais le SO d’Ordre nouveau est resté sagement derrière les policiers. Le meeting contre l’« immigration sauvage » a eu lieu en très petit comité. Les « rats noirs » ont rasé les murs.
« Même Reca [Recanati – ndlr] ne s’est pas dit que c’était peut-être une bavure, on n’a pas pensé que ça pouvait mettre l’organisation en péril, car au BP personne ne s’y était opposé », rapporte Angot. Le cinéaste Bertrand Tavernier, proche des trotskistes lambertistes de l’Organisation communiste internationaliste (OCI), regrettera même qu’ils n’aient pas rejoint cette action, jugée trop « gauchiste ».
Crise interne à la Ligue
La troupe d’élite du SO ne mesure pas la crise dans laquelle cette action va plonger l’organisation. Le lendemain, Pierre Rousset, membre du BP, est arrêté lors de la perquisition policière au siège de la Ligue communiste. La rumeur d’une dissolution imminente se propage. Alors que les trotskistes se cachent chez des artistes sympathisants (Michel Piccoli, Juliette Greco, Jean Seberg, Marguerite Duras…), un clivage latent depuis 1972 explose entre la tendance jugée « gauchiste », incarnée notamment par Daniel Bensaïd (« L’histoire nous mord la nuque », disait-il), et la tendance dite « ouvriériste » défendue par Janette Habel et Gérard Filoche.
Janette Habel, présente à l’arrière de la manifestation le 21 juin, ouvre les hostilités. Lors d’une réunion clandestine du BP chez le comédien Jacques Charby, elle dénonce leur aventurisme. Les moyens techniques utilisés étaient totalement disproportionnés et risqués, accuse-t-elle. « La critique porte sur le fait qu’on y voit une véritable autonomisation du SO par rapport à la direction de l’organisation. Quatre cents cocktails Molotov, très bien faits, plus les pieds de biche, ça faisait beaucoup. Une discussion très houleuse commence », relate celle qu’on appelait alors « la Cubaine ».
Au-delà même des rangs de la Ligue, toute l’extrême gauche s’interroge sur les leçons à tirer.
Henri Weber et Daniel Bensaïd, qui assuraient le lien entre le BP et la CT, étaient-ils informés de l’ampleur des moyens mobilisés ? Le doute demeure. « Je crois que tout le monde, indépendamment des divergences qu’on a pu avoir, a été surpris, car je suis formelle : on n’était pas au courant. Il n’y a eu aucune prévision au BP des risques que cette affaire faisait courir », affirme Janette Habel.
Au-delà même des rangs de la Ligue, toute l’extrême gauche s’interroge sur les leçons à tirer. L’historien Benjamin Stora, membre de la direction de l’OCI, l’organisation trotskiste rivale de la Ligue, rapporte ce séisme dans La Dernière génération d’octobre : « L’épisode du 21 juin laissa des traces dans toute l’extrême gauche, y compris dans nos rangs. Bien sûr l’OCI n’avait jamais plaidé pour l’exemplarité d’une violence avant-gardiste [...]. Mais la tentation du gauchisme extrême, pouvant basculer dans le terrorisme, touchait des secteurs significatifs de la jeunesse et n’épargnait aucune organisation toujours prompte à convoquer des services d’ordre, très “équipés”, pour les manifestations. »
Après l’annonce de la dissolution de la Ligue communiste et d’Ordre nouveau par le gouvernement, et une réunion clandestine du comité central où la minorité est traitée violemment de « droitière », il est convenu que la défense de l’existence démocratique de l’organisation doit primer, plutôt que le passage à la clandestinité. Alain Krivine doit se laisser arrêter. Il tient une conférence de presse rue de Rivoli, dans un local prêté par le Parti socialiste (PS), où Charles Hernu l’accueille. L’ex-leader étudiant de Mai-68 y dénonce un coup monté par le ministre de l’intérieur, Raymond Marcellin, qui aurait sciemment sous-équipé les policiers pour pouvoir dissoudre la Ligue.
Dans ses mémoires, Krivine maintient : « Nous ne comprîmes que plus tard que nous étions tombés dans un piège. En sous-équipant ses hommes en grenades lacrymogènes, Raymond Marcellin espérait souder la police contre l’extrême gauche et développer un syndicalisme policier d’extrême droite face à la Fédération autonome des syndicats de police (FASP), proche du Parti socialiste et alors largement majoritaire. »
Il apparaît ensuite devant les caméras au siège du Parti socialiste, cité Malesherbes, flanqué de François Mitterrand et d’Edmond Maire, le secrétaire général de la CFDT.
Edmond Maire et François Mitterrand entourent Alain Krivine avant son arrestation le 28 juin 1973, au siège du Parti socialiste. © Photo collectif RaDAR
Le 4 juillet 1973, la gauche officielle tient meeting au Cirque d’hiver pour défendre la Ligue. L’avocat de la Ligue des droits de l’homme, Yves Jouffa, joue un rôle clé d’entremetteur. Signe des temps, et union de la gauche oblige, même le vieux dirigeant du Parti communiste (« un parti stalinien de la plus belle eau », dixit Janette Habel), Jacques Duclos, prend la parole pour se solidariser de la Ligue et réclamer la libération d’Alain Krivine. En contrepartie, les trotskistes ne s’expriment pas à la tribune.
« Paradoxalement, la dissolution de la Ligue a accru son audience et crédibilisé son image auprès du mouvement ouvrier, dont les communistes. Le courant que représente la LC a été pleinement admis au sein de la gauche après cet événement qui aurait dû la marginaliser », analyse le sociologue Ugo Palheta, militant du Nouveau Parti anticapitaliste (NPA). Après une courte période de sommeil, la LC se reforme sous le nom de Ligue communiste révolutionnaire (LCR).
« Le FN aurait pu mourir à ce moment-là »
En 1987, quand Alain Krivine jette un coup d’œil dans le rétroviseur, il considère la date du 21 juin 1973 comme une rupture : « La dissolution de la Ligue en 1973 clôt une époque. Celle de l’action directe, dans la rue. […] La montée de l’union de la gauche, la renaissance du Parti socialiste, l’apparition d’une solution électorale transformaient les conditions de notre intervention politique. »
L’extrême droite, elle, est accablée. D’autant plus que les antifascistes ne les lâchent pas. « Ils étaient moins présents dans la rue, mais on les surveillait : on avait récupéré des fichiers de fafs à la fois à leur local rue des Lombards et à Assas [suite à la mise à sac de leurs locaux dans l’université par la LC et les lambertistes, en 1971 – ndlr], raconte Michel Angot. Quand il y a eu l’éclatement avec le GAJ [Groupe Action Jeunesse], qui était très violent, ils ont commencé à s’affronter, on les a manipulés, si bien que quand le Parti des forces nouvelles [PFN] issu d’Ordre nouveau apparaît deux ans après, c’était un tout petit truc sans légitimité, accroché au FN. »
« Le FN aurait pu mourir à ce moment-là, abonde Ugo Palheta. Ils sont au fond du trou, notamment après l’échec absolu de leur campagne aux législatives de 1973, financée par des fonds du MSI [héritier du fascisme italien – ndlr]. Le Pen ne peut d’ailleurs pas se présenter à la présidentielle en 1981, et le PFN, qui drague la droite libérale voire gaulliste, non plus. La ligne d’indépendance totale du FN vis-à-vis de la droite traditionnelle ne lui permettra de percer que plus tard, dans les années 1980. »
Jean-Pierre Tatin, qui militait à Ordre nouveau, note toutefois que sur le moyen terme, Jean-Marie Le Pen tire son épingle du jeu : « La dissolution donne une chance inouïe à Le Pen. Il était isolé, et il devient le chef du seul mouvement légal. Il n’a plus de rival. Commence une guerre qui va durer dix ans. » La crise de l’antifascisme et l’institutionnalisation de l’extrême droite sont encore loin.
Dans un dialogue, publié en 1974, avec le journaliste à Libération Philippe Gavi et le dirigeant de la Gauche prolétarienne Pierre Victor (pseudonyme de Benny Lévy), Jean-Paul Sartre tire le bilan de cette période. Considérant l’évolution du contexte national et international, il estime que le passage de relais entre les générations militantes d’extrême gauche implique un changement de tactique.
« Nous, nous envisagions la prise du pouvoir comme une nécessité mais les moyens que nous envisagions étaient bien vagues, considère le philosophe. [...] On se battait de toutes ses forces et puis on finissait par se dégonfler. Ce n’est pas comme ça désormais que les choses se passeront. On se battra, mais pas à la manière militaire ; de quelle manière ? C’est ce qu’il faut préciser. » Cinquante ans plus tard, la question reste entière.



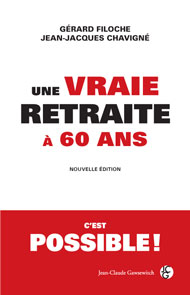






One Trackback
[...] http://www.gerard-filoche.fr/2023/05/05/avant-le-21-juin-1973-il-y-a-50-ans/ [...]