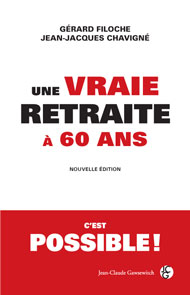Un million pour l’école publique contre Bayrou
Sur le terrain de l’école privée, Balladur et Bayrou connurent un grand malheur, pourtant prévisible. François Bayrou, alors ministre catholique de l’Éducation, crut pouvoir poursuivre, dans la lignée des lois Debré- Guermeur, les concessions accordées à l’école privée en 1984 en fonction des accords Lang-Cloupet. Il osa proposer d’abroger la loi Falloux, qui limitait les aides à l’école privée. Mal lui en prit : il se heurta à une résistance parlementaire, notamment conduite au Sénat par Jean-Luc Mélenchon, et à un appel intersyndical pour une montée nationale à Paris le 16 janvier 1994.
Même les dirigeants de la gauche ne le comprirent pas tout de suite. En appelant à cette montée sur Paris, ce dimanche 16 janvier, ils croyaient qu’il y aurait si peu de monde qu’ils choisirent la petite place de l’Opéra comme lieu de rassemblement et n’imaginèrent qu’un seul parcours. En fait, il y eut un million de manifestants, un des plus grands rassemblements nationaux de notre histoire. Paris fut paralysé de bout en bout, les Bretons à eux seuls mirent trois heures à défiler entre République et Nation, des centaines de milliers d’autres gens ne réussirent même pas à bouger en dix heures de manifestation. Le cortège s’étala du XVIIe arrondissement jusqu’à Nation en passant par Opéra et République. Le peuple laïque saisissait cette occasion pour réussir enfin cette grande manifestation nationale que le Cnal n’avait pas su organiser dix ans plus tôt. Elle fut plus grande que celle des Versaillais pour l’école libre en juin 1984. Stupeur à droite !
Entre-temps, Michel Rocard était devenu premier secrétaire du PS, succédant à Pierre Mauroy et à Laurent Fabius. Mais on vit tout de suite ses limites : il ne sut même pas exploiter cette exceptionnelle situation, il déclara que ce n’était pas une « manif de gauche » et n’exigea même pas le départ de François Bayrou !
La pétition de masse pour les 35 h sans perte de salaire
Les conflits sociaux remontaient : dans le commerce parisien avec le Sycopa (dirigé par Patrick Brody), à Chausson, à Sud Marine, à Chantelle (Nantes), aux télécoms, à Elf-Aquitaine, où l’usine de production de Lacq a fait grève pendant dix-sept jours, avec la CGT dirigée par Jean-Yves Lalanne, à Péchiney, à Tampax (Tours), à Saint-Yorre, à Steelcase-Strafor, à Canon France, à GEC-Alsthom (Le Havre), à Sopalin (Sotteville-lès- Rouen)…
Trois responsables syndicaux, Raymond Vacheron (CFDT Hacuitex Le Puy), Bruno Lemerle (CGT Peugeot-Sochaux) et Jean Louis Mourgue (FO PTT Île-de-France) lançaient un appel pour les « 35 heures sans perte de salaire » afin d’en finir avec le chômage de masse. Ils obtenaient dès le départ le soutien de 1 000 syndicalistes unitaires, 400 de la CGT, 320 de la CFDT, 130 de FO, 170 d’autres syndicats, dont les enseignants. L’appel, soutenu à fond par notre revue Démocratie et Révolution, recueillit des milliers d’autres signatures de responsables syndicalistes.
Pour nous, il fallait centrer sur une revendication unifiante et populaire capable de traduire les aspirations à la lutte contre le chômage et à la redistribution des richesses. Toutes les forces de notre modeste courant, en passe de se libérer de la tutelle de la LCR, s’investirent dans le mot d’ordre « 35 heures hebdomadaires sans perte de salaire ».
Le CIP de (Delors à) Balladur (avant Villepin et son CPE)
À peine un mois après la mobilisation contre la remise en cause de la loi Falloux, Édouard Balladur, s’inspirant du « livre blanc » de Jacques Delors paru quelque temps plus tôt, proposa un « smic-jeunes », le contrat d’insertion professionnelle ou CIP. Il est significatif de voir à quoi servent les sociaux-libéraux, néo-centristes : ils produisent des « livres blancs » qui servent d’alibi à la droite à mettre en route les pires projets. Il s’agissait de « lutter contre le chômage des jeunes en… les payant moins », c’est-à-dire 80 % du Smic.
Le CIP provoqua, à son tour, huit ans après Jacques Chirac, une vigoureuse mobilisation de la jeunesse. Elle se prépara en février et dura tout le mois de mars 1994. La montée en puissance des manifestations obligea Balladur à reculer inexorablement. Un processus bien connu depuis la loi Debré de 1973 se remit en place. Un rassemblement organisé grâce à l’Unef-ID, la FIDL et la CGT se tenait le jeudi 3 mars, puis il y avait un premier cortège de 15 000 étudiants et lycéens. Le 10 mars, 20 000 personnes manifestaient contre le CIP à Paris, et le mouvement s’étendait dans des dizaines de villes de province. Le 12 mars, la CGT mobilisait contre le chômage massivement à Paris, à Marseille, à Toulouse, à Metz. Les jeunes participèrent. Les 17, 25 et 31 mars, semaine après semaine, l’importance des manifestations allait croissant. Des coordinations s’installaient.
Le gouvernement tergiversait, consultait, laissait entendre qu’il allait revoir le projet de Smic-jeunes. Il y avait alors 23,8 % des jeunes au chômage ; 20 % du Smic en moins, cela faisait baisser le salaire de 5 886,27 francs à 4 700 francs brut. Les jeunes s’entêtaient, refusant tout compromis, ne laissant aucune issue au gouvernement.
Le 28 mars, Michel Field se souvint de sa jeunesse de 1973 : il anima une émission spéciale télévisée en direct avec 400 jeunes sur le plateau. De mémoire, ce fut une émission triomphale pour le mouvement en cours. Les jeunes crevaient l’écran, ils faisaient bloc, argumentaient, convainquaient. Ils refusaient de dénoncer les « casseurs de fin de manif » qu’on leur opposait encore : « Les casseurs sont nos copains », « Retrait du CIP ». L’émission, au lieu de désamorcer la crise, rendit son issue inévitable.
Édouard Balladur annonçait la « suspension » de son projet.
Il rencontrait les dirigeants jeunes. Sonia Samadi, présidente de la FIDL, a avec Léa Filoche, claquait la porte de Matignon, demandant le « retrait pur et simple ».
La grève continuait. L’Unef-ID et la FIDL ne lâchèrent pas prise. Le second Premier ministre de cohabitation dut, à son tour, comme Jacques Chirac et Philippe Devaquet, huit ans auparavant, prononcer le mot « retrait ».
C’était alors très significatif des rapports de force profonds dans le pays. En mars 1994, Mai 68 n’était toujours pas effacé des mémoires.
Mai 68, décembre 1986, mars 1994
Un débat s’ouvrit une fois de plus dans les médias : quelle comparaison entre Mai 68 et mars 94 ? Laurent Joffrin écrivit : « Mai 68 c’était la révolte de l’espoir. Mars 94 c’était la révolte du désespoir. En 68, on croyait à la politique, en 94, elle est objet de dérision. En 68, on croyait dans l’action collective, dans les programmes, dans les projets. En 94, on s’en défie comme de la peste. En 68, il y avait 300 000 chômeurs. En 94, il y en a dix fois plus. En 68, la drogue était une tentation pour ainsi dire poétique. En 94, elle est un fléau. En 68, selon le vocabulaire en vigueur, les jeunes avaient peur d’être intégrés par le système. En 94, ils ont peur parce qu’ils en sont exclus. » Pour la énième fois, la réécriture de Mai 68 battait son plein. Les idéologues s’efforçaient de gommer toute continuité. Pour eux, Mai 68 était unique, c’était un phénomène culturel, pas social. Il leur suffisait donc de montrer qu’en surface les mots d’ordre culturels avaient changé pour nier l’essentiel.
Le climat apparent n’était plus le même, mais, au fond, la lutte des classes, elle, reposait sur les mêmes ressorts. La grève générale massive des salariés de 68 visait à mieux répartir les fruits du travail. Les jeunes de 94 agissaient dans le même sens, contre un smic au rabais.
Le Mai 68 étudiant avait été une façon de dire : « Ne réprime pas mes camarades », et puis cela avait servi d’étincelle, de catalyseur pour les revendications de la classe salariale. Un lien profond avait été établi entre la jeunesse et le salariat. C’est à cause de ce lien si depuis les pouvoirs ont peur : Chirac en décembre 1986 et Balladur en mars 1994. Tout comme Chirac après la mort de Malik Oussekine, Balladur, en 1994, mourait de peur qu’il y ait des victimes au cours des défilés de jeunes.
En 1968, certes le gauchisme régnait, miroir opposé et reflet du stalinisme majoritaire à gauche. Mais était-ce moins bien, moins radical, moins efficace en 1994, quand la jeunesse conduisit son combat jusqu’à la victoire complète avec un grand sens de la solidarité collective ?
En mai 68 planait encore l’ombre de l’URSS sur tout mouvement social. En 1994, le capitalisme était seul face à lui-même. En 1968, on criait : « Élection-trahison ». En 1994, comme en 1986, on disait : « On s’en souviendra le jour des élections. »
En mai 68, ce fut l’explosion ; en mars 94, le refus du chantage à l’exclusion, ce qui peut provoquer une explosion plus forte.
En décembre 86, comme en mars 94, la jeunesse était pleine d’espoir, elle ne prenait pas la politique en dérision, mais au sérieux.
La façon dont la presse a valorisé Mai 68 par rapport aux mouvements ultérieurs est impudique. C’était comme un acharnement : les « vieux » soixante-huitards y contribuèrent, expliquant que, de « notre temps », on était plus révolutionnaire, plus audacieux, etc. Pour eux, 36 était-il mieux que 68 ? Non. Ils avaient leur univers borné, leur mémoire coincée sur les barricades du quartier Latin, sur les mondains de type Cohn-Bendit et Kouchner, sur les clichés abondamment cultivés par les médias…
Ils ne voyaient pas le fond, la continuité, la progression de la conscience d’une génération de jeunes à l’autre.
Vers novembre décembre 1995 :
Chaque grande crise révolutionnaire nourrit ainsi le conscient et l’inconscient des vivants qui font l’histoire. Chacune s’empile sur l’autre et, quelque part, tire profit de la précédente. Par mille liens invisibles qui sont différés, par le poids plus ou moins grand du chômage, du rapport des forces, de la peur de l’exclusion, de l’espoir du changement.
Tout comme il y a des cycles Kondratieff en économie, qui alternent récession et expansion, il y a des cycles du mouvement des masses, où s’épuisent et se succèdent des générations. Ces cycles sont mystérieux à définir et très rebelles à la théorie, parfois on ne les comprend qu’a posteriori. Mais ils n’en existent pas moins. On le verrait encore plus nettement, à peine un an plus tard, en novembre-décembre 1995, survenu en pleine période de chômage. Certains diront « mieux qu’en 68 » – pourtant inscrit dans les Trente Glorieuses.