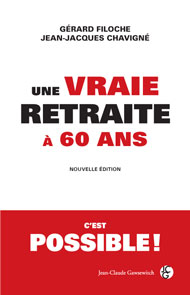La présidente du Medef, Laurence Parisot vient de se rappeler au bon souvenir de notre gouvernement, en déclarant, au cours de sa conférence de presse du 18 septembre qu’elle prévoyait « avec effroi » un « choc de non-compétitivité » pour les entreprises françaises, lors du vote du budget 2013.
Il faut dire que les gouvernements précédents celui du Jean-Marc Ayrault (sous Chirac et Sarkozy) avait beaucoup gâté le Medef. Ils avaient créé des « niches fiscales », ces dispositifs dérogatoires à l’Impôt sur les sociétés, représentant un total de 69 milliards d’euros annuel. Ce sont les chiffres du rapport du Conseil des prélèvements obligatoires d’octobre 2010 sur « Entreprises et « niches » fiscales et sociales. Des dispositifs dérogatoires nombreux »).
Il faut dire aussi, malheureusement, que notre ministre de l’Economie et des finances, Pierre Moscovici, avait imprudemment baissé la garde cet été, lors de l’Université du Medef, en déclarant : « Le mot compétitivité n’est pas un gros mot ».
Pour le Medef, le mot compétitivité est pourtant un gros mot car le Medef n’entend par « compétitivité » que le « coût du travail ».
Le Medef oublie, pour tous les échanges hors de la zone euro, le poids de l’euro cher qui entre 2002 et 2010 a augmenté de 40 % la valeur de l’euro par rapport au dollar et donc d’autant le prix des produits de la zone euro. Cet « euro cher », nous le devons aux traités européens qui n’ont confié qu’une seule mission à la Banque centrale européenne : la lutte contre l’inflation et pour un « euro fort » qui n’est en réalité qu’une « euro cher ». La mission de la Réserve fédérale des États-Unis est bien différent car elle est double : lutter contre l’inflation et le chômage et le dollar sous-évalué dope les exportations américaines.
Le Medef oublie aussi que la compétitivité-coût n’est pas la seule forme de compétitivité. Des servies publics efficaces (enseignement, transports…) entrent également en ligne de compte. Tout comme les investissements des entreprises en « recherche et développement » qui sont pour les entreprises françaises deux fois moins élevés (en 2011) que pour les entreprises allemandes.
Le Medef oublie, enfin, que dans la compétivité-coût il n’y a pas seulement le coût du travail mais aussi le coût du capital. On comprend cet oubli car c’est un endroit où le bât blesse cruellement le Medef. Les dividendes versés aux actionnaires par les grands groupes français représentaient 3,2 % du PIB en 1980, ils représentent aujourd’hui 9,3 % du PIB. Plus de 180 milliards d’euros par an ! Six fois le plan de rigueur de Jean-Marc Ayrault pour le budget de 2013 !
Avec la crise de 2008-2009, selon les comptes de l’INSEE, les dividendes ont commencé par reculer. Ils ont dans un deuxième temps fait plus que récupérer les pertes subies. Au total, entre le 1er trimestre de 2007 et le 1er trimestre de 2012, les dividendes nets versés ont progressé de 27,4 % alors que la masse salariale ne progressait que de 12,5 %. Mais selon le Medef, c’est le coût du travail qui nuit à la « compétitivité ».
Ces derniers chiffres permettent de tirer deux conclusions :
La 1ère, c’est que le Medef n’a que faire du soi-disant « choc de non-compétitivité ». S’il voulait éviter ce « choc », il n’aurait qu’à diminuer le montant des dividendes qui entrent lourdement en ligne de compte dans le coût d’un produit. L’appétit du MEDEF pour la « compétitivité » dissimule son véritable appétit pour tout autre chose, la « rentabilité » des grands groupes qui permet de continuer à verser des dividendes quand tout le monde, en dehors des actionnaires, devrait se serrer la ceinture.
La 2ème c’est que l’augmentation des profits des entreprises (10 points de la richesse annuelle créée par les entreprises depuis 1989) n’a que peu servi à l’investissement productif car le taux de marge disponible (après le versement des dividendes) a régulièrement baissé. Ce sont les dividendes des actionnaires qui ont surtout profité de la baisse de la part des salaires dans la répartition des richesses de notre pays.
Le groupe PSA, par exemple, a versé 6 milliards d’euros à ses actionnaires, sous forme de dividendes directs ou de rachat d’action, au cours des dernières années. Il n’a donc pas suffisamment investi et, maintenant le Conseil d’administration, représentant des actionnaires, décide de licencier 8 000 salariés et de mettre plus de 20 000 autres employés dans la sous-traitance au chômage. C’est comme ça que PSA compte assurer sa compétitivité.