I. Sur la non-conformité à l’alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et à l’article 34 de la Constitution de l’article L. 3121-44 issu de la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
Selon l’article L. 3121-44 issu de la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels :
« En application de l’article L. 3121-41, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :
1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l’autorise, trois ans ;
2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail ;
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence ».
« Lorsque l’accord s’applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
« L’accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.
« Si la période de référence est supérieure à un an, l’accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d’une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l’accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l’application du présent alinéa n’entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l’issue de la période de référence mentionnée au 1°.
« L’accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l’avant-dernier alinéa.
1. Tout d’abord, si le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dispose en son 8ème alinéa que : « tout travailleur participe par l’intermédiaire de ses délégués à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises », l’article 34 de la Constitution range dans le domaine de la loi la détermination des principes fondamentaux du droit du travail. Il revient donc au législateur le soin de déterminer, dans le respect du principe qui est énoncé au huitième alinéa du Préambule, les conditions et garanties de sa mise en œuvre.
Selon le Conseil, « sur le fondement de ces dispositions, il est loisible au législateur, après avoir défini les droits et obligations touchant aux conditions et aux relations de travail, de laisser aux employeurs et aux salariés, ou à leurs organisations représentatives, le soin de préciser, notamment par la voie de la négociation collective, les modalités concrètes d’application des normes qu’il édicte ; que le législateur peut en particulier laisser les partenaires sociaux déterminer, dans le cadre qu’il a défini, l’articulation entre les différentes conventions ou accords collectifs qu’ils concluent au niveau interprofessionnel, des branches professionnelles et des entreprises ; que, toutefois, lorsque le législateur autorise un accord collectif à déroger à une règle qu’il a lui-même édictée et à laquelle il a entendu conférer un caractère d’ordre public, il doit définir de façon précise l’objet et les conditions de cette dérogation » (déc. no 2004-494 DC du 29 avril 2004, point 8). Autrement dit, le Conseil vérifie que « le législateur a suffisamment encadré le contenu de l’habilitation donnée aux partenaires sociaux » (déc. n° 2007-556 DC du 16 août 2007, Loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs).
Or, l’article L. 3121-44 ne fixe pas précisément les conditions de la dérogation. En effet, ce texte ne prévoit aucune norme substantielle permettant au législateur de préciser suffisamment l’habilitation qu’il donne aux partenaires sociaux. Le législateur s’est contenté de préciser, à l’article L. 3121-44 du Code du travail, les thèmes devant être présents dans l’accord collectif sans préciser les conditions de la dérogation. L’accord doit seulement préciser la période de référence, les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail, et les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence. Ces dispositions ne prévoient donc pas les conditions de la dérogation, mais seulement leur objet. Un accord collectif peut donc librement peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine pouvant aller jusqu’à trois années.
2. Ensuite, il a été jugé de manière constante par le Conseil Constitutionnel que le principe dit de faveur, selon lequel la loi ne peut permettre aux accords collectifs de travail de déroger aux lois et règlements ou aux conventions de portée plus large que dans un sens plus favorable aux salariés, constitue un principe fondamental du droit du travail au sens de l’article 34 de la Constitution (n° 67-46 L du 12 juillet 1977, cons. 6, Rec. p. 31 ; n° 89-257 DC du 25 juillet 1989, cons. 11, Rec. p. 59). Les articles L. 2251-1, L. 2252-1, L. 2253-1 et L. 2254-1 du Code du travail demeurent à ce jour inchangés donc le principe de faveur est maintenu par la loi.
Dans la mesure où il s’agit d’un principe législatif et non constitutionnel, le législateur est seul compétent pour en déterminer le contenu et la portée.
Il en résulte pour le Conseil Constitutionnel dans la décision du 29 avril 2004 (Décision n° 2004-494 DC du 29 avril 2004, Loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social) que si le législateur peut, sans porter atteinte à l’article 34 de la Constitution et aux exigences d’intelligibilité et de clarté de la loi, laisser aux partenaires sociaux le soin de déterminer eux-mêmes l’articulation entre les différents conventions ou accords collectifs qu’ils concluent au niveau interprofessionnel, des branches professionnelles et des entreprises, c’est parce que la loi déférée comportait des garanties à savoir :
- les accords dérogeant aux accords de niveau supérieur doivent être des accords majoritaires, c’est-à-dire qu’ils ne devront pas avoir fait l’objet d’une opposition d’une majorité de syndicats, en ce qui concerne les accords de branche, ou de syndicats majoritaires dans l’entreprise, en ce qui concerne les accords d’entreprise ou qu’ils devront avoir été signés par des syndicats ayant recueilli la majorité des suffrages aux dernières élections professionnelles dans l’entreprise.
- l’accord de niveau supérieur doit toujours pouvoir interdire aux accords de niveau inférieur de déroger à ses stipulations,
- les accords d’entreprise ne doivent jamais déroger aux accords de branche dans certains domaines (salaire minimum ; classifications ; garanties collectives touchant à la protection sociale complémentaire et à la mutualisation des fonds de la formation professionnelle)
Force est de constater que l’article L. 3121-44 du Code du travail ne fixe aucune de ces garanties légales. En effet, ce texte autorise les accords d’entreprise à prévoir des dispositions moins favorables aux salariés que l’accord de branche ou la convention supérieure sans que les organisations syndicales majoritaires puissent s’y opposer. De plus, l’article L. 3121-44du Code du travail ne prévoit pas non plus la possibilité pour les accords de niveau supérieur d’interdire aux conventions de niveau inférieur de déroger à leurs normes. En effet, ce n’est qu’« à défaut » d’accord d’entreprise que l’accord de branche s’applique.
II. Sur la non-conformité à l’alinéa 11 du Préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et à l’article 34 de la Constitution de l’article L. 3121-63 du Code du travail issu de la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
Selon l’article L. 3121-63 du Code du travail issu de la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels :
« Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l’année sont mis en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Selon l’article L. 3121-64 du Code du travail issu de la même loi :
« I.- L’accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l’année détermine :
« 1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 ;
« 2° La période de référence du forfait, qui peut être l’année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ;
« 3° Le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s’agissant du forfait en jours ;
« 4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
« 5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait.
« II.- L’accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine :
« 1° Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
« 2° Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;
« 3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l’article L. 2242-8.
« L’accord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l’année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l’article L. 3121-59. Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III du présent livre relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l’entreprise et avec celles du titre IV relatives aux congés payés. »
1. Aux termes du 11ème alinéa du Préambule de 1946, la Nation « garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ».
Selon le Conseil constitutionnel, « Considérant qu’aux termes du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation » garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs… » ; qu’il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine qui lui est réservé par l’article 34 de la Constitution, d’adopter, pour la réalisation ou la conciliation d’objectifs de nature constitutionnelle, des modalités nouvelles dont il lui appartient d’apprécier l’opportunité ; que, cependant, l’exercice de ce pouvoir ne saurait aboutir à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel » (décision n° 2004-494 DC du 29 avril 2004, Loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, point 16).
De plus, le Conseil a déjà affirmé, que le législateur doit poser un ensemble de garanties légales afin de veiller au respect des exigences constitutionnelles résultant du onzième alinéa du Préambule de 1946 :
« Considérant que des conventions de forfait en jours ne pourront être conclues avec des salariés non-cadres que s’ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail et si la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée ; que la conclusion de ces conventions de forfait doit être prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou par un accord d’entreprise, qui détermine notamment les catégories de salariés concernés ; que les intéressés doivent donner individuellement leur accord par écrit ; qu’ils bénéficient du repos quotidien de onze heures prévu par l’article L. 220-1 du code du travail et du repos hebdomadaire de trente-cinq heures prévu par l’article L. 221-4 du même code ; que le nombre de jours travaillés ne peut dépasser le plafond de deux cent dix-huit jours par an ; qu’en posant l’ensemble de ces conditions, le législateur n’a pas privé de garanties légales les exigences constitutionnelles résultant du onzième alinéa du Préambule de 1946 » (déc. n° 2005-523 DC du 29 juillet 2005, Loi en faveur des petites et moyennes entreprises, point 7).
Or, l’article L. 3121-64 du Code du travail ne comporte aucune garantie légale de nature à respecter les exigences constitutionnelles résultant du onzième alinéa du Préambule de 1946. En effet, le législateur se contente de préciser les thèmes devant figurer dans l’accord collectif.
Par exemple, l’accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l’année doit déterminer « « 5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait ». Cette mention, qui ne répond pas à l’exigence de clarté de la loi, ne permet pas de mettre en œuvre l’exigence constitutionnelle posée par le 11ème alinéa du Préambule de 1946.
De plus, s’agissant du forfait en heures, ni les dispositions d’ordre public des articles L. 3121-56 et L. 3121-57 du Code du travail, issu de la loi du 8 août 2016, ni l’art. L. 3121-64, et en particulier l’article « Art. L. 3121-64.-I.3°, ne fixe de limite au forfait en heures. L’article L. 3121-64 est donc contraire au 11ème alinéa du Préambule de 1946.
2. Si le législateur peut, sans porter atteinte à l’article 34 de la Constitution et aux exigences d’intelligibilité et de clarté de la loi, laisser aux partenaires sociaux le soin de déterminer eux- mêmes l’articulation entre les différents conventions ou accords collectifs qu’ils concluent au niveau interprofessionnel, des branches professionnelles et des entreprises, c’est à la condition que la loi déférée comporte des garanties (Décision n° 2004-494 DC du 29 avril 2004, précité). Or, en précisant que les forfaits annuels en heures ou en jours sur l’année sont mis en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement « ou, à défaut, » par une convention ou un accord de branche, la loi déférée ne comporte aucune garantie relative à cette articulation.
III. Sur la non-conformité à l’article 34 de la Constitution, et aux articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et à l’alinéa 5 du Préambule de la constitution du 27 octobre 1946 des articles L. 2254-2 et suivants du Code du travail issus de la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
Selon l’article L. 2254-2 du Code du travail issu de la loi du 8 la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels,
« Lorsqu’un accord d’entreprise est conclu en vue de la préservation ou du développement de l’emploi, ses stipulations se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération et de durée du travail.
« Lorsque l’employeur envisage d’engager des négociations relatives à la conclusion d’un accord mentionné au premier alinéa du présent I, il transmet aux organisations syndicales de salariés toutes les informations nécessaires à l’établissement d’un diagnostic partagé entre l’employeur et les organisations syndicales de salariés.
« L’accord mentionné au même premier alinéa comporte un préambule indiquant notamment les objectifs de l’accord en matière de préservation ou de développement de l’emploi. Par dérogation au second alinéa de l’article L. 2222-3-3, l’absence de préambule entraîne la nullité de l’accord.
« L’accord mentionné au premier alinéa du présent I ne peut avoir pour effet de diminuer la rémunération mensuelle du salarié.
« Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, cet accord peut être négocié et conclu par des représentants élus mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-21-1 ou, à défaut, par un ou plusieurs salariés mandatés mentionnés à l’article L. 2232-24.
« II.-Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de l’application de l’accord mentionné au premier alinéa du I du présent article. Ce refus doit être écrit.
« Si l’employeur engage une procédure de licenciement à l’encontre du salarié ayant refusé l’application de l’accord mentionné au même premier alinéa, ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse et est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1233-11 à L. 1233-15 applicables au licenciement individuel pour motif économique ainsi qu’aux articles L. 1234-1 à L. 1234-20. La lettre de licenciement comporte l’énoncé du motif spécifique sur lequel repose le licenciement.
« L’employeur est tenu de proposer, lors de l’entretien préalable, le bénéfice du dispositif d’accompagnement mentionné à l’article L. 2254-3 à chaque salarié dont il envisage le licenciement. Lors de cet entretien, l’employeur informe le salarié par écrit du motif spécifique mentionné au deuxième alinéa du présent II et sur lequel repose la rupture en cas d’acceptation par celui-ci du dispositif d’accompagnement.
« L’adhésion du salarié au parcours d’accompagnement personnalisé mentionné à l’article L. 2254-3 emporte rupture du contrat de travail.
« Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis, ouvre droit à l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement au terme du préavis ainsi que, le cas échéant au solde de ce qu’aurait été l’indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l’employeur mentionné à l’article L. 2254-6.
« Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis.
« Un décret définit les délais de réponse du salarié à la proposition de l’employeur mentionnée au troisième alinéa du présent II ainsi que les conditions dans lesquelles le salarié adhère au parcours d’accompagnement personnalisé.
« III.-L’accord mentionné au premier alinéa du I du présent article précise :
« 1° Les modalités selon lesquelles est prise en compte la situation des salariés invoquant une atteinte disproportionnée à leur vie personnelle ou familiale ;
« 2° Les modalités d’information des salariés sur son application et son suivi pendant toute sa durée.
« L’accord peut prévoir les conditions dans lesquelles fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux autres salariés :
« -les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord ;
« -les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d’administration et de surveillance.
« L’accord peut prévoir les conditions dans lesquelles les salariés bénéficient d’une amélioration de la situation économique de l’entreprise à l’issue de l’accord.
« Afin d’assister dans la négociation les délégués syndicaux ou, à défaut, les élus ou les salariés mandatés mentionnés au dernier alinéa du I, un expert-comptable peut être mandaté :
« a) Par le comité d’entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 2325-35 ;
« b) Dans les entreprises ne disposant pas d’un comité d’entreprise :
« -par les délégués syndicaux ;
« -à défaut, par les représentants élus mandatés ;
« -à défaut, par les salariés mandatés.
« Le coût de l’expertise est pris en charge par l’employeur.
« Un décret définit la rémunération mensuelle mentionnée à l’avant-dernier alinéa du I du présent article et les modalités selon lesquelles les salariés sont informés et font connaître, le cas échéant, leur refus de voir appliquer l’accord à leur contrat de travail.
« IV.-Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2222-4, l’accord est conclu pour une durée déterminée. À défaut de stipulation de l’accord sur sa durée, celle-ci est fixée à cinq ans.
« V.-Un bilan de l’application de l’accord est effectué chaque année par les signataires de l’accord.
1. Tout d’abord, selon le Conseil constitutionnel, « il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle qui découlent de l’article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi ; que, d’autre part, le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789 (Déc. n° 2013-672 DC du 13 juin 2013, Loi relative à la sécurisation de l’emploi).
La liberté contractuelle est protégée par le Conseil comme principe à valeur constitutionnel de manière constante. Le Conseil protège le déroulement du contrat c’est-à-dire son exécution selon les termes fixés par les parties. La « pérennité contractuelle » doit se lire comme un prolongement indispensable de la liberté de création des conventions. Mais il convient d’observer que le juge constitutionnel préfère dans ces cas évoquer la protection de « l’économie » des contrats, ou tout simplement la caractère non conforme à la Constitution d’une atteinte « aux contrats en cours ».
Or, le prima de l’accord collectif in pejus sur la volonté contractuelle de l’employeur et du salarié est une atteinte à la liberté contractuelle.
En effet, l’article L. 2254-2 du Code du travail dispose que :
« Lorsqu’un accord d’entreprise est conclu en vue de la préservation ou du développement de l’emploi, ses stipulations se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération et de durée du travail ».
La généralité de cette autorisation à défaire en défaveur du salarié et par voie d’accord collectif une partie du contrat de travail est une violation incontestable de l’article 34 de la Constitution.
Par ailleurs le II du même article de la loi déférée prévoie que le salarié qui refuse cette atteinte à son contrat de travail par accord collectif peut être licencié pour cause réelle et sérieuse :
« Si l’employeur engage une procédure de licenciement à l’encontre du salarié ayant refusé l’application de l’accord mentionné au même premier alinéa, ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse »
Or, en prévoyant que le refus exprimé par un salarié à la modification de son contrat de travail constitue un motif de licenciement, le législateur porte une atteinte à la liberté contractuelle. En effet, la force obligatoire du contrat est anéantie lorsque le refus d’une partie à la modification du contrat constitue un motif de résiliation unilatérale du contrat par l’autre partie.
De plus, cette atteinte à la liberté contractuelle n’est pas justifiée par un motif d’intérêt général. En effet, le législateur n’a pas prévu de garanties spécifiques concernant le contenu de l’accord collectif visé à l’article L. 2254-2. Cette disposition se contente de définir l’accord collectif au regard de sa finalité : il doit être conclu « en vue de la préservation ou du développement de l’emploi » sans déterminer le contenu de l’accord collectif.
Le Conseil ne pourra donc pas manquer de relever que les dispositions de l’article L. 2254-2 portent à la liberté contractuelle, une atteinte excessive et non justifiée par un motif d’intérêt général.
En effet, en principe, lorsqu’un salarié refuse une modification de son contrat de travail pour un motif économique, l’employeur doit engager une procédure de licenciement pour motif économique. La mise à l’écart des garanties du droit du licenciement, et notamment de la procédure de licenciement pour motif économique qui permet la préservation de l’emploi et de l’exigence d’un motif économique de licenciement, ne saurait être justifiée ni par la liberté d’entreprendre de l’employeur ni par la protection du droit à l’emploi, alors qu’une telle disposition écarte les garanties minimales du salarié licencié.
La mise à l’écart de ces garanties légales minimales ne poursuit aucun motif d’intérêt général.
2. Ensuite, cette justification systématique de la rupture du contrat de travail par l’employeur sur la seule base du refus du salarié d’une modification défavorable de son contrat de travail autorisée par les signataires de l’accord collectif est une atteinte caractérisée et disproportionnée au droit à l’emploi. Une atteinte disproportionnée que la liberté d’entreprendre ne saurait justifier.
Le Conseil constitutionnel veille à ce que les atteintes portées aux autres principes de valeur constitutionnelle ne soient pas manifestement disproportionnées au regard de cet objectif (Décision n° 98-401 DC du 10 juin 1998, Loi d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail ; Décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002, Loi de modernisation sociale). Le « législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 » (Décision n° 2008-568 DC du 7 août 2008, Loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail). Ainsi, l’objectif poursuivi par le législateur ne saurait porter une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle (Décision n° 2012-242 QPC du 14 mai 2012).
Or, la mise à l’écart des garanties du droit du licenciement, et notamment de la procédure de licenciement pour motif économique qui permet la préservation de l’emploi et de l’exigence d’un motif économique de licenciement, ne saurait être justifiée ni par la liberté d’entreprendre de l’employeur ni par la protection du droit à l’emploi, alors qu’une telle disposition écarte les garanties minimales du salarié licencié.
Ces garanties légales minimales constituent la mise en œuvre législative de l’exigence constitutionnelle du droit à l’emploi. La mise à l’écart de ces garanties légales minimales est disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.
3. Enfin, en l’absence de toute disposition législative précise relative au contenu de l’accord collectif et aux garanties qu’il doit contenir pour sauvegarder les exigences constitutionnelles, le législateur méconnaît également à ses compétences, telles qu’elles découlent de l’article 34 de la Constitution.
Selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, l’accord dérogatoire, c’est-à-dire dans lequel la loi autorise un accord collectif à déroger dans un sens défavorable aux salariés, ne peut être autorisé par la loi que si cette dernière définit de façon précise l’objet et les conditions, de fond comme de forme, de ces dérogations (déc. no 2004-494 DC du 29 avril 2004, préc.). Le fondement constitutionnel de cette exigence demeure l’article 34 de la Constitution qui interdit au législateur, lorsque celui-ci arrête des règles impératives d’ordre public applicables en principe à toutes les entreprises et à tous les salariés, de permettre en même temps aux partenaires sociaux d’y déroger à leur guise par accord collectif. En retenant une matière dans l’ordre public social, tout en la déléguant aux partenaires sociaux, le législateur tomberait dans la contradiction et, par défaut de clarté et de cohérence, resterait en deçà de sa compétence.
Ces conditions constitutionnelles gouvernent a fortiori les normes législatives qui prévoient que les stipulations moins favorables d’une convention collective se substituent à celles du contrat de travail du salarié auquel elle s’applique.
IV. Sur la non-conformité à la Constitution et au principe d’égalité de la caractérisation des motifs économiques de licenciement de l’article L. 1233-3 du Code du travail tel que modifié par la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
La loi du 8 août 2016 modifie l’article L. 1233-3 du Code du travail de la manière suivante :
« 1° Après le mot : « consécutives », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « notamment : » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés onze alinéas ainsi rédigés :
« 1° À des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; « 2° À des mutations technologiques ;
3° À une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° À la cessation d’activité de l’entreprise ;
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise ».
Le Conseil constatera que ces nouvelles caractérisations des causes économiques réelles et sérieuses de licenciement, différentes selon la taille de l’entreprise, ne sont pas conformes à plusieurs principes de valeur constitutionnelle.
Le nouvel article L. 1233-3 du Code du travail prévoit que des difficultés économiques peuvent être caractérisées par une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires dont l’ampleur minimale varie en fonction du nombre de salariés de l’entreprise employeur :
• Un trimestre de baisse pour une entreprise de moins de onze salariés ;
• Deux trimestres de baisse consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
• Trois trimestres consécutifs de diminution pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
• Quatre trimestres consécutifs d’affaissement pour une entreprise de trois cents salariés et plus
Ce faisant, le législateur a institué une différence de traitement, selon l’effectif de l’entreprise.
En effet, la définition de la cause économique réelle et sérieuse du licenciement n’est désormais plus la même pour tous les salariés. Elle diffère au regard du nombre de personnels habituellement employés dans l’entreprise.
Or, si le législateur peut introduire une différence de traitement, c’est à la condition que le principe d’égalité devant la loi ne soit pas méconnu.
Le principe d’égalité résulte de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui prévoit que : « [La loi] doit la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ».
Le Conseil constitutionnel précise par ailleurs que « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu, que dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit » (Décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010 ; Décision n°2012-242 QPC du 14 mai 2012 ; Décision n°2013-299 QPC du 28 mars 2013).
Le Conseil constitutionnel a rappelé ce principe il y a peu concernant l’absence de versement d’une indemnité compensatrice de congés en cas de licenciement pour faute lourde (Décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016).
Or, le Conseil constitutionnel est très récemment venu préciser, à l’occasion de l’examen de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, que la différence de traitement, quant au montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, résultant de l’effectif de l’entreprise, n’était pas en rapport direct avec l’objet de la loi.
En effet, le Conseil a jugé que :
1. « Considérant qu’en prévoyant que les montants minimal et maximal de l’indemnité accordée par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse sont fonction croissante des effectifs de l’entreprise, le législateur a entendu, en aménageant les conditions dans lesquelles la responsabilité de l’employeur peut être engagée, assurer une plus grande sécurité juridique et favoriser l’emploi en levant les freins à l’embauche ; qu’il a ainsi poursuivi des buts d’intérêt général ;
2. Considérant toutefois que, si le législateur pouvait, à ces fins, plafonner l’indemnité due au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, il devait retenir des critères présentant un lien avec le préjudice subi par le salarié ; que, si le critère de l’ancienneté dans l’entreprise est ainsi en adéquation avec l’objet de la loi, tel n’est pas le cas du critère des effectifs de l’entreprise ; que, par suite, la différence de traitement instituée par les dispositions contestées méconnaît le principe d’égalité devant la loi ;
Considérant que l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction résultant du 1° du paragraphe I de l’article 266, est contraire à la Constitution ; […] » (Décision n°2015-715 DC du 5 août 2015, points 151 à 153).
En conséquence, le fait de prévoir une définition de la cause économique réelle et sérieuse qui varie notamment en fonction des effectifs de l’entreprise institue une différence de traitement qui méconnaît le principe d’égalité devant la loi.
Ainsi, s’il est possible de régler différemment des situations différentes ou de déroger au principe d’égalité devant la loi pour des raisons d’intérêt général, c’est en tout état de cause à la condition que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
Or, si le critère de la baisse du chiffre d’affaires ou de la baisse des commandes est en adéquation avec l’objet de la loi définissant le motif économique de licenciement, tel n’est pas le cas du critère des effectifs de l’entreprise ; que, par suite, la différence de traitement instituée par les dispositions contestées méconnaît le principe d’égalité devant la loi.
Le Conseil relèvera que la référence aux effectifs de l’entreprise permet une différenciation, notamment selon la capacité de l’employeur à contribuer au paiement des indemnités de licenciement, mais elle ne prend aucunement en compte la dégradation de la situation économique de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise. Ce sont pourtant les hypothèses dans lesquelles le licenciement économique trouve une cause valable dans les difficultés de l’entreprise ou du groupe qui forment l’objet de la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Il s’agit pour le législateur de déterminer objectivement les éléments de difficultés économiques qui justifient que, pour redresser l’entreprise et maintenir les emplois qui n’auront pas été supprimés, l’employeur puisse priver une ou plusieurs personnes de travail. Le nombre de salariés n’est pas en adéquation avec ces éléments.
merci encore a richard abauzit



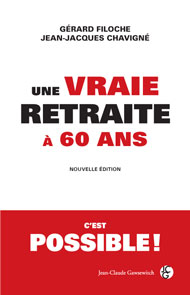






5 Commentaires
Eh oui, quand on perd dans la rue, quand les confédérations syndicales baissent (rapidement) les bras, il ne reste que la bataille juridique.
et ca retombe encore sur nous, car toutes les batailles on les initie, on les mène, on les porte jusqu’au bout
demande a ton ami mélenchon combien d’actions il a fait depuis le début contre la loi el khomri, s’il en a fait
Arrête tes calomnies. Mélenchon n’est pas mon ami. Et ne fais pas semblant de ne pas comprendre, je n’ai pas dit qu’il ne fallait pas mener des actions juridiques, je dis que lorsqu’on en arrive à se reposer sur elles, comme le fait le leader de FO, qui se répand dans tous les médias sur le sujet, c’est que la mobilisation a échoué. Je ne dis rien d’autre.
Bonjour Gilbert Duroux (post n° 1),
Dans le cas présent, ce ne sont pas les syndicats qui baissent les bras face au Gouvernement, mais les travailleurs eux-mêmes…
Solidairement.
mais moi, je dis que j’ai mené avec mes amis de D&S, la crème de la crème, toutes les actions
et aussi celle là… depuis le début
en alimentant tout le monde,
en quadrillant la france, 130 meetings, 70 départements,
avec articles, livres, médias,
et on arrive a faire plus bataille que ceux, prétentieux, qui nous donnent de leçons d’impuissance