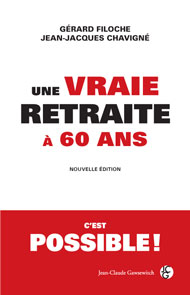George Orwell écrit « le quai de Wigan » en 1934, publie à Londres en 1937. Les éditions Ivréa l’ont republié en 1995 en français (Champ livre, 260 p. 18 euros). Je dois de l’avoir retrouvé à un militant de la vallée de la Fensch.
L’auteur y raconte le pays minier du nord de l’Angleterre. Il vit dans les logements insalubres et descend dans la mine : « La plupart des traits qu’on associe d’ordinaire au royaume de Satan sont présents au rendez vous : la chaleur, le bruit, le tohu bohu, l’atmosphère fétide, l’air vicié et surtout, l’espace compté à un point insupportable » « Il faut être au fond et voir les mineurs à moitié nus pour se rendre compte des splendides types d’humanité qu’ils représentent ».
Ils y descendent serrés dans une cage projetée à 100 km heure jusqu’à 400 m sous terre. Ils rampent dans des boyaux souterrains dangereux sur des longueurs de un à cinq kilomètres. Leur temps de travail n’est décompté qu’à pied d’oeuvre. Ils taillent la houille dans des positions torturantes de travail, un vacarme assourdissant, une poussière irrespirable : sur le front de taille, pendant 7 à 9 heures, à quatre pattes, dans un espace de 4 à 5 m, entre les bois de soutènement, les étançons, ils creusent avec des haveuses, des perceuses, des pelleteuses, des marteaux-piqueurs, des explosifs, des chargeurs qui concassent, trient, lavent et envoient le charbon abattu sur des convoyeurs avec des berlines.
« Au fond, là où on extrait le charbon, c’est une sorte de monde à part qu’on peut aisément ignorer sa vie durant. Il est probable que la plupart des gens préféreraient ne jamais en entendre parler. Pourtant, c’est la contrepartie obligée de notre monde d’en haut ».
Orwell réfléchit ensuite sur la situation politique et sociale de son époque et s’interroge sur les raisons qui expliqueraient pourquoi le socialisme ne gagne pas davantage l’adhésion du peuple. Il a la lucidité, lui, journaliste, à la fois de ne pas flagorner les mineurs et de ne pas se distinguer d’eux : il recherche le point commun entre tous ceux qui ont une activité de production et vendent leur force de travail.
On est tous salariés, tous victimes du capitalisme : « Ce que je dis par là, c’est que des classes distinctes peuvent et doivent faire front commun sans que les individus qui les composent soient sommés d’abandonner du même coup ce qui fait leur originalité. Le chat ne peut faire cause avec la souris, Le capitaliste ne peut faire œuvre commune avec le prolétaire. Mais il est toujours possible de s’associer sur la base d’un intérêt commun. Ceux qui doivent unir leurs forces ce sont tous ceux qui courbent l’échine devant un patron ou frissonnent à l’idée du prochain loyer à payer ».
Parmi vos livres d’été, choisissez aussi « Les luttes et les rêves : une histoire populaire de la France de 1685 à nos jours » de Michelle Zancarini-Fournel Ed. Zones 1000 p. 28 euros.
Gérard Filoche
Au boulot n° 353 chronique de l’humanité dimanche a lire chaque semaine