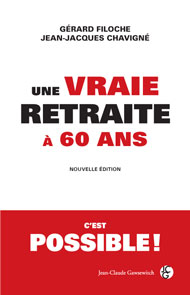ITV pour « le vent se lève » date début 2015 :
COMMENT RÉSISTER À LA DÉMOLITION DU CODE DU TRAVAIL
LE PARCOURS MILITANT DE GÉRARD FILOCHE
Pouvez-vous nous parler de votre enfance ? Vous êtes né juste à la fin de la guerre…
Oui, je suis né à Rouen le 22 décembre 1945, quelques mois après le retour de mon père, René, rentré en France en mars 1945 après cinq ans de capti- vité en Allemagne. Antoinette m’a donné naissance dans ce contexte de la fin de la guerre et du retour, parfois difficile, des prisonniers. Mes parents n’ont pas eu d’autre enfant.
Quel était le métier de votre père ?
Il était cheminot menuisier-chaudronnier.
Il y avait donc des menuisiers à la SNCF ?
Oui bien sûr, c’était du temps où on n’avait pas encore externalisé les services maintenance ! Il y avait les cheminots qui travaillaient dans les trains et les cheminots sédentaires, comme on disait. Mon père savait compter, toujours avec un crayon à bois sur l’oreille, pour prendre les mesures des meubles qu’il fabriquait. Mais il savait à peine écrire et il ne pouvait lire que les gros titres du journal.
Et votre mère ?
Elle était aide-soignante dans une clinique privée de Rouen ; elle, elle savait lire et écrire, c’était elle qui gérait la maison.
Vos études ont-elles été décisives dans votre parcours de militant ?
Ah, tiens oui, j’ai été marqué par le fait que l’on m’a viré du lycée Fontenelle de Rouen, à six mois du bac ! En fait, avec des copains, en première on avait créé un club Paul Déroulède… et c’est ça qui m’a valu d’être renvoyé pour mauvais esprit.
Paul Déroulède, le porte-flambeau de la droite la plus nationaliste à la fin du XIXe ?
Oui, c’est lui, ce réactionnaire, anti-communard en 1871, catholique inté- griste, papiste, ascète hystérique, sexiste, raciste, xénophobe, qui tenta en 1889 un coup d’État avec le général Roger, militariste, revanchard anti- boche pour « l’Alsace-Lorraine » !
Vous n’allez pas me dire que c’était votre héros ?
Non, bien sûr, tout le contraire ! Avec mes camarades, on l’avait pris comme symbole de tout ce que nous rejetions au lycée : on dessinait des Déroulède sur les tableaux noirs, et on se moquait comme ça de tout ce qui nous sem- blait réactionnaire dans les cours !
Déroulède vous servait d’exutoire !
On l’avait bien choisi, Déroulède ! Il est l’auteur des Chants du soldat et des Nouveaux Chants du soldat ou de Du Guesclin ! Un vrai poète de garnison ! Et les paroles de La Tour, prends garde, valent leur pesant d’or : « Tant pis pour celui qui tombe, vive la tombe, vive la tombe si le pays en sort vivant ! » Elles sont gravées dans le marbre, sur le socle de sa statue, à côté de la gare Saint-Lazare. Donc, à cause de Déroulède, et sans doute de mes turbulences, je suis passé en conseil de discipline et j’ai été viré pour « mauvais esprit ». C’était au mois de janvier, alors que je devais passer la première partie du bac en juin ! Pas sympathique, ce genre d’exclusion contre un fils d’ouvrier à six mois de l’examen. J’ai demandé six mois à ma mère, j’ai bossé seul, à la maison, et j’ai passé le bac en candidat libre, j’ai été reçu.
Donc vous avez pu réintégrer votre lycée pour la terminale ?
Eh non, ils n’ont pas voulu me reprendre ! Alors j’ai fait ma terminale dans un lycée de filles, le lycée des Bruyères à Sotteville-lès-Rouen. C’était la dernière année de la non-mixité. J’étais le seul garçon au milieu de 500 filles, elles portaient une semaine des blouses roses et la suivante des blouses bises… Et moi, j’étais le seul dispensé de blouse ! Le lycée est devenu mixte l’année suivante, mais je garde de très bons souvenirs de cette année-là.
Avez-vous été un bon élève ?
En philo, on peut dire oui ; pour ma première copie, j’ai eu 18, alors que la note suivante des filles de ma classe était à 12 ! Et j’ai eu le bac philo, grâce aux encouragements de ma prof, Jeannine Laéri ; pour moi, ça a été comme une revanche, parce qu’ils m’avaient viré pour mon « mauvais esprit »… J’avais aussi la satisfaction d’être invité aux réunions du club de philo que les profs de Rouen avaient créé : c’était un tout autre monde que le mien. J’étais ébloui, naïvement. On y parlait à la fois de philo et de politique, une première initia- tion intellectuelle. Après mon bac, alors que j’étais en première année de fac, on me proposa de remplacer une des profs de philo du lycée des Bruyères, Marie-Claire Lascault, pendant les six mois de son congé de maternité. Sacré défi pour moi, tenir une classe de philo de quarante élèves ! J’ai rencontré il y a peu de temps, à Paris, son fils Michel Lascault qui est artiste : c’est le bébé qui est né pendant que je remplaçais sa mère !
Après le bac, cela vous a-t-il été facile de faire des études universitaires ?
C’est vrai que ce n’était pas évident. Quand j’avais été viré du lycée en pre- mière, ma mère, furieuse, déçue, m’avait dit : « Si tu ne peux pas avoir le bac, tu travailles ! » En fait, j’ai pu aller à l’université parce que j’étais fils unique ; mes cousins et cousines n’ont pas tous eu cette possibilité, parce qu’ils étaient dans des familles nombreuses.
Pendant ces années de votre adolescence à Rouen, qu’est-ce qui vous a poussé vers le militantisme ? Vos parents, peut-être ?
C’est vrai que mon père était à la CGT et votait communiste, mais il n’était pas militant, ma mère non plus. Oh, comme disait René, Antoinette avait « levé le poing » au temps du Front populaire… Non, la rencontre décisive a été celle avec Françoise, qui est devenue ma femme.
C’était au lycée des Bruyères, le lycée de filles où vous étiez le seul garçon ?
Non, pas du tout ! C’était bien avant : je l’ai rencontrée à 15 ans, et elle en avait 18. Dans un club de natation, le « Stade sottevillais cheminot club ». À l’époque, notre différence d’âge était nette. De plus, elle faisait de la politique, la culture politique lui avait été transmise par son père, Marcel Le Toullec, qui avait été soldat à Verdun en 14, puis résistant dès 1940 ; il était militant au PC. Il était cheminot aussi : « bête humaine », il conduisait les machines à vapeur. Il a pris sa retraite à 50 ans et il est décédé à 96 ans, c’est rare « plus de retraite que d’active » ! Françoise a été militante très jeune, elle était à la cellule du PC à l’hôpital psychiatrique de Rouen14.
Vous avez donc fait un apprentissage en politique, avec elle, dès le lycée ! Et ensuite, à la fac ?
J’ai pris ma première carte au PC et à la CGT en 1963, à 18 ans… Et à la fac à Rouen, j’ai été responsable à l’UNEF15 et à l’UEC16. En 1966, on était tout un groupe, une soixantaine, on s’est fait exclure de l’UEC.
Comme au lycée ! Pourquoi donc, cette fois ? Encore pour « mauvais esprit »?
Oui, c’est un peu ça… En fait j’avais rencontré les quatre frères Marx ! Denis, Jean-Pierre, Laurent et Francis… A la suite d’une manifestation bien agitée contre le « plan Fouchet », on s’est fait traiter de « trotskistes », alors que je n’avais même pas lu Trotski. En 1966, Yvon Bourges, à l’époque secrétaire d’État à l’Information de De Gaulle, a décidé d’interdire le film de Jacques Rivette, La Religieuse, une interprétation du roman de Diderot17. Pour protester contre cette censure, j’ai rédigé un tract très anticlérical que j’ai présenté à une A.G. de l’UEC : grand succès et applaudissements ! Mais le responsable de l’UEC a dit que c’était impossible que ce tract sorte, car le PC était en train de tendre la main aux catholiques.
Vous êtes majoritaire à l’UEC pour diffuser ce tract, mais c’est le Parti qui décide!
Oui, c’est ça ! Mais on a quand même sorti le tract signé UEC… On s’est fait virer de cette façon de l’UEC ; puis j’ai été exclu du PCF, la décision a été prise le 16 novembre 1966, au cours de deux réunions de cellule. La première fois, j’ai gagné le vote « normal », à la seconde, la salle était bourrée et prévenue contre moi, ça a été chaud, ça a duré quatre heures, j’ai résisté et j’ai été « suspendu ». Ça revenait à me virer pour cause de trotskisme, de maoïsme, de gauchisme, ils ne savaient d’ailleurs pas trop, tout y est passé. J’ai raconté cela dans Mai 68 histoire sans fin. Tout ça pour un tract contre la censure…
Et pour indiscipline caractérisée sans doute ! Vers où vous êtes-vous dirigé alors, politiquement parlant ?
Eh bien, vers les trotskistes ! J’ai eu le contact avec Alain Krivine, qui était dans la même situation à Paris, exclu de l’UEC. Alors en 1966, on a fondé
17) L’annonce du tournage [de Suzanne Simonin, la Religieuse de Diderot] entraîne la protestation d’associations catholiques qui jugent le film anticlérical [...]. Même si La Religieuse de Rivette met en lumière la pratique des vocations forcées et des fausses vocations, et la décadence des mœurs dans certains couvents au
XVIIIe siècle, c’est surtout l’évocation de l’homosexualité féminine qui fait scandale. (Source : dossier de la Bibliothèque Centre Pompidou 22 janvier 2014). La déci- sion d’annuler la censure du film ne sera définitivement confirmée par le Conseil d’État qu’en 1975.
ensemble la Jeunesse communiste révolutionnaire (JCR). (Plus tard, en 1969, ce sera la Ligue communiste). Le moteur de ce nouveau parti, c’était la critique du stalinisme, car le PC soutenait l’URSS à 300 %, alors qu’elle avait envahi la Hongrie…
C’était un des pics de la Guerre froide. Mais à Rouen, vous l’aviez ressentie ?
Ah oui, mais bien avant, en 1957, au travers du foot notamment : les Hongrois étaient venus jouer au foot à Rouen, au stade Robert Diochon, ils étaient en tournée politico-sportive. C’était une équipe mémorable ; d’ailleurs, j’ai ren- contré l’an passé, au Grand Journal de Canal Plus, Guy Roux, l’entraîneur, et il a été capable de me citer tous les noms des joueurs hongrois. Mais quand ils sont venus à Rouen, on était en pleine Guerre froide et il venait d’y avoir, en 1956, l’insurrection de Budapest réprimée par les Soviétiques.
Revenons en 1966 : vous créez la JCR avec Alain Krivine.
Oui, je suis alors étudiant en philosophie à la fac de Mont-Saint-Aignan et je crée et milite dans les Comités Vietnam en 66/67 ; ça nous occupe beaucoup, on a fait deux manifestations, Six heures pour le Vietnam, qui ont été un grand succès, avec d’excellents orateurs nationaux et internationaux, des spectacles, des artistes, et on a fait venir Mouloudji, Colette Magny… qui a d’ailleurs failli enfoncer ma deux-chevaux ! Et un leader vietnamien, Le Dinh Nanh. Avec l’Ager-Unef on combat le plan Fouchet, et les ordon- nances de De Gaulle contre la Sécurité sociale… Je commence à venir à Paris, soit pour les réunions de l’UNEF, soit pour celles du Comité Vietnam national (CVN, avec Laurent Schwartz), soit pour celles des JCR…
Après, je suis acteur au premier plan de mai 68 à Rouen. On lance la grève générale dès le premier jour – comme à Paris. On a un gros poids auprès des étudiants, des lycéens et puis des travailleurs… Ceux de Renault-Cléon, René Cottrez et Bernard Dehors, viendront me dire dans la nuit, après le 13 mai, qu’ils viennent d’occuper l’entreprise. On « règne » sur la ville. Ça démarre comme une traînée de poudre dans toute la vallée de la Seine… C’est là que je comprends ce qu’est une grande crise de type révolutionnaire et je m’y sens bien, j’y apprends à parler devant des milliers de gens…
La prise de parole, c’est toujours un apprentissage important dans un par- cours militant ?
Ce n’est naturellement pas inné : je faisais de courtes interventions au début, je rougissais, je bafouillais, j’étais embarrassé avant de commencer. Mais après, ça venait facilement. C’est l’apprentissage du militantisme…
Cela vous a conduit à devenir le tribun que vous êtesaujourd’hui.
Merci, si vous le dites oui ; mais un meeting devant 150, ou 5 000 ou 20 000 personnes, ce n’est plus pareil, ça se construit : j’ai dû beaucoup
Gérard Filoche, Rue Jeanne d’Arc à Rouen, le 11 mai 1968
apprendre à changer de ton en permanence, user d’anecdotes, illustrer le sujet, pour obtenir l’attention. J’ai toujours un fil conducteur, mais ce que j’ai à dire, j’essaie de le dire avec des digressions concrètes, de la façon la plus vivante possible. Il faut parler avec son esprit, son corps et son cœur.
Vous avez été obligé de travailler pour vivre et faire vos études ?
Oui, et c’est pour ça que j’ai fait tant de boulots, j’avais pas un rond : j’ai été moniteur, puis pion, mais comme j’étais contractuel et militant, j’ai été viré ! Après, j’ai même été conducteur de train de marchandises ; on était deux dans la locomotive diesel, à l’époque. J’ai compris combien la vie des « rou- lants » était dure à cause des horaires en boucle, hachés sur trois semaines ; je l’ai fait huit mois, eh bien, même à 20 ans, ça épuise, et je vous le dis, je sais pourquoi je défends le régime de retraite spécial des cheminots. Ensuite j’ai été manutentionnaire, je déchargeais les camions, puis chauffeur livreur, tout ce qu’il faut pour survivre. Jusqu’à ce que je devienne permanent de la Ligue, journaliste à Rouge18.
C’était en quelle année ?
En 1970. J’anime le « secteur jeune » étudiant et lycéen. Dans les grèves des années 1970 à 1974. Des mobilisations, l’affaire Guiot, la circulaire Guichard, puis Richard Lahaye, jusqu’à la loi Debré. Et en 1971, 1973, sur- viennent le congrès d’Épinay, puis la signature du Programme commun. La LC19 ne comprend rien à cette résurgence des organisations traditionnelles du salariat. On croit que la période est ouverte à un nouveau parti révolu- tionnaire de la gauche et que nous allons vite le construire. On a, et j’ai, des
18) Rouge : journal hebdomadaire de la LCR.. 19) LC : ligue communiste
positions erronées sur la nature du PS, celle du PCF, et on ne perçoit pas que leur accord offre une issue politique qui va forcément l’emporter.
À peine devenu permanent de la LCR, vous semblez déjà très critique ?
Oui, j’y défends le syndicalisme de masse, dans l’UNEF. Et dans la CGT. Je suis pour l’unité syndicale. Je suis pour un syndicat de collégiens, de lycéens, d’étudiants, de soldats… J’étais – et je suis toujours – pour ce qu’on appelle « le Front unique », c’est-à-dire l’unité « de classe » de toutes les organisations de la gauche dans un même front commun. Comme Trotski qui, en 1936, appelait dans Où va la France ? à un gouvernement PS-PCF, Blum-Cachin, mais sans les Radicaux.
Quelle différence faites-vous entre les deux ?
Le Front populaire en 1936 incluait les Radicaux, qui étaient en fait un parti bourgeois. Pour moi, le front unique c’était un front élargi de la gauche PS et PCF, un front unique majoritaire contre la droite. Mais à la LC, devenue LCR, après la dissolution de juin 1973, j’étais en minorité pour défendre ce principe : ils me traitaient – à tort – de lambertiste20… C’étaient des batailles sans fin de tendances et de fractions ; les trots, à force de combattre les stals étaient marqués, ils n’étaient pas si démocratiques qu’ils auraient dû…
Alors vous quittez la Ligue ?
Non : en fait je suis militant dévoué pendant 30 ans, de 1966 à 1994, même si je suis en minorité à la LCR. Mais je reste permanent minoritaire, jour- naliste au quotidien Rouge, et j’écris mon premier livre, en 1984, Révolution portugaise, que la Ligue ne voudra pas éditer, parce qu’il n’est pas dans la ligne. La Révolution portugaise de 1974-75 est une excellente école pour comprendre ce qu’étaient les rapports du PSP21 et du PCP avec les mobilisations de masse.
Dans la LCR des années soixante-dix, il y aura beaucoup de conflits, sur le stalinisme, sur la lutte armée en Amérique latine, sur le Nicaragua, l’Iran, puis sur la Pologne… Mais à la fin, avec mes amis, nous ne pourrons plus nous faire entendre, ni nous exprimer. Ce fut dur, notamment pendant l’existence du quotidien Rouge, de mars 1975 à janvier 1979. Ma tendance obtient de 15 à 35 % des voix selon les congrès, de 1974 à 1979, mais influe peu. À un moment, ils me sanctionnent et me licencient ; je deviens ouvrier
20) Le courant dit « lambertiste » est un courant trotskiste impulsé par Pierre Boussel, alias Pierre Lambert, représenté par le Comité pour la reconstruction de la Quatrième Internationale (lambertiste), présent dans plusieurs pays du monde.
21) PSP : Parti socialiste portugais. PCP : Parti communiste portugais.
du livre, à Paris. Ça va durer presque deux ans, 1978 à 1979, années de la naissance de mes deux premières filles. Je serai à nouveau majoritaire en 1979, puis en 1981, mais à nouveau la pente naturelle de la majorité, c’est le gauchisme, pas le front unique…
Comment avez-vous obtenu ce travail d’ouvrier du livre ?
C’est la CGT qui avait le monopole de l’embauche des ouvriers du livre. Un de mes copains, Jean-Michel Vallantin, m’y avait fait rentrer. Je travaillais à la sortie des journaux, je faisais les paquets à la sortie des rotatives pour l’expédition de chacun des grands quotidiens.
C’était une bonne époque, sans doute ?
Oh oui, c’était en 1978/1979. Le salaire des ouvriers du livre était versé sur quatorze mois, avec huit semaines de congés payés, on gagnait bien à l’époque… même davantage que ce que j’aurai plus tard comme contrôleur du travail débutant. Le syndicat me donnait le planning, on disait d’ail- leurs : « Tu appelles Blanqui pour savoir où tu vas bosser. » Boulevard Blanqui, c’est le siège du Syndicat CGT du livre… J’étais « ficeleur ». Je faisais les paquets, avec ma « serpette », j’allais à l’Huma, à France soir, au Figaro, au Monde, au JDD, à Investir, et longtemps de nuit aux NMPP22, boulevard Mac-Donald.
Quand arrive votre rupture définitive avec la LCR ?
Nous regagnons une majorité à la Ligue en 1979. Je redeviens permanent. Le Matin titre : « Les amis de M. Krivine sont en minorité. » En 1981, Mitterrand gagne les élections et on rediscute sur l’attitude à avoir vis-à-vis du pouvoir,
22) NMPP : Nouvelles messageries de la presse parisienne
en 1981, en 1983, en 1988… jusqu’à la déroute de mars 1993. Je suis à nouveau « dépermanentisé ». C’est à ce moment que je rentre au Ministère du travail. Avec mes amis, nous restons membres de la LCR jusqu’en 1994. Il y aura un grand désaccord sur la chute du mur de Berlin en novembre 1989. Je crie « Champagne ! », Daniel Bensaïd crie « Alka-Seltzer ! ». Je me réjouis de la chute du Mur ; il affirme que nous en construirons d’autres. L’effondrement du stalinisme est pour moi une victoire, les évènements sont perçus comme une défaite par la majorité de la LCR. Là, il surgit un désaccord théorique profond sur la place de la démocratie historique et pratique sur la construction du socialisme.
On va faire un premier bulletin en 1989 qui va s’appeler Vent d’est, puis en 1992, Démocratie et Révolution, puis Démocratie et Socialisme (D&S). Daniel Bensaïd va nous faire sanctionner par le congrès de juin 1994, qui va voter que nous sommes « hors normes ». Ce vote nous pousse dehors. On est 150, regroupés autour de D&S, quand on va ensemble décider collectivement de rejoindre le Parti socialiste. Si notre tendance part en été 1994, c’est finale- ment parce que nous rejetons la politique de dénonciation systématique de ce que fait la gauche et le refus de la majorité de la LCR de voter PS pour battre la droite en mars 199323. Et surtout l’incompréhension du rôle fon- damental de la démocratie dans le socialisme. Avec mes amis, j’ai finalement toujours été pour une politique de front unique, c’est-à-dire qu’on a une attitude de proposition et de construction envers toute la gauche, on suscite le débat, pas la polémique, on cherche l’unité, pas le clivage, on choisit les thèmes unificateurs, on avance dans l’action vers un seul objectif à la fois, on influence, on cherche à gagner une large majorité, pas à agiter l’exemple d’une minorité agissante. On ne cultive pas les noyaux d’avant-garde
23) 21 et 28 mars 1993 : élections législatives sous la présidence de François Mitterand, élu en 1988.
donneurs de leçons, éternels et vains, on s’éduque, on éduque, on fait faire aux autres le chemin qu’on a soi-même parcouru. L’action démocratique, collective, pour cela est une méthode, un moyen, un chemin et un but. Sans démocratie, pas de socialisme.
Actuellement, c’est votre position au Bureau national du PS : vous êtes à l’intérieur, vous critiquez fort et à voix haute, vous proposez des alternatives… et vous êtes rarement entendu. Ce n’est pas confortable…
C’est un beau et bon choix. Pas de regrets. Mieux vaut défendre ses idées au cœur de la gauche, que dans les marges de la gauche. On me dit souvent : « Tu as le goût d’être minoritaire. » Et je réponds : « Je n’ai pas de remords quand je vois ce que font les majoritaires ! »
Comment peut-on convaincre les socialistes de changer quand on n’est pas dans le Parti ? Les gens ont l’impression qu’un parti doit être monolithique, mais non, au contraire ! Le PS choisit sa direction à la proportionnelle, ce qui lui permet d’exister de façon pluraliste et c’est comme cela que je suis au Bureau national ; et avec mes amis je défends librement, loyalement, publi- quement, les positions que la gauche socialiste défend.
Êtes-vous toujours partisan d’un front uni de la gauche ?
L’histoire nous rappelle la nécessité du front uni : quand Hitler menaçait en Allemagne, en 1930, il était minoritaire, alors que le PS et le PC, les deux grands partis ouvriers allemands, étaient majoritaires. Trotski appelait alors leurs militants à faire front ensemble, car l’unité était fondamentale pour empêcher le nazisme d’écraser la classe ouvrière. Mais au lieu de s’unir, socialistes et communistes se combattaient. Les staliniens de l’époque don- naient la priorité au combat contre le « social-fascisme ». Et les socialistes combattaient les staliniens. Alors Hitler est arrivé au pouvoir. Cette ligne de « front unique » de Léon Trotski, c’est la plus importante de l’histoire du mouvement social. Sans unité, rien de grand ne s’est jamais fait en France. Aujourd’hui, on a les congés payés, les 40 heures passées à 39, puis à 35, la Sécu, les retraites, le droit du travail, grâce à l’unité. Dans le PS, par exemple, Jean Poperen défendait « le front de classe ». Mitterrand a gagné grâce à l’unité. Lionel Jospin aussi, avec la gauche plurielle. Hollande aussi, d’ail- leurs, car sans les voix de toute la gauche, il ne passait pas en mai 2012.
La gauche, aujourd’hui, c’est 17 partis, 30 orientations, 8 syndicats. Le salariat organisé, c’est tout ça. Sans l’unifier dans la lutte comme dans les élections, pas de victoire. Dans le seul Parti communiste, il y a eu au der- nier congrès quatre plateformes différentes. Dans le Parti de gauche de Mélenchon, il y avait quatre textes différents, mais Mélenchon empêche
les tendances, ça le rassure peut-être mais il a perdu cinq à six dirigeants en agissant ainsi. Dans le NPA, il y a trois ou quatre plateformes, etc. Je suis pour un grand parti pluraliste de toute la gauche, à condition qu’il soit scru- puleusement démocratique.
Sans unifier toute la gauche, ce sont les sociaux-libéraux qui l’emportent et imposent à la gauche une politique droitière.
Vous n’êtes pas seul à la défendre au sein du Parti socialiste ?
Non, Jean-Christophe Cambadélis lui-même a défendu le « front unique » dans le passé, c’est la culture qu’il a tétée au biberon au PCI24 ! Et il est aujourd’hui premier secrétaire du PS. De même que d’autres anciens trots- kistes comme Julien Dray, Marie-Noëlle Lienemann, qui sont au Bureau national. Lionel Jospin, comme chacun sait, avait aussi cette culture. La gauche socialiste, depuis plus de 20 ans, a été matricée sur cette ligne uni- taire « rose rouge verte ».
Revenons à votre parcours professionnel. Comment êtes-vous devenu inspecteur du travail ?
J’ai passé plusieurs concours en 1982 dont celui de contrôleur du travail et j’ai été reçu premier : au tirage au sort, ils m’avaient interrogé sur le Front populaire ! Puis j’ai passé le concours interne d’inspecteur du travail en 1985, et j’ai été reçu troisième. J’ai commencé en Champagne-Ardenne, dans l’agriculture. Je me souviens du premier accident du travail rencontré : doigts gelés… Le salarié travaillait par moins 20 degrés dans une scierie agri- cole à Givet. C’était un souvenir pour moi, mon père avait eu les tendons
24) OCI : Organisation communiste internationaliste , devenue ensuite Parti commu- niste internationaliste (PCI), organisation trotskiste lambertiste.
Comment vous êtes-vous fait remarquer comme inspecteur du travail ?
Je ne me suis pas faire « remarquer », j’ai fait mon boulot. Notamment contre les ouvertures illégales du dimanche dans le IIIe arrondissement : 42 dimanches de contrôle, 420 procès-verbaux. Martine Aubry à la Rochelle, en août 1997, avait dit publiquement que « j’étais le meilleur inspecteur du travail de France ». J’ai commencé par écrire des articles sur les conditions de travail des salariés, un peu comme un inspecteur du début du siècle dernier dont le nom était Pierre Hamp. Puis j’ai écrit des bouquins comme Balladur et le chômage de masse ou Carnets d’un inspecteur du travail, puis sur les 35 heures25. J’ai fait des centaines de réunions comme militant politique et syn- dical à partir de chacun de ces livres. Des journalistes m’ont repéré sur le droit du travail. Oh, j’avais déjà fait des émissions de télévision ou de radio, les pre- mières en 1971, elles sont dans les archives de l’INA. Mais autour des années quatre-vingt-dix, à partir notamment de l’émission La Marche du siècle, avec Jean-Marie Cavada, puis avec Michel Field, on m’invite comme inspecteur du travail : je m’aperçois que je défends ainsi mieux le Code du travail, en le vulgarisant. Je ne fais pas de théorie, je parle de cas exemplaires, c’est du concret et c’est écouté, entendu. Il s’agit de la vie intime de millions de sala- riés. J’ai continué d’écrire des « Carnets d’un inspecteur du travail », j’aurais pu en faire un tous les six mois. Puis j’ai écrit des articles, des chroniques, dans Siné Hebdo en 2008, puis avec plaisir dans L’Humanité Dimanche… Le droit du travail, c’est un combat essentiel, vital, public ; il ne se mène pas
25) Cf. bibliographie de Gérard Filoche à la fin du livre.
« discrètement », mais au contraire avec tambour et trompette. Il faut faire du tam-tam en permanence pour défendre nos droits dans les entreprises.
Mais vous avez été sanctionné comme inspecteur. Qu’est-ce qui vous a été reproché ?
Sous le motif écrit et répété chaque année dans mon dossier (« continue de s’exprimer dans les médias »), l’administration me supprime quand même toutes mes primes pendant dix ans, à partir des années 2000. Je vais avoir une menace de « blâme » en 1999, mais elle va être heureusement écartée. Un procès sera suscité par un patron (celui de la société Guinot) contre moi, et l’administra- tion (le directeur général du Travail, Jean-Denis Combrexelle) refusera de me défendre ; l’affaire durera 8 ans de 2004 à 2012, mais je gagnerai.
En fait je n’ai cessé de m’exprimer, et j’ai eu raison : le droit du travail, ce n’est pas seulement des contrôles, des visites, des observations, des mises en demeure et des procès-verbaux, c’est aussi une mission définie par l’OIT. La convention 82 de l’OIT confie aux inspections « la mission d’alerter les gouvernements en place sur le sort qui est fait aux salariés ». J’ai alerté ! J’ai accompli cette mission publique sans céder. Un inspecteur doit être indé- pendant mais pas neutre. Il doit imposer aux patrons le respect du Code républicain, et pour ça, il faut un climat d’éducation, de compréhension, d’approbation, et non pas une période de dénigrement, de recul des droits des salariés comme le Medef veut l’imposer.
Deux de nos collègues Sylvie Tremouille et Daniel Buffiéres ont été assassinés le 2 septembre 2004 à Saussignac en Dordogne, par un propriétaire terrien, ancien militaire, ancien patron d’une boite d’assurances, qui exploitait illéga- lement des immigrés dans ses 35 hectares de vignes et de pruniers. La réaction des pouvoirs publics, à l’époque Chirac, Raffarin, Gaymard, Sarkozy, Borloo, a été en dessous de tout. C’était un fait de société et non pas un « fait divers ». Il a fallu batailler durement et mobiliser tout le corps de l’inspection pour que
la presse en parle à la hauteur des aspects politiques du crime commis contre des agents en mission pour défendre le droit du travail26.
Revenons à votre arrivée au PS et à votre fonction d’inspecteur du travail. Martine Aubry devient ministre et c’est le temps des 35 heures : comment cela se passe-t-il ?
En 1994, Henri Emmanuelli est premier secrétaire du PS et signe l’ap- pel pour une loi pour les « 35 heures hebdomadaires sans perte de salaire », lancé par des syndicalistes, et que Démocratie et Socialisme propage. Juste au moment où nous faisons la jonction avec le PS, cela ne peut tomber mieux. Lorsque nous aurons fusionné avec la gauche socialiste de Dray, Mélenchon, Lienemann, Désir, Rossignol, lors des grandes conventions du PS de 1996, en mars, juin et décembre, on bataillera à fond pour faire avan- cer des propositions en droit du travail (droit d’avis conforme des comités d’entreprise, contrôle des licenciements…). On y défendra surtout les 35 heures mais on ne dépassera pas 33 % des voix… C’est Lionel Jospin, tout seul, qui va nous donner raison, le 17 avril 1997 à l’émission « 7 sur 7 », lorsque Chirac dissout l’Assemblée nationale : il propose, en direct, « 35 heures hebdomadaires sans perte de salaire ». C’est parti… Il gagnera grâce à ce mot d’ordre !
Il fera voter la loi en deux parties, en juin 1998 et en décembre 2000. Ce sera une rude bataille pour que ça aille jusqu’au bout. Mais ce sera le seul moment, en 30 ans, où le chômage de masse reculera : à croissance égale, il y aura 400 000 emplois de plus, créés à cette période, en 2000, que dans tous les autres pays comparables.
26) Cf. On achève bien les inspecteurs du travail. Gérard Filoche – Ed. Gawsewitch, 2005.
J’ai écrit de nombreux livres, seul ou avec des camarades de D&S, de la gauche socialiste, sur cette bataille des 35 heures. Elle a duré 5 ans. Et depuis plus de 10 ans, la droite et le Medef veulent les défaire.
Mais ce qui est à l’ordre du jour maintenant, ce sont les 32 heures et les 30 heures. On a 6 millions de chômeurs ! Et la poussée démographique depuis l’an 2000 va nous amener 850 000 jeunes par an sur le marché du travail à partir de 2018. Il n’y aura pas de réduction du chômage de masse sans réduction de la durée du travail. Hélas, à mi-mandat, François Hollande ne soutient pas cette idée.
Mais vous avez été aussi l’objet de procès dans l’exercice de votre métier d’inspecteur du travail ?
Ah, le procès Guinot ! C’est une histoire que je n’ai pas vue venir. On est en juillet 2004, je vais à une réunion banale d’un comité d’entreprise de mon secteur, c’est la deuxième plus grosse entreprise d’esthétique, dont les locaux sont rue de la Paix, dans le 2e arrondissement de Paris. La femme que je suis venu assister – nous l’appellerons Nassera – revient de congé de maternité, elle est depuis six ans cadre commercial, d’origine arabe, très efficace pour les ventes dans tout le secteur du Moyen-Orient. Quand elle veut reprendre son poste, ils l’affectent à la zone Pacifique/Amérique latine, ce n’est pas sa zone, pas sa langue ; le Code du travail dit que la femme doit avoir à son retour de congé de maternité un « poste identique ou similaire », donc pas forcément le même poste qu’avant son congé… Tout le conflit commence.
Quels sont les motifs de sa mise au placard ?
Les patrons sont toujours durs avec les femmes à leur retour de couches. Nassera vient à ma permanence de l’inspection pour m’expliquer sa situation, mais aussi les conditions de travail des 250 cadres au siège : 41 heures payées 35… Les heures sup non rémunérées, la direction les appelait « les heures philanthro- piques » ! Et pas de comité d’entreprise, alors qu’ils dépassaient largement les seuils prévus par la loi. Quand cette femme cadre se plaint à l’Inspection, on lui explique : « On va faire respecter le droit, mais si vous voulez vous défendre, il faut aller voir les syndicats. » C’est ce qu’elle va faire… Elle sera très courageuse. On ne le sait pas alors, mais cela lui vaudra, et me vaudra, quatorze procès en huit ans.
S’est-elle syndiquée, quand elle a été confrontée à cette situation ?
Oui, à la CGT, et elle est même devenue déléguée syndicale. En conjuguant les efforts, avec son syndicat et avec mes interventions d’inspecteur, on finit par réussir à imposer la création d’un comité d’entreprise. Mais le patron le rend vain : il n’y aura qu’un collègue cadre dans ce C.E. et les élus seront ceux que la direction aura poussés à se présenter.
Et il y a donc eu quatorze procès ? Aux prud’hommes ?
Oui, le premier recours qu’ils ont intenté, c’était déjà pour la licencier. Mais comme elle était salariée « protégée », en tant que déléguée syndi- cale, il fallait demander l’avis du C.E., qui est purement consultatif, mais aussi l’autorisation de l’inspecteur du travail. J’ai refusé de la donner au motif que cela revenait à la discriminer à son retour de congé de mater- nité. Mon directeur me dit : « Ce n’est pas prouvé. » Et il casse ma décision sur le fond, mais la maintient sur la forme, car « ils n’ont pas consulté le C.E. »…
En fait, ce directeur confirme qu’elle n’est pas licenciée, mais sans se prononcer sur le fond.
C’est exactement ça. Évidemment, ses employeurs ne sont pas d’accord pour la garder. Alors, ils vont convoquer pour de bon le C.E. pour respecter la forme, en le « consultant ». Avis favorable dudit C.E., bien sûr, puisque l’élu était pro-direction. Mais moi, je maintiens mon refus d’autoriser le licencie- ment pour le même motif : discrimination au retour de congé de maternité ! La direction s’énerve et demande une troisième fois l’autorisation de licen- ciement avec un autre argument : Nassera avait une semaine de congés payés à prendre en juin 2004, elle en fait la demande dès le mois de mars, par mail, à son chef hiérarchique, donc en respectant les délais de préve- nance. Et elle part en congés. Mais pendant ses vacances, le patron l’appelle en disant qu’elle n’a pas eu d’autorisation signée ; comme elle lui rétorque qu’elle en a une, il envoie chez elle un huissier pour récupérer le papier. À son retour, faute lourde ! « Faux en écriture, signature imitée sur le formulaire
d’autorisation de congés », disent-ils. Ils iront jusqu’à faire intervenir un gra- phologue pour tenter de le prouver.
Et alors ? Ce sera la dernière tentative des patrons ?
Non, on ne baisse pas les bras ! La direction fait une nouvelle demande de licenciement, le C.E. est (re)convoqué pour donner son avis. Mais cette fois- ci, Nassera n’a plus de salaire car elle a été mise à pied pour faute. On est fin juillet, elle risque de passer deux mois sans salaire, je décide alors de me pré- senter dans l’entreprise le jour de la convocation du C.E., qui est bidon. Je fais mon enquête de façon sereine, j’interroge des salariés sur place ; ils n’ont pas eu besoin de bulletin signé pour formaliser leur départ en congés, c’est donc de la discrimination d’en avoir exigé un pour Nassera. Celui qu’elle a présenté est-il un « faux » ? Son chef de service est embarrassé : « Je ne me souviens plus, je peux l’avoir signé comme je peux ne pas l’avoir signé. Ça peut être ma signature, comme ça peut ne pas l’être. » Trois ans plus tard, ce chef de service sera lui-même viré et il dira qu’il avait bien signé le formu- laire ! Mais entre-temps le C.E. a donné de nouveau un avis favorable à son licenciement, et je dois, pour l’éviter, donner de nouveau un avis négatif. Invraisemblable, cet acharnement. Car ce n’est pas fini.
Que se passe-t-il ? Vous êtes de nouveau désavoué en partie par votre hiérarchie, comme pour le premier refus d’autoriser le licenciement ?
Pas en partie, totalement. Et cette fois-ci, c’est le Directeur général du travail en personne, Jean-Denis Combrexelle, qui casse ma décision… Dans une lettre datée du 10 décembre 2007, il répond au juge qui lui demande si un inspec- teur peut assister à une réunion de C.E. : « Je considère que la participation de l’inspecteur à la réunion, et sa prise de parole avant le vote, sont de nature à troubler les opérations de vote et vicier la procédure. Le délit d’entrave au fonctionnement du comité d’établissement pourrait être évoqué en fonction des circonstances. » Sauf que le vote est « fait » d’avance, et que le CE est totalement bidon, son avis indicatif : je n’avais donc ni sens, ni besoin, ni intérêt à « troubler les opérations de vote ».
Pourtant les inspecteurs du travail peuvent participer à des C.E. !
Effectivement, rien dans le Code du travail n’interdit à un inspecteur de se rendre à un C.E. Il peut même convoquer une réunion de C.E. et la présider, s’il juge que ce C.E. ne fonctionne pas correctement. Il peut y être invité, soit par le C.E., soit par l’employeur, ce qui arrive. Les comptes ren- dus de C.E. doivent être envoyés à l’inspecteur à sa demande. Si bien que, dans les états de visite mensuels des inspecteurs, il existe une croix à cocher, en face de la question suivante : « À combien de C.E. ou C.C.E. vous êtes-vous rendu ce mois-ci ? »
Et l’entreprise porte plainte contre moi pour « chantage » et intimidation du C.E. ! Je suis mis en examen le 21 novembre 2008 et renvoyé en audience correctionnelle le 21 novembre 2010 pour « entrave au C.E. ». La requalifi- cation en délit a été effectuée par le Parquet lui-même dans un réquisitoire supplétif. J’encours un emprisonnement d’un an et une amende de 3750 euros en vertu de l’article L.2328-1 du Code du travail.
Alors que vous ne faisiez que votre travail d’inspecteur du travail !
Oui ! J’estime avoir fait ce matin-là le travail d’un inspecteur chargé de faire respecter l’état de droit dans cette entreprise, en opportunité et en urgence, dans une situation critique où l’ordre public social était en cause. Et pour- tant, je ne gagnerai cette évidence que le 6 juillet 2012 devant le Tribunal pénal : le Tribunal dit qu’il n’y a pas matière, que le C.E. ne fonctionnait pas.
Nassera va gagner tous ses procès, pour ses droits de déléguée syndicale, pour ses droits de femme de retour de congé maternité, pour discrimination. Le Tribunal administratif désavoue Jean-Denis Combrexelle, et elle est réinté- grée dans l’entreprise ! Mais à ce stade, la direction finit par lui proposer une transaction amiable avec une forte indemnisation à la clé. Elle a une grande compétence et a retrouvé du travail, elle a un deuxième enfant et une belle carrière. Elle a eu du « cran », et elle exprime bien la souffrance qui a été si longuement la sienne pour faire valoir ses droits élémentaires contre un vrai complot manichéen, d’un patron sans scrupule. En fait, si l’inspecteur du travail que j’étais n’avait pas agi comme je l’ai fait, et si elle n’avait pas eu le courage de se battre avec une telle ténacité, elle aurait été sanctionnée par une direction toute-puissante de « droit divin » qui ne tolère ni syndicat, ni contestation dans son entreprise.
Donc victoire sur toute la ligne, mais au bout de quatorze ans de procédures ! Et vous, avez-vous laissé des plumes dans cette bataille pour la reconnaissance du droit ?
Plutôt, oui… Car Jean-Denis Combrexelle m’avait à un moment convoqué pour me menacer en direct. « Des millions de Français voient l’Inspection du travail à travers vous, hélas ! », m’avait-il dit en exigeant que je me taise et que je travaille selon ses normes. Aucune aide, aucun entretien à propos de ce procès Guinot (dont je pense qu’il se réjouissait, et peut-être l’attisait), et il ne m’avait pas accordé la protection fonctionnelle (c’est une aide financière dont peut bénéficier tout fonctionnaire attaqué en justice, alors qu’il est dans l’exercice de ses fonctions). Les frais de justice ont coûté cher, mais une bonne partie a été couverte par une généreuse souscription, suite à une péti- tion qui a recueilli 42 000 signatures – dont celle de François Hollande –,
et grâce à un site (www.solidarité-filoche) où tout cela fut rendu public et expliqué au fur et à mesure. Il y eut deux « mini-manifs » devant le palais de justice de Paris en 2010 et 2012, où plusieurs centaines de proches et de nombreuses personnalités de toute la gauche sont venus me soutenir. J’ai été touché par l’immense affection qui m’a été donnée par des dizaines de milliers de gens en cette circonstance, et je n’ai de cesse de les remercier.
Et le patron de cette entreprise a tout perdu dans cette procédure longue de quatorze ans.
Tout perdu ? Non, pas vraiment. Il a économisé sur cette période des millions d’euros d’heures supplémentaires que je ne pouvais plus contrôler, car il ne m’était plus vraiment possible de mettre les pieds dans la boîte. Il faut dire aussi qu’il avait choisi Maître Varaut, qui fut l’avocat de Maurice Papon, lors de son procès en crime contre l’humanité. C’est un des avocats de l’UIMM27.
Je crois que vous avez eu aussi des démêlés juridiques avec l’UIMM ?
C’est le moins que l’on puisse dire : l’UIMM m’aura ainsi intenté trois procès ! Le premier en 1999, j’étais sur la liste du Parti socialiste pour les élections européennes. Et pendant la campagne, j’ai dit sur Radio France- Melun : « Les patrons trichent contre les 35 heures ». Le patron du Medef de Seine-et-Marne m’a poursuivi devant les tribunaux pour « diffamation et atteinte au moral des entreprises ». Mais c’est lui qui a été condamné pour abus du droit d’ester en justice, à 10 000 francs !
Autre procès en 2001 : dans la revue mensuelle Démocratie et Socialisme, j’avais mis la photo de Denis Kessler, alors numéro deux du Medef, avec
27) UIMM : Union des industries et des métiers de la métallurgie. Organisation pro- fessionnelle des entreprises de ce secteur.
une cible indiquant « ennemi public numéro 1 ». Quand le procès a débuté, pour me défendre, j’ai rappelé que c’était Jean Gandois28 lui-même qui avait dit : « Il faut des tueurs à la tête du Medef ». Deux ministres en exercice étaient dans la salle pour me défendre, Jean-Luc Mélenchon et Marie-Noëlle Lienemann. Le président du tribunal a condamné Denis Kessler à 40 000 francs de dommages et intérêts pour abus du droit d’ester en justice. Et de deux !
Vous avez donc payé de votre personne pour la défense du droit du travail.
Ainsi, jamais aucun procès intenté contre moi n’a été gagné par la partie adverse, bien au contraire. Pourtant j’ai été pénalisé : j’aurais pu accéder à la fin de ma carrière à l’échelon le plus élevé, Directeur du travail. Je n’ai pas eu droit à cette promotion, j’ai perdu mes primes et ma retraite n’est pas ce qu’elle aurait pu être. Je pourrais faire plus de voyages avec mes enfants et petits-enfants !
J’ai quand même eu une forme courte de compensation, ou de reconnais- sance, comme vous voudrez : Lionel Jospin m’a nommé « personnalité qua- lifiée » pendant deux ans, de 1999 à 2001, au Conseil économique et social (CES). J’allais une journée par semaine au palais d’Iéna et j’ai même eu le temps et l’énergie d’y rédiger un rapport publié au Journal officiel, adopté par le CES, sur les « 20 ans des CHSCT ». Malheureusement, c’est François Fillon qui est venu plancher sur ce rapport devant le CES en 2002, mais en ignorant son contenu et en faisant quelque chose qui ne se fait, paraît-il,
28) Jean Gandois, alors président du CNPF (Conseil national du patronat français), démissionne de ses fonctions en 1997 en affirmant qu’il faut « un profil de tueur » pour tenir ce poste. C’est « le baron » Ernest-Antoine Seillière qui lui succède à
la tête du syndicat du patronat, rebaptisé Medef (Mouvement des entreprises de France) en 1998.
jamais : à aucun moment il n’a cité le nom de l’auteur du rapport, alors que j’étais assis au premier rang, là, sous ses yeux. Dix ans après, je lui ai dit ma rancune en le croisant sur un quai de gare à Arras.
Je vous sens très amer. Mais au travers de tous ces combats, vous avez gagné l’estime de ces dizaines de milliers de personnes qui vous ont suivi et soutenu. Et vous avez toujours une forte légitimité auprès de vos pairs, les contrôleurs et les inspecteurs du travail.
Oui et non ! En 2003, le nouveau directeur de l’Institut du travail a accueilli la promotion en leur disant : « On va vous former comme de vrais inspecteurs du travail, pas des Gérard Filoche. » Mais la promotion a été unanime pour clore son cycle de formation… en m’invitant ! Soixante nouveaux inspec- teurs m’ont demandé d’intervenir et sont venus m’écouter, et je considère que c’est un échec dans la tentative de normaliser l’Inspection du travail. L’un d’eux m’a même dit : « Si j’ai passé le concours, c’est à cause de toi ! » J’en ai été très ému.
En quoi consiste cette menace de canalisation de l’Inspection du travail que vous évoquez ?
Le projet de loi Sapin-Rebsamen-Robillard, qui vise à casser l’Inspection du travail, est un cadeau au Medef, en « dessous de table » du pseudo « Pacte de responsabilité ». Il remet en cause trois principes fondamentaux du métier : la territorialité, le caractère généraliste et l’indépendance des inspecteurs du travail.
En clair, quels sont les risques ?
Les inspecteurs du travail ne seront plus attachés à un territoire, ils pourront être mutés au bon vouloir de leur hiérarchie. Certains seront intégrés dans
des « brigades de spécialité » et ne pourront alors plus intervenir sur l’en- semble du droit du travail, mais sur des « compartiments » de celui-ci. Enfin, c’est l’administration – et non plus les IT – qui va décider des sanctions envers les entreprises, par observation, mise en demeure ou procès-verbal. Mais aussi par des sanctions administratives… négociables en « plaider-cou- pable ». Finalement, c’est le droit pénal du travail qui va être gravement affai- bli. Autrement dit, la DIRECCTE prend le pouvoir et va être en position de négocier politiquement les pénalités avec les patrons lorsqu’ils ne respectent pas le Code du travail.
Vous craignez donc une fragilisation irréversible des inspecteurs du travail dans leurs missions ?
Oui, précisément, et c’est un comble car le projet de loi s’intitule Pour un ministère du Travail fort, alors qu’il va à l’encontre d’une Inspection du travail forte. Il faut que les députés de gauche rejettent cette loi qui fait l’objet de 100 % d’opposition parmi les syndicats dans l’Inspection du travail.
Au final, tout au long de votre vie, vous êtes parti en guerre contre l’entreprise de démolition du Code du travail que fomentent les organisations patronales. Êtes-vous toujours optimiste quant à l’issue ?
Si je n’avais pas été militant, ce métier d’inspecteur du travail me l’aurait fait devenir. J’aime à dire que : « Tout corps plongé dans l’entreprise reçoit une poussée égale à l’exploitation qu’il subit. » Ma colère vient de la ruine des légi- times espoirs de reconstruction du Code du travail, alors que la gauche est arrivée au pouvoir grâce aux 70 % des salariés qui ont voté pour elle. Au lieu d’effacer les reculades de la droite, le gouvernement de gauche, pour lequel nous avons voté et que nous soutenons, les entérine et en rajoute.
1
Est-ce un aveu de désespoir ?
En aucune façon ! Je suis un optimiste viscéral. Ça fait 51 ans que je milite, comme syndicaliste et à gauche. La démocratie vaincra. Et le socialisme s’imposera comme une idée neuve. Il y a 24 millions de salariés et 1,2 mil- lion de patrons. Les salariés sont plus nombreux, c’est nous qui aurons force de loi et tôt ou tard la révolte, la lutte, le droit l’emporteront, lorsqu’une occasion propice surgira. Comme je l’ai dit dans un de mes livres, un autre Mai 68 est possible, Mai 68, c’est une histoire sans fin.
Le droit du travail, je le répète en conclusion, c’est fondamental dans une civilisation : ce sont les salariés, 93 % des actifs, qui produisent les richesses et n’en ont pas la part qu’ils méritent. Un bon Code du travail, ça garantit un bon salaire. Un bon Code du travail, ça garantit l’emploi. Un bon Code du travail est nécessaire à la dignité des humains dans toute entreprise.
Les idées selon lesquelles il faudrait abaisser les droits du travail pour « pro- duire plus » et « être plus compétitifs » ont quelque chose d’obscurantiste et de barbare. Ce sont les salariés bien formés, bien traités, bien payés, qui produisent le plus et le mieux.