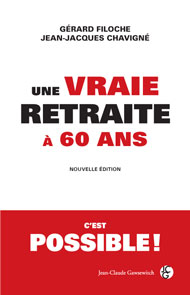On dit que Jacques Delors ne voulut pas etre candidat a la présidence de la république. En fait il ne pouvait pas l’être : comme il l’expliqua, il n’y avait pas de majorité pour sa politique libérale.
pour le comprendre il suffit de lire le livre qu’il publia à l’époque « l’unité d’un homme » : il contenait tout ce que le patronat et les libéraux voulaient et ont fait depuis, baisse des salaires, temps partiels, CIP, CPE, casse du code du travail, retraite à 65 ans…
récit : (extrait de « mai 68 histoire sans fin » tome 2 Ed. Atlande )
Le congrès de Liévin
Il se tient les 18, 19 et 20 novembre 1994. Le choix du lieu du congrès n’est pas neutre. Tout est fait pour une réorientation du parti à gauche et vers sa base populaire. Le Pas-de-Calais est la plus grande fédération ouvrière du parti.
Sur place, on nous distribue une carte du département avec un détail de l’implantation des sections, ville par ville, quartier par quartier. Quelque 12 000 à 13 000 membres tiennent tout le département et la majorité des communes, environ vingt-cinq sénateurs, députés, députés européens, plus de quatre-vingts conseillers généraux et régionaux… Impressionnant, quasi soviétique !
Qui a dit que ce parti n’avait pas de base populaire ? Un soir, à Béthune, a lieu un immense banquet républicain de 1 200 couverts, où nous nous levons toutes les dix minutes pour chanter, accompagnés d’un orchestre tyrolien, « Étoile des neiges », et « Dors mon p’tit quinquin », tous debout bras en l’air liés par le petit doigt. Évidemment ce n’est pas du rap. Mais pendant ce temps-là, Jacques Mellick serre méticuleusement toutes les mains des convives : j’admire la performance, il dit un mot à chacun, et cela lui prend environ deux heures.
À ce congrès, vient François Mitterrand, encore président et qui, à ce titre, ne pouvant y assister, contourne ironiquement le protocole en tenant, juste à côté, dans la Mairie, un discours quasiment de vieux dirigeant ouvrier, philosophant sur les corons, les grèves, les coups de grisou, la solidarité et la Sécurité sociale, devant une foule recueillie, au pied des anciennes mines. Des milliers de gens militants émus sont rassemblés autour de la Mairie, trop petite, mais largement sonorisée à l’extérieur.
Deux motions sont soumises à la discussion et au vote des militants du congrès : la motion « Être socialiste », présentée par Henri Emmanuelli, recueille 92,15 % des suffrages, et l’opportuniste motion « Agir en socialistes » (Vincent Peillon) 7,85 %.
À l’issue du congrès, Henri Emmanuelli est élu officiellement Premier secrétaire par les délégués au congrès, avec plus de 87 % des voix.
Mais ça, c’est l’apparence.
La dispute de fond, derrière, est : Jacques Delors sera-t-il ou non candidat à la présidentielle de 1995, et dans quelles conditions ?
Les institutions de la V° République martyrisent le PS comme toute la gauche. François Mitterrand les avaient décrites comme « un coup d’État permanent » mais en 14 ans d’exercice du pouvoir il ne les avait pas changées ! Tout se concentre donc toujours dans le choix du candidat. Mais c’est cruel : comment faire un « tournant à gauche » avec un « candidat du centre » ?
Cet écartèlement du parti va être durable.
Il règne une atmosphère un peu comparable à celle qui se reproduira 12 ans plus tard, lors de la désignation de Ségolène Royal en 2006 : les sondages ne donnent grâce qu’à Jacques Delors, la pression des médias sur les militants et contre l’indépendance du parti est forte.
Delors, Delors !
La question présidentielle pourrit tout : dans cette Ve République si vous ne disposez pas de candidat « agréable » aux médias et à l’opinion, vous n’existez pas comme opposants. Donc quels que soient vos idées, vos projets, vos forces, il vous faut un « leader », un chef (et difficilement « une » cheffe) éligible, capable de passer le filtre du suffrage personnalisé universel, adoubé par les magazines people des grands capitalistes du pays. La couleur de la cravate ou du tailleur, le sourire à dents blanches, le profil expert notable « compétent », médiatique sont déterminants. Les sondages bien fabriqués pèsent à la fois sur les électeurs et contre les militants.
La présidentielle maudite hante chaque parti : c’est le système le moins démocratique qui soit, c’est le plus réducteur, le plus dépolitisant, le plus pervers, le plus manipulable. On peut imaginer que nos concitoyens se réveilleront et se redresseront un jour (je serais encore obligé d’y revenir dans Macron ou la casse sociale » livre paru en 2018 !), refuseront de ployer sous cette caricature de scrutin qui consiste à se déplacer un dimanche à 44 millions afin d’élire un totem, un roi (ou une reine) « républicain » investi de tous les pouvoirs, au détriment du Parlement, des partis, des sensibilités politiques existant dans le pays.
C’est une véritable honte pour l’esprit humain rationnel, civilisé et démocrate. Un jour, je l’espère, il y a aura une prise de conscience de cette bizarrerie, de cette anomalie archaïque, ridicule, et l’on en reviendra à l’élection d’une grande Assemblée parlementaire à la proportionnelle qui détiendra vraiment le pouvoir.
Mais en attendant, c’est ainsi, à Liévin, dans les coulisses, il n’est question que de cela.
Qui ?
Qui sinon Jacques Delors ?
Henri Emmanuelli réussit à rassembler 92 % des voix du parti, mais au prix d’un grand écart ! C’est donc lui-même, dans son allocution finale, qui « demande à Jacques de faire son devoir » ! Une curieuse demande publique, envers un homme qui n’appartient pas au PS et qui n’est pas au congrès ! Voilà donc la gauche « emmanuelliste » qui appelle la « droite socialiste » à gouverner au plus haut niveau ! Quel paradoxe ! Quel contresens ! Quelle curiosité ! D’autant que la demande va rester des semaines sans réponse et laisser prospérer toutes les suppositions.
Delors champion des sondages se fait « prier ».
Jean-Luc Mélenchon me séduit beaucoup avec son grand discours, très culotté, quand tout en développant les arguments de la Gauche socialiste, il s’écrie à propos de l’éventuelle candidature Delors :
« J’ai comme beaucoup d’entre vous avalé quelquefois des couleuvres. Mais c’est bien la première fois que la couleuvre m’annonce que c’est elle qui va m’avaler. »
Ovationné par une salle de 3 000 congressistes et invités, c’est du meilleur effet :
« Ce congrès hypothéquerait l’avenir s’il consentait à faire comme s’il n’avait pas compris ce qui lui a été signifié par le livre et l’entretien télévisé du candidat qu’il appelle de ses vœux. […] Maudites écuries présidentielles, et en plus on n’a pas de cheval ! Je pensais qu’en nous battant pour un candidat commun de toutes les forces de gauche nous aurions semé un grain fécond ? Les sondages en ont décidé autrement, et depuis jouez hautbois, résonnez musettes, les grands concerts des appels, le vacarme des processions couvrent tout ce qui voudrait être autre chose que don de soi ou chèque en blanc. On m’a même demandé de ne pas faire de bruit pour ne pas effaroucher. C’est un comble ! S’agit-il d’attraper un lapin par les oreilles ou bien est-ce un président pour la quatrième puissance mondiale que nous cherchons ? »
Éclatant discours qui nous rend tous dynamiques. À ce moment-là, comme nous, Jean-Luc était pour « un candidat commun de toutes les forces de gauche ». Nous pousserons Henri Emmanuelli à être candidat mais il refusera.
Mélenchon m’avait dit avant le congrès :
- « Tu te présentes, tu dis un mot à tout le monde. »
J’apprécie le conseil et fais dans le systématique. Dès que je vois une figure connue, je tends la main et j’ajoute : « Gérard Filoche. » Généralement, je vois une légère surprise dans les yeux et un petit air de défi au coin des lèvres, mais plutôt de la curiosité, pas de rejet.
J’attends qu’il y ait la presse et je me précipite vers Pierre Mauroy, qui me tend une main largement ouverte. Je la serre en lâchant :
- « Gérard Filoche. »
Il veut la retirer, une ombre rapide tombe sur son visage. Cet homme a décrit, dans Héritiers de l’avenir (Ed. Stock 1977), ses rudes batailles avec les trotskistes après la Seconde Guerre mondiale, ses démêlés vigoureux avec les uns et les autres à Montrouge.
- « Alors, Pierre, qu’est-ce qu’il y a, il y a un problème avec la IVe Internationale ? Mais voyons, j’adhère au Parti socialiste, et je sais bien que c’est la IIe Internationale, c’est donc de la IIe Internationale que je suis adhérent. »
Je lui tiens la main, il fait un grand geste pour se dégager, bras levés, ouverts.
- « Ah, mais si c’est la IIe Internationale, alors il n’y a pas de problème, il n’y a pas de problème. »
- « Alors je suis le bienvenu ? »
« Tu es le bienvenu, pas de problème. »
J’ai fait mon travail.
Le dernier matin, avant le discours de clôture d’Henri Emmanuelli, je m’installe un peu en avance au cinquième ou sixième rang, et le hasard fait que s’assied à côté de moi Martine Aubry, qui ne me reconnaît pas au premier abord. C’est Éric Ghebali qui, en passant, amusé de cette proximité, nous présente. Elle ne cesse ensuite de rouspéter, comme elle fait toujours, pendant tout le discours du premier secrétaire, me prenant à partie en permanence, avec vivacité, emportement, rage parfois.
Henri Emmanuelli explique devant l’immense salle pleine, qu’il faut une « clarification politique »…
« Ce coup de barre à gauche dont je revendique la nécessité peut choquer, mais ce n’est pas une figure de style. La disjonction croissante entre l’économique et le social est aujourd’hui la nouvelle fracture qui sécrète toutes les autres. L’homme, le social n’occupent ??? plus la première place dans l’ordre des priorités. Le coup de barre à gauche, il doit être d’abord dans nos têtes, dans notre volonté clairement exprimée de ne pas nous soumettre à la culture dominante. »
Emmanuelli poursuit de façon lumineuse :
« Quelques exemples : nous avons adopté un certain nombre de propositions importantes sur la nécessité de prendre des initiatives en faveur de la croissance, […] sur la nécessité de réduire le temps de travail à 35 heures sans perte de salaire, dont je voudrais redire qu’elle ne constitue pas à nos yeux une recette miracle contre le chômage, mais une modalité indispensable de redistribution de la richesse supplémentaire produite grâce aux gains de productivité dont nous aurions du mal à comprendre pourquoi, pour la première fois dans l’histoire, ils iraient en totalité à l’actionnaire sans que rien aille au salarié. […]
« Il faut mettre fin au consensus entre sociaux-démocrates et démocrates-chrétiens qui sert de mode de gestion à l’Europe depuis plus de trente ans. Je veux dire par là que nous ne pouvons pas continuer à être crédibles lorsque nous disons que nous voulons une “Europe sociale” et que nous retombons dans ce compromis dont il est évident aujourd’hui qu’il ne débouche que sur la victoire sans partage du libéralisme économique… »
Je suis dans la salle et je bois du petit lait. Nous commençons notre action dans le PS : le congrès a repris les 35 heures hebdomadaires sans perte de salaire. Notre pétition vient de faire soudain un grand bond en avant.
Martine Aubry, à côté de moi, bout d’impatience et ne cesse de me prendre à témoin, tantôt en colère, tantôt ironiquement, de ses désaccords croissants avec l’orateur, alors que, pourtant, il appelle solennellement à la candidature de son père, Jacques Delors, à la prochaine présidentielle.
Avaler des couleuvres ou se faire avaler par une couleuvre ?
« Ni impasse ni grand écart, personne ne va instrumentaliser un homme ni contraindre le parti à se soumettre. Il faut que les institutions évoluent […] vers une fonction présidentielle plus arbitrale, plus conforme aux nécessités de la démocratie, garante des institutions et de la sécurité […] partisane de la solidarité et de la protection sociale […] une plate-forme présidentielle avec des orientations générales, pas un programme de gouvernement […] les militants socialistes choisiront le candidat, avec, nous l’espérons, d’autres formations de gauche… »
Mais la fille du candidat pressenti semble percevoir l’appel d’Emmanuelli plutôt comme une manipulation que comme une invitation sincère. Elle n’a pas l’air d’apprécier le fond du discours :
- « J’espère que tu vas aider Henri Emmanuelli à se structurer idéologiquement », me dit-elle, comme si j’étais un théoricien arrivant à pic pour insuffler de la culture et de la politique à un Premier secrétaire décidément inculte.
Je me garde d’approuver.
Il surgit un curieux moment où l’orateur, après avoir été très massivement et longuement applaudi, essaye de renouveler trop rapidement l’exploit à propos des « 35 heures sans perte de salaire ». Péroraison ratée. Deux rangs devant moi, Mélenchon et Dray tentent de relancer l’ovation. Raté. Quelques claques, mais c’est le bide. Je ne bouge pas.
Martine persifle avec pas mal de rage :
- « Tu n’aides pas tes camarades à ne pas être minoritaires sur ce coup-là ? »
Confirmation : Martine Aubry n’est décidément pas partisane des 35 heures
Cela ne l’empêche pas, à la fin, de m’inviter à venir la voir à sa fondation appelée « Face » rue du Cherche-Midi à Paris. Ce que je ferai consciencieusement : elle ratera trois rendez-vous, alors qu’elle les avait demandés, puis me proposera de travailler dans son think tank sur le droit du travail, avec des personnalités aussi diverses que Gilles Bélier ou Tiennot Grumbach. J’accepte, « à la condition qu’on puisse s’y engueuler sur le fond ». Mais les interlocuteurs que j’y ai rencontrés s’étonnèrent de m’y voir, et encore plus de mes propos et analyses : ils tenaient tous un discours épouvantablement droitier et percevaient mal pourquoi Marine Aubry m’avait adjoint à eux.
À Liévin, nous sortons satisfaits d’avoir vu une Gauche socialiste forte et présente. La photo de groupe sur la grande tribune, faite alors que le congrès se dispersait, regroupe soixante-quinze militants venus de toute la France : ils vont jouer un rôle dans les deux décennies à venir. Je vais peu à peu m’habituer à leurs visages, réunion après réunion.
Moins de dix d’entre eux proviennent de la LCR, nous sommes donc dans un cercle très large, ce qui nous change agréablement la vie. Nous avons un champ immense à explorer.
En attendant le candidat président…
Au sortir de ce congrès, je commence une tournée de réunions dans le Parti socialiste : je me rends dans une quarantaine de départements.
Du Havre à Saint-Malo, de Fréjus (Alain Fortuit) à Bordeaux, de Pau (Jean-Yves Lalanne et Pierre Ruscassie) à Caen (Marie Do et Bernard Frigout) de Nantes (Eric Thouzeau, Catherine Touchefeu) à Amiens (Jean-Jacques Chavigné), de Strasbourg (Philippe Lewandowski) à Lyon, de Chalons–sur-Marne (Gérard Berthiot, Gérard Sigal) à Marseille, (Jean-Paul Nail), à Toulouse (Pierre Timsit, Claude Touchefeu), à Rouen (Jean-Claude Branchereau), à Nancy (Stéphane Nicot), à Tours, à Clermont (René Defroment, Bernard Grangeon), au Mans avec Guy Beauné, sans oublier les multiples visites dans la Haute-Loire, invité par le nouveau dirigeant de la section du Puy, Raymond Vacheron. Pourquoi changement de police ???
J’y défends systématiquement les 35 heures hebdomadaires sans perte de salaire et toutes les réponses nécessaires contre le chômage de masse. Ce combat va durer deux ans pour en convaincre le gouvernement et puis encore cinq ans ensuite lorsque Lionel Jospin aura repris le mot d’ordre et qu’il s’agira de le mettre en pratique ! Et encore vingt ans pour le défendre après !
Extraordinaire parti ! Il reflète en effet toutes les positions en présence dans le salariat français. Certes, la moyenne d’âge est élevée, mais les militants ont leur mot à dire et n’hésitent pas à le faire. Un visage nouveau dans le parti est apprécié comme un soulagement : celui-là saura-t-il changer les choses ? Pourra-t-il peser pour qu’on s’occupe davantage de nous autres, salariés ? Que n’ai-je entendu, dans leurs bouches, comme bilan des années 1980 ? Souvent, les propos sont très sévères, les constats plus lucides et plus durs que ce que la LCR n’osait dire de l’extérieur.
Mais justement, dans ce contexte, quelle erreur d’être « à l’extérieur » ! Ne doit-on pas se confronter, se coltiner à ces dizaines de milliers de militants qui ont subi toutes les déceptions, mais qui s’accrochent encore et qui demandent apparemment un changement radical ?
Je suis souvent très applaudi dans les réunions qu’on m’invite à animer, mais Mélenchon me met en garde contre toute illusion :
« Tu sais, comme ça, au premier abord, tout le monde, il te trouve tout beau et tout gentil, on vient te dire en douce que tu as raison, mais quand il s’agit de voter, cela ne fait pas des voix. » J’entends.
Je ne suis pas naïf à ce point, je sais qu’il y a le débat d’idées d’une part et le clientélisme d’autre part. Je sais que l’appareil nous « digère ». Mais notre ambition fondamentale c’est que nous pensons pouvoir gagner grâce aux militants et si, dans le mouvement social, ça pousse ! J’insiste à ce sujet : jamais nous n’avons eu la moindre illusion sur la possibilité de faire bouger les choses en interne sans qu’il n’existe en externe une vigoureuse poussée du mouvement social.
Notre action politique est devenue d’une tout autre importance que nos éternels débats de bulletins intérieurs avec les centaines de militants, certes valeureux mais isolés, de la LCR.
Dans le PS, il y a obligation de tenir un langage cru, beaucoup plus sérieux, argumenté, sur les droits, les exigences des salariés et des chômeurs, sur la bonne façon économique de redistribuer les richesses, de ne pas se laisser commander par la « pensée unique » et le libéralisme, et de faire reculer le chômage de masse. Il ne faut pas un jargon sectaire, ni abstrait ni académique, on parle à des braves gens « normaux » et aussi d’un niveau culturel élevé pas seulement à des notables ou des arrivistes. Si on s’y prend bien, si on est concrets, courtois, avec des analyses et des propositions précises, on est non seulement écoutés, mais aussi très bien entendus. Il y a de la disponibilité, de l’attente mais aussi du réalisme. Quant à nos théories, issues de tout notre passé militant trotskiste, nous les conservons, apprenons à les traduire pédagogiquement, et notre revue D&S, chaque mois sert de fil à plomb, de référence théorique et pratique.
Henri Emmanuelli tient un langage ferme, même s’il lui est difficile de concilier les tensions contradictoires existant dans le parti. Cela donne une saine tonalité : il défend une politique bien différente de celle des années 1980, du bilan du dernier gouvernement de Pierre Bérégovoy.
Un jour, au cours d’un meeting un peu difficile avec des étudiants à Nanterre, je suis à la tribune avec Harlem Désir et Jean Glavany, j’utilise des mots fermes mais mesurés pour tourner la page des années 1980 et défendre un « vrai » changement pour le futur. Quelle n’est pas ma surprise d’entendre Jean Glavany, encore plus nettement que moi, dénoncer l’« échec économique et social de la précédente gestion du Parti socialiste » ! Je le prends au premier degré. Cela me rend plus fort pour répondre aux gauchistes qui, sans avoir perçu la moindre nuance, veulent nous chahuter du fond de l’amphithéâtre : ces derniers m’apparaissent alors comme déconnectés et impuissants. Je n’ai aucun regret de m’être éloigné de ces cercles agités et vains.
Notre revue D&S observe, fin 1994, que les mouvements grévistes sont déjà nombreux dans le pays.
La Samaritaine, Méridien, Ports et Docks, Ciments Lafarge, Crédit Lyonnais, Michelin, Case-Poclain, McDonald’s, Moulinex, Uniroyal, Lee Cooper, Dim, Fnac, arsenal de Toulon, Jeumont-Schneider, infirmières, Renault : moins de deux ans après son accession au pouvoir, le gouvernement Balladur prend l’eau. La hausse du nombre de jours de grève se confirme de 1993 à 1995. Le gouvernement est miné par la division, puisque Balladur s’apprête à trahir Chirac et à être candidat contre lui. Mais toute sa politique libérale est ressentie comme une agression, aussi bien dans le privé (les effets de la loi quinquennale) que dans le public (les privatisations continues). Chirac le comprendra à sa façon qui fera une efficace campagne « contre la fracture sociale ».
La gauche n’est pas « pour vingt ans dans l’opposition »
Si elle a perdu en 1993, c’est la politique de ses dirigeants – Michel Rocard, Edith Cresson, Pierre Bérégovoy – qui a été cause de sa désaffection. Il suffit qu’elle redevienne elle-même pour que le succès soit au rendez-vous plus vite que prévu.
Mais Jacques Delors vient de publier un livre pire que le livre blanc de Michel Rocard et celui de la Communauté européenne réunis.
Intitulé pompeusement « L’Unité d’un homme », il commence par une défense de la Ve République… contre Pierre Mendès France ! Delors s’y félicite 15 ans après de la pire des mesures qu’il avait prises, particulièrement de la suppression de l’indexation automatique des salaires sur les prix (1983) !
Le reste est un florilège : il « cogne » Jospin, « La grande erreur a été d’appeler cette période de rigueur une “parenthèse” » (p. 167). Il se dresse lui aussi contre les 35 heures : « Je dérange tout le monde. Ceux qui veulent faire rêver les gens avec la diminution du temps de travail débouchant sur la création de nouveaux emplois, et certains disent même : sans diminution de salaire ! » (p. 61). « Mon slogan, ce n’est pas les 35 heures, mais les 40 000 heures » (p. 294). (Ce qui signifie temps partiel à bas salaire sur toute la vie !) « Nous devons amener des gens de 65 ans à continuer de travailler, alors qu’actuellement la retraite est à 60 ans » (p. 119) (Il préfigure largement Fillon, Sarkozy, Macron !). Il veut « en finir avec le financement de la Sécurité sociale appuyé sur les salaires et remplacer les cotisations par l’impôt » (p. 85). Il propose la « privatisation des télécommunications » (p. 108). (Le futur gâchis d’Orange, puis de Free Bouygues est inscrit là). Il donne à Bill Clinton un brevet de « social-démocrate » (p. 252) et prend toute l’histoire de la gauche à rebrousse-poil : « Le progrès a été considéré dans la foulée de la période des Lumières comme lié à la rationalité et au progrès scientifique. C’est une vision que je ne partage pas car je crois que tout est dans le cœur de l’homme » (p. 216).
« Dans le cœur » plutôt que dans la raison, nous voilà plongés en pleine régression obscurantiste.
« Jacques Delors est l’homme qui a évité la mise en œuvre du programme économique catastrophique de François Mitterrand » rajoute Michel Rocard pour le soutenir. Là aussi problème de police ???
Des millions de gens salariés sentent la chose de façon exactement opposée : leur meilleur souvenir, c’est ce que la gauche a fait en 1981-1982. Le « tournant vers la rigueur » de 1983, le monétarisme, la soumission au libéralisme de Delors-Rocard, c’est ce « programme économique catastrophique » qui a conduit la gauche à la défaite.
Si on comprend bien ce moment-là de l’histoire, on comprend les 20 années qui suivent jusqu’à Hollande.
Il aurait fallu, selon nous, selon D&S, remplacer la « main invisible du marché » par « les mains visibles de la démocratie ». Mais ça, rocardiens, deloristes, principaux dirigeants cédétistes, ce n’est pas leur tasse de thé : technocratie, pas démocratie, telle est leur culture. Ils « pensent » les besoins du peuple mieux que le peuple. Selon eux, si on le laissait faire, le peuple gaspillerait tout ce qu’il produit, par conséquent il faut imposer une part qui revient au Capital bien supérieure à celle qui revient au Travail. La redistribution des richesses ne peut se faire qu’au compte-gouttes, un tiers aux salariés, un tiers aux machines, un tiers au capital. (Sarkozy au pouvoir, un court moment, évoquera ce type de « partage »). La priorité est au Capital, pas aux salariés : ce qui s’appelle, à tort ou à raison, et depuis si longtemps, « compromis social-démocrate » est, avec eux, en voie de péremption et le « social-libéralisme » nouveau s’avance. Si libéral et si peu social.
Voilà de quoi alimenter le débat dans les colonnes de D&S : « Pas de candidat surnaturel ! » écrivons-nous, perfidement en « refusant de recevoir le candidat comme une hostie, bouche ouverte ».
Notre camarade Gérard Berthiot, dans L’Union de Châlons-sur-Marne du 22 décembre 1994, explique à son tour :
« Nous n’étions pas pour un candidat surnaturel. On veut gagner à gauche, pas au centre. On est pour un candidat commun de la gauche. »
Tout est déjà là.
Ce n’est pas une utopie
D&S sonne l’alerte :
« Le PCF a-t-il intérêt à compter 5 % des voix sur le nom de Robert Hue ? Dominique Voynet tient-elle absolument à avoir moins de voix qu’Arlette Laguiller ? Waechter et Brice Lalonde se donneront-ils le ridicule de concourir ? Bernard Tapie, plongé dans les méandres de ses affaires, ne gardera pas les voix enlevées à Michel Rocard dès lors que le PS se trouve dans une alliance dynamique et réclame les 35 heures sans perte de salaire. Le Mouvement des citoyens ne vient-il pas lui aussi d’annoncer sa participation aux “Assises de la transformation sociale” au profit de l’idée d’un candidat commun de toute la gauche ? »
Reconsidéré douze ans plus tard, en 2006, au moment de la désignation de Ségolène Royal, cet épisode « delorien » de 1995 en dit long : même candidature surgie hors du champ, même ton « surnaturel », même emballement organisé des sondages, même refus de débat de fond sur la recherche d’une candidature unie de toute la gauche, même engagement vers le centre, même façon d’asséner qu’il n’y a pas d’autre choix.
L’impossible candidature de Jacques Delors est surnaturellement restée au-dessus des têtes pendant vingt ans.
Mais tous ceux qui voulaient suivre cette voie en 1994, ont été contraints de se résigner – avec l’aide de Delors lui-même.