La dette publique grecque
Au début de l’été, le gouvernement grec demandait qu’un nouveau crédit de l’UE et du FMI lui soit accordé. Ce prêt devait compléter celui de mai 2010 qui atteignait un total de 110 milliards d’euros et devait être remboursé en 2013. Le taux de rendement atteint par les obligations d’Etat grecques (bien au-delà de 15 %) ne lui permettait pas, en effet, d’envisager même à moyen terme, l’émission de nouveaux titres sur les marchés financiers pour rembourser les titres de la dette publique arrivant à échéance. Le FMI, l’Union européenne et le gouvernement de George Papandréou avait pourtant prévu ce retour en 2013.
Après bien des atermoiements, les dirigeants européens décidaient, le 21 juillet, d’un nouveau plan de financement de la Grèce qui devait, avec la participation des banques et des assurances, s’élever à 159 milliards d’euros.
Commençant à comprendre que les taux des prêts et les délais de remboursement exigés étaient impossible à tenir, les oligarques européens avait accepté une nouvelle diminution des taux (de 5,2 % en mai 2010 à 3,2 %) et un nouvel allongement de la durée de remboursement (de 3 ans en mai 2010 à 15 ans, voire 30 ans). Ils continuaient, cependant, à exiger une austérité accrue en contrepartie des prêts accordés. Malgré de puissantes manifestations à l’initiative des syndicats et des « Indignés » grecs, le Parlement grec à majorité socialiste, avait déjà, le 29 juin, approuvé les mesures d’austérité exigées par l’Union européenne.
Les résultats de cette politique apparaissent aujourd’hui en pleine lumière.
Sous le poids des mesures d’austérité la Grèce s’enfonce dans la récession. Son PIB devrait se réduire d’au moins 5 % en 2011, entraînant mécaniquement une baisse des recettes et donc une augmentation du déficit public puis de la dette publique. Le rapport d’une commission d’experts du Parlement grec estimait que la dette publique de la Grèce était « hors contrôle ». La présidente de cette commission a été obligée de démissionner. Il n’était pas possible, en effet, pour le ministre grec des Finances, Evangelos Venizélos « qu’un texte à en-tête du Parlement grec soutienne exactement le contraire de ce que disent le gouvernement et les experts du FMI [1]».
Le déficit public qui, selon les perspectives de l’Union européenne et du FMI, aurait dû se limiter à 16 milliards d’euros pour toute l’année 2011, atteignait déjà 21 milliards d’euros pour le seul premier semestre 2011. La dette publique s’envole vers les 160 % du PIB grec.
La Troïka (BCE, Commission européenne, FMI) exige pourtant, début septembre, l’accélération du programme de privatisation (les multinationales européennes attendent le butin) et 2,5 milliards d’euros d’économies supplémentaires d’ici la fin de l’année. Ce qui signifie de nouvelles baisses des salaires, des pensions et des prestations sociales, une accélération de la récession et un bond en avant du déficit et de la dette. Ces exigences n’ont même pas pour objet le nouveau prêt de 159 milliards d’euros mais le déblocage de la 6ème tranche du prêt de 110 milliards d’euros accordé en 2010. Devant les réticences du gouvernement grec qui craint une explosion sociale à l’annonce de nouvelles mesures d’austérité frappant un peuple complètement exsangue, les experts de la Troïka ont interrompu les négociations et quitté Athènes le 3 septembre.
Le prêt de 159 milliards d’euros, dont la première tranche n’aurait pas pu être débloquée avant le vote des parlements des pays européens concernés, en octobre ou novembre, devient donc de plus en plus hypothétique.
D’autant plus hypothétique que le Parlement finlandais vient de remettre en question les règles du jeu de l’accord du 21 juillet. Sous la pression du parti des « Vrais finlandais » qui avait obtenu plus de 19 % des suffrages aux dernières élections législatives, la Finlande vient, en effet, de signer un accord bilatéral avec la Grèce lui permettant d’être remboursée en priorité, en contrepartie des garanties qu’elle serait amenée à apporter au prêt du FESF. La Finlande ne représente que 1,78 % des garanties apportées au FESF (garanties calculées en fonction de l’apport des différents Etats-membres au capital de la BCE) mais elle bénéficie d’une note A-A-A dont le FESF peut difficilement se passer pour émettre ses obligations et aller se financer sur les marchés financiers. La plupart des autres Etats européens (en particulier l’Allemagne qui apporte 27 % des garanties) n’acceptent pas le procédé. Les Pays-Bas, quant à eux, exigent de la Grèce, des engagements identiques à ceux accordés à la Finlande.
Les dettes publiques espagnoles et italiennes
Le plan arrêté le 21 juillet devait « rassurer » les marchés financiers et éviter la contagion de la dette publique grecque aux autres dettes publiques européennes. Ce n’est pas vraiment ce qui s’est produit. Le taux de rendement des dettes publiques espagnoles et italiennes qui avaient dépassé 6 % avant l’annonce du plan continue d’approcher les 6 % malgré les interventions (limitées) de la BCE. A un tel taux, il n’est quasiment plus possible pour ces deux pays de se refinancer sur les marchés financiers pour rembourser les titres de leurs dettes publiques arrivant à échéance. Si ces taux se maintiennent ou augmentent, il leur faudra, elles aussi, demander un prêt à l’Union européenne, c’est-à-dire au Fonds Européen de Stabilité Financière (FESF).
Pourquoi ? Parce que les opérateurs financiers sont tout sauf rassurés. Ils constatent qu’il faudrait plus de 250 milliards d’euros pour éviter un défaut de paiement de la seule Grèce. Ils comparent le montant de la dette publique espagnole (639 milliards d’euros) et celui de la dette italienne (1843 milliards d’euros) au montant de la dette publique grecque (330 milliards d’euros). Il ne leur est pas difficile d’en tirer la conclusion que les capacités du FESF, même renforcées à 500 milliards d’euros et avec l’apport du FMI (250 milliards d’euros) ne pourraient en aucun cas permettre de faire face à la crise de la dette publique de l’un de ces deux pays, ni bien sûr à une crise conjointe. Ils exigent donc des taux d’intérêts plus importants pour acquérir des titres de la dette espagnole ou de la dette italienne.
La politique qui vise à « rassurer les marchés financiers » mène tout droit à l’impasse. Qu’il s’agisse des plans d’austérité, de la « règle d’or », de la nouvelle gouvernance européenne, ou même des euro-obligations. A chaque fois, les opérateurs financiers finissent par percevoir les effets limités, contradictoires des mesures prises ou proposées et loin de se « rassurer » exigent toujours plus : à la fois des taux élevés et la garantie que leurs créances seront honorées jusqu’au dernier centime d’euro.
La Banque Centrale Européenne qui dispose, en théorie, d’une puissance de feu illimitée (elle peut créer de la monnaie ex nihilo) à la différence du FESF et de ses 250 puis 500 milliards d’euros, pourrait casser les reins des spéculateurs. Mais elle n’agit qu’à contrecœur et n’attend que le moment où elle pourrait laisser, comme le prévoit l’accord du 21 juillet, le FESF racheter les titres des dettes publiques espagnoles et italiennes sur le marché secondaire, le marché boursier. Or, ce n’est qu’en octobre ou novembre, après la ratification éventuelle de cet accord par les parlements des différents Etats de la zone euro, que le FESF pourrait commencer les rachats.
C’est proprement ahurissant car si la BCE n’étouffe pas la spéculation sur les dettes publiques espagnoles et italiennes dans l’œuf, elle prend le risque que rien ne puisse, ensuite, arrêter cette crise et son extension d’abord la dette française puis à la dette belge et, au final, à toutes les dettes publiques européennes.
Avec une telle politique, la BCE qui se veut la gardienne de l’euro prend le risque de faire éclater la zone euro et donc l’euro. Mais que faire d’autre qu’obéir quand des voix célestes vous ordonnent d’aller faire couronner le dauphin à Reims ?
Les traités européens exigent, en effet, de la BCE qu’elle ait un bon bilan et donc, qu’elle ne rachète pas les titres des dettes publiques mal notés par les agences de notation. La BCE avait fait une exception pour les titres grecs, irlandais et portugais mais cela relève du cauchemar pour ses dirigeants que d’élargir cette exception à des dettes publiques aussi considérables que celle de l’Italie et de l’Espagne.
La Bourse
Le 18 août, les bourses européennes connaissaient un véritable « jeudi noir ». Le CAC 40 perdait 5,48 %, le Dax de Francfort 5,82 %, le FTSE MIB de la bourse de Milan 6,15 %…
Au total, la CAC 40 aura baissé de 10 % en août, de 20 % en trois mois.
Le 2 septembre, après une accalmie qui avait permis, par exemple, au CAC 40 de rebondir de près de 5,80 % en un peu plus d’une semaine, les cours boursiers repartaient à la baisse : une chute de 3,59 % pour le CAC40, de 3,36 % pour Francfort ou de 3,89 % pour Milan.
Le 5 septembre, la Bourse de Paris termine en dessous de 3000 points après une chute de 4,73 %. La journée a été catastrophique sur toutes les places européennes : Allemagne, où, à Francfort, l’indice DAX dégringole de 5,28 % pour terminer à son niveau le plus bas depuis deux ans. La baisse est générale : Londres (- 3,58 %) ; Milan (- 4,83 %) ; Madrid (- 4,69 %) et Zurich (- 4,04 %) (Le Monde.fr). Ce sont les valeurs bancaires qui sont le plus fortement malmenées : la Société générale perd 8,64 % à Paris. La Deutsche Bank perd plus de 8 %, son PDG estimant que « les perspectives pour les banques européennes en général ne sont pas vraiment roses sur leurs marchés nationaux ».
Les opérateurs financiers, les spéculateurs, sont, en effet, coincés à leur propre piège.
D’un côté, ils craignent que les dettes publiques ne puissent être remboursées et exigent des plans d’austérité de plus en plus drastiques pour réduire dettes et déficits publics.
De l’autre, ils constatent, comme aujourd’hui, en Grèce que ces plans d’austérité conduisent à la récession et donc à l’impossibilité de rembourser les dettes.
C’est ce qui explique le jeu de yo-yo auquel se livrent les indices boursiers, au gré des annonces de plan d’austérité, de crainte de récession, de la perte du A-A-A des Etats-Unis, des chiffres de l’emploi… On appelle cela la « volatilité » des marchés. Et c’est à cette « volatilité » qu’est confié l’avenir de nos économies et de nos sociétés.
Les banques
Les actions du secteur bancaire français, particulièrement exposés au risque des dettes et des économies grecques, espagnoles et italienne, auront, quant à elles perdu près de 40 % de leur valeur boursière en trois mois. Les actions des grandes banques italiennes (UniCredit) ou espagnoles (Santander, BBVA…) dont l’exposition aux dettes publiques de leur propre pays est colossale, subissent le même sort. Ne parlons même pas des actions des banques grecques…
Les opérateurs financiers ont parfaitement compris que les plans d’aide du FMI et du FESF n’étaient pas des plans d’aide à l’Irlande, à la Grèce ou au Portugal mais des plans d’aide aux banques et aux assurances allemandes, françaises, britanniques… très exposées aux risques des dettes publiques de ces pays comme à ceux des dettes publiques (et privées) de l’Espagne et de l’Italie.
Ils ont encouragé les plans d’austérité qui étaient la contrepartie de ces « aides » mais, aujourd’hui, ils doutent de la réussite de ces plans en voyant la récession qui se généralise. Chaque opérateur essaie alors de tirer son épingle du jeu et vend les titres dont il prévoit la dépréciation. Et en les vendant, il entraîne la baisse de la valeur boursière de ces titres. La spéculation la plus agressive, celle des « Hedge funds », s’en mêle, bien évidemment, car il y a gros à gagner en cas de crise aigüe des dettes publiques européennes. Ce n’est, d’ailleurs, qu’en interdisant temporairement, depuis le 18 août, la vente à découvert des actions bancaires que les autorités financières ont pu (jusqu’à maintenant) limiter la spéculation et l’effondrement des valeurs bancaires.
À cette situation s’ajoutent trois autres mauvaises nouvelles pour les banques et ceux qui en détiennent les actions.
Première mauvaise nouvelle : la banque franco-belge-luxembourgeoise Dexia annonce 4 milliards d’euros de pertes pour le 2ème trimestre 2011.
La banque avait déjà dû être recapitalisée à hauteur de 6,4 milliards d’euros en 2008, essentiellement par l’Etat et les régions belges (3 milliards), l’Etat français (1 milliard) et la Caisse des dépôts et consignations (2 milliards).
Deuxième mauvaise nouvelle : la déclaration du président du directoire de la Deutsche Bank, Josef Ackermann, le 4 septembre.
Selon lui, certaines banques européennes ne survivraient pas si elles devaient réévaluer la dette souveraine de leurs comptes au prix du marché. Cette déclaration peut être interprétée de deux façons.
Soit comme le désaveu de la mise à contribution (pourtant limitée) des banques par l’accord du 21 juillet. Soit par une remise à leur juste place des tests de résistance (stress tests) réussis, en juillet, par 83 banques européennes sur 91. Ces tests, en effet, ne prenaient que marginalement en compte les risques de détérioration des titres des dettes publiques comptabilisés dans les actifs bancaires.
Dans les deux cas, elle ne peut qu’inquiéter les « marchés financiers » puisque l’accord du 21 juillet et les stress tests avaient pour principal objectif de les « rassurer ».
Troisième mauvaise nouvelle : le marché interbancaire se tarit.
Le marché interbancaire, ce sont les prêts que les banques se font les unes aux autres, parfois pour quelques jours seulement. Lorsque ce marché se tarit, cela signifie que les banques ne se font plus confiance entre elles. Aujourd’hui, elles soupçonnent les autres banques d’avoir en portefeuille des titres des dettes publiques qui seront peut-être bientôt irrécouvrables. Elles préfèrent donc placer leurs liquidités auprès de la BCE et percevoir un intérêt de 0,5 % plutôt que le double ou le triple sur le marché interbancaire.
Ce tarissement du marché interbancaire est le signe du passage d’une crise de solvabilité des banques à une crise de liquidités beaucoup plus dangereuse car elle risque de se traduire par une perte de confiance, extrêmement contagieuse, des déposants. Dans le premier cas la question est de savoir si les banques auront suffisamment de capitaux propres pour faire face aux pertes qu’elles subiront. Dans le second cas, il s’agit de savoir si les banques pourront faire face à toutes les demandes de retraits de fonds de leurs déposants.
La crise
L’Union européenne ne représente qu’un des trois secteurs où se développent crise bancaire, crise financière, crise monétaire et crise économique. Les deux autres secteurs sont la Chine où la crise est plus rampante mais où les provinces « entassent des paquets de mauvaises dettes[2] » et les Etats-Unis. Les crises des uns se répercutent sur celles des autres.
La crise des dettes publiques européennes n’est, qui plus est, qu’un moment de la crise structurelle que subit actuellement le capitalisme.
La forme de plus en plus violente que prend cette crise n’était pourtant pas inéluctable. Ses rythmes auraient pu être différents et éviter la dangereuse synchronisation de la crise de la dette publique européenne et de celle de la dette publique états-unienne.
Les « fous du Tea party »[3] ont fait tout leur possible pour permettre cette synchronisation. Les idéologues de l’euro avaient, de leur côté, fait toute leur part de chemin.
Le PIB de la Grèce représente, en effet, moins de 3 % du PIB de la zone euro. Ce n’était donc pas, en 2008, alors que la dette publique grecque s’élevait à 120 % de son PIB un problème insurmontable pour cette zone.
Les oligarques européens et le FMI ont réussi à en faire un problème insurmontable. Au lieu d’aider la Grèce sans contrepartie, ils ont décidé de faire un exemple à l’usage de tous les autres pays européens qui seraient tentés de laisser filer leur dette publique.
Ils ont donc assorti leurs prêts à la Grèce de conditions draconiennes, de plans d’austérité qui ont produit une baisse sévère des salaires et des pensions et amené une hausse considérable du chômage. Cette baisse de la consommation intérieure grecque, au moment où la généralisation des plans d’austérité à tous les pays de la zone euro freine les exportations grecques, entraîne une récession qui augmente, du même coup, le déficit et la dette publique.
Les dents serrées, les oligarques européens ne cessent pas pour autant d’imposer toujours plus d’austérité. Tout comme l’avaient fait Pierre Laval en France ou Henrich Brüning en Allemagne, au début des années 1930, avec le succès que l’on sait.
Ils persévèrent alors que alors que Christine Lagarde, elle-même, devenue Directrice générale du FMI les met en garde et affirme qu’il faudrait peut-être mettre la pédale douce sur les plans d’austérité pour éviter de casser la reprise économique. Une forme de désaveu de la « règle d’or » de Sarkozy qu’elle défendait pourtant becs et ongles lorsqu’elle était ministre de l’Economie et des finances de ce même Sarkozy.
Les dirigeants européens ne veulent toujours pas comprendre que la Grèce n’a pas seulement des problèmes de trésorerie momentanée mais qu’elle est insolvable et qu’elle ne pourra pas rembourser sa dette.
Le plus raisonnable, même du point du vue de ces oligarques et des banques européennes, serait donc de restructurer en profondeur la dette publique grecque pour permettre à l’économie grecque de repartir. Mais, prisonniers de leurs dogmes néolibéraux et de leur vision d’une Europe de père-fouettard, les dirigeants européens n’en feront rien sans une mobilisation à la hauteur des enjeux aussi bien du peuple grec que des peuples européens qui subiront de plus en plus l’effet de leurs plans d’austérité, aussi stupides qu’inhumains.
Jean-Jacques Chavigné et Gérard Filoche Le 05/09/2011



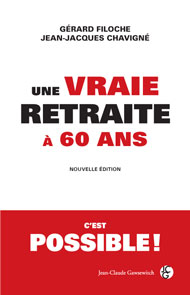






2 Commentaires
Surtout ne pas revenir sur l’origine de cette crise ? C’est pourtant aussi une question de tempo il me semble: 1 la pensée libérale devient soluble avec les manières grecques de faire, qui sont, je le rappelle, de se fiche royalement du bien commun en payant le moins possible d’impôts. 2 la phynance profite un moment de ce dérèglement 3 ça va trop loin et tout le monde prend peur.
Il me parait trop facile d’accuser uniquement les ordures qui manoeuvrent pour leur enrichissement strict depuis des années alors que les grecs, tout comme nous, les avons laissé faire. On peut, cependant, être solidaire de tous ceux qui se sont fait berné et qui vont souffrir. Enfin, il n’y a certes pas lieu de se réjouir de ce désastre mais on peut espérer qu’au moins, si les dogmatiques vont jusqu’au bout de leur entêtement, les sociétés civiles apprendront enfin à reconnaître le vrai visage du libéralisme, et pas seulement comme un problème lointain, et qu’on reprenne un jour le pouvoir. Merci pour vos billets.
la pseudo solidarité avec les grecs nous coûte la sécurité sociale et l’éducation nationale ! trop difficile à comprendre ???
One Trackback
[...] Sous le poids des mesures d’austérité la Grèce s’enfonce dans la récession. Son PIB devrait se réduire d’au moins 5 % en 2011, entraînant mécaniquement une baisse des recettes et donc une augmentation du déficit public puis de la dette publique. Le rapport d’une commission d’experts du Parlement grec estimait que la dette publique de la Grèce était « hors contrôle ». La présidente de cette commission a été obligée de démissionner. Il n’était pas possible, en effet, pour le ministre grec des Finances, Evangelos Venizélos « qu’un texte à en-tête du Parlement grec soutienne exactement le contraire de ce que disent le gouvernement et les experts du FMI [1]». [...]