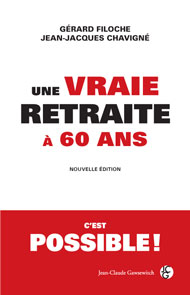Par Jean-Jacques Chavigné
Dans un article paru dans « Contrepoints », un site libéral d’information en ligne, sous-titré « Le nivellement par le haut », Antoine Levy se propose de mettre à mal « 6 mythes persistant sur la crise grecque ».
Il proclame avec ferveur sa foi libérale : « Comme en 1968, il importe sans doute, pour éviter les malentendus, de répondre à l’injonction bien connue « d’où parles-tu camarade ? » C’est en libéral que j’écris« .
Son argumentaire contre les « 6 mythes » qu’il déplore n’est guère probant. Il n’est cependant pas inutile de lui répondre. D’abord, parce qu’il est rare de voir un libéral essayer de répliquer de façon assez systématique aux critiques faites à la politique de l’Union européenne. Ensuite, parce que, même de façon éparse, cette argumentation est souvent reprise, avec les mêmes biais, par ceux qui soutiennent cette politique.
« Premier mythe : les Grecs n’ont jamais vu la couleur de l’argent de la dette »
Antoine Lévy emploie là un procédé polémique plutôt éculé : il prétend répondre à une question que personne ne pose et peut, ensuite, se vanter d’avoir terrassé un adversaire qui n’existe pas.
Personne n’affirme (notamment, ni Attac, ni le CADTM, ni D&S…) que « les Grecs » n’ont jamais vu la couleur de l’argent de la dette. Ce qui est affirmé, par contre, c’est que la Grèce n’a pas vu la couleur de l’ « aide » de la Troïka, alors que nos oreilles ont été, pendant des années, rebattues de ce mensonge. A cette affirmation, autrement plus pertinente, Antoine Levy se garde bien de répondre.
L’essentiel des milliards versés par la Troïka est allé au paiement des intérêts et au remboursement des titres de la dette publique grecque arrivés à échéance. Ces titres étaient, avant la restructuration de la dette publique grecque de 2012, détenus, en très grande partie, par les banques européennes (notamment françaises, britanniques et allemandes). Ce sont donc les banques qui percevaient l’essentiel des sommes censées « aider » la Grèce. Afin que cette « aide » ne puisse, par mégarde, alimenter le budget de la Grèce, les sommes versées par le FMI et l’UE étaient, d’ailleurs, transférées sur un compte spécial, à la demande expresse de Nicolas Sarkozy et d’Angela Merkel.
Un défaut de la dette grecque aurait, avant la restructuration de cette dette en mars 2012, entraîné une crise systémique du système bancaire européen et sans doute bien au-delà. Les « plans de sauvetage » de la Grèce n’étaient donc, en réalité, que des plans des sauvetages des banques, au moins des banques européennes.
Antoine Levy, s’interroge sur l’origine de la dette publique grecque. Il ne fait, cependant, preuve d’une certaine pertinence que lorsqu’il constate que le PASOK et Nouvelle Démocratie ont financé leurs clientèles respectives et qu’il souligne l’importance des dépenses de défense de la Grèce
Selon Antoine Levy, les taux d’intérêts demandés par les créanciers privés n’auraient pas été « exorbitants ». Bien au contraire, assure-t-il, puisque les « taux grecs restèrent extrêmement proches des taux allemands au long de ces années d’ivresse budgétaire« . Sa périodisation n’est pas sérieuse. Les taux grecs se sont, certes, rapprochés des taux allemands entre 2000 et 2009 mais il n’en allait pas de même avant 2000.
L’économiste Michel Husson répond à la question « Pourquoi une dette publique de 100 % du PIB avant la crise ? » en mettant en cause (dans un article très documenté sur son site) « les taux d’intérêt extravagant entre 1988 et 2000 et une baisse des recettes publiques entre 2000 et 2009 » Il précise que la baisse des recettes publiques a massivement profité aux oligarques et aux entreprises grecques.
Dans un article du 11 mars 2015[1], Michel Husson approfondit la question de l’origine de la dette publique grecque et identifie quatre mécanismes qui expliquent « la moitié de l’augmentation de la dette publique grecque entre 1992 et 2009 ». Ces mécanismes sont : les sorties illicites de capitaux et le manque à gagner qui en découle pour les recettes fiscales de la Grèce ; les dépenses militaires excessives ; les recettes publiques insuffisantes ; la recapitalisation des banques. Au total, selon ses calculs, à partir de chiffres pourtant très modérés, la dette publique grecque, sans l’action cumulée de ces quatre variables ne se serait élevé, fin 2014, qu’à 97,3 % du PIB grec, au lieu de 175,4 %.
Le pourfendeur de « mythes » reconnaît, au passage, que les marchés financiers s’étaient trompés dans leur anticipation mais il n’en tire pas les conclusions, qu’en bon libéral, il devrait tirer. Il n’émet aucune critique à l’égard de l’UE et du FMI qui n’ont pas laissé les banques payer leurs erreurs d’anticipation. Elles n’ont mis aucun frein à leur spéculation parce qu’elles croyaient que l’UE serait solidaire de la Grèce. Elles étaient persuadées que l’UE ne laisserait pas les taux d’intérêts, auxquels ce pays pouvait se refinancer sur les marchés financiers, atteindre 12 %. Ce taux rendait impossible pour la Grèce de pouvoir se ré-endetter sur les marchés financiers pour rembourser les titres de sa dette qui arrivaient à échéance. C’est pourtant ce que font tous les pays du monde qui, dans les faits, ne remboursent jamais leurs dettes publiques mais se contentent de la « faire rouler ».
Le questionnement d’Antoine Levy sur l’origine de la dette publique grecque se contente, nous venons de le voir, de réponses très superficielles. Il serait donc très avisé de suivre avec attention les travaux de la Commission d’audit de la dette publique grecque que le gouvernement d’Alexis Tsipras a décidé de mettre en place, dès avril prochain.
Dans le même registre, Antoine Levy attribue la fin de la croissance grecque à la découverte de la manipulation des chiffres du déficit public en 2009, destiné à camoufler l’ « ivresse budgétaire » de la Grèce. De façon étonnant, même pour un libéral, il oublie la responsabilité de la crise financière qui a frappé le monde, l’UE et notamment, l’Allemagne, qui connaît en 2009 une récession de 4,9 %, sans que l’on puisse vraiment incriminer sa seule « ivresse budgétaire ».
« Deuxième mythe : les États n’ont fait que reprendre à leur compte la dette privée »
Cela relèverait selon Antoine Levy qui, décidément, ne fait pas dans la dentelle, du « conspirationnisme ». Cela relève, pourtant, tout simplement du fonctionnement du néolibéralisme qui a mis en place un gigantesque mécanisme de privatisation des profits et d’étatisation des dettes. C’est, d’ailleurs, une évidence chiffrée. Aujourd’hui, 223 milliards (chiffres d’Henri Sterdyniack et Anne Seydoux – La Tribune du 27/01/2014) de la dette grecque sont détenus par la BCE, le FESF et les autres Etats-membres européens. Il faut ajouter 32 milliards par le FMI. 80 % de la dette publique grecque est maintenant détenue par des institutions publiques. Les banques, européennes en particulier, se sont donc débarrassées, lors de la restructuration de la dette publique grecque en mars 2012, des titres de cette dette qu’elles détenaient et ce sont des institutions publiques qui ont pris le relais.
Antoine Levy verse des larmes brûlantes sur les pertes subies par les actionnaires des institutions financières, de 60 à 75 % de leur valeur nette, selon lui. En réalité, c’est pour sauver leur propre peau, que les banques et les compagnies d’assurances européennes ont accepté de « perdre » une partie de leurs créances. Un défaut de la Grèce aurait, alors, risqué de provoquer une faillite des banques européennes, tant la dette publique grecque pesait dans leur bilan et tant les banques européennes (françaises notamment) étaient engagées dans le système bancaire grec.
Plutôt que tout perdre, les banques européennes, principales créancières de la dette grecques, ont accepté de perdre un peu. Quelle abnégation ! Elles sont loin, d’ailleurs, d’avoir perdu les 107 milliards annoncés puisque, notamment, 58 milliards d’euros ont permis de recapitaliser les banques grecques. Cette recapitalisation a permis, heureux hasard, au Crédit Agricole et à la Société générale (par exemple) de tirer leur épingle du jeu en cédant leurs filiales grecques à des banques hellènes. Ces 58 milliards d’euros sont, aussitôt, allés grossir la dette publique grecque.
La restructuration de la dette publique grecque, en mars 2012, s’est donc traduit par un nouveau et gigantesque transfert des dettes privées (des banques) vers la dette publiques, celles des Etats européens, des institutions européennes (BCE, MES…), avec l’entière bénédiction de ces Etats et de ces institutions. Les gouvernements européens ont, d’abord, prêté 52,9 milliards d’euros à la Grèce, lors d’opérations bilatérales, avec des fonds qu’ils avaient emprunté sur les marché financiers. Ils ont, ensuite, apporté 140,9 milliards d’euros via le Fonds européens de stabilité financière (aujourd’hui, devenu le Mécanisme européen de stabilité) et garanti ces 140,9 milliards. Enfin, la BCE et les banques centrales nationales de l’UE ont acheté sur le second marché pour 25 milliards d’euros des titres de la dette publique grecque.
Tout ce beau monde n’a pas agi ainsi pour « aider la Grèce » comme le prétend le pourfendeur de « mythes » puisque ces fonds sont, pour l’essentiel, utilisés au remboursement et au paiement des intérêts de cette dette, auprès du FMI, de la BCE, des États de la zone euro… Ce qui, aujourd’hui, pose des problèmes de trésorerie au gouvernement d’Alexis Tsipras, ce sont justement les remboursements que la Grèce doit effectuer auprès du FMI et de la BCE.
Il s’agit d’asphyxier lentement la Grèce, en refusant de restructurer sa dette, pour l’obliger à accepter la politique que lui avait infligée la Troïka et continuer à en faire un exemple, destiné à l’édification de tout État de l’UE qui serait tenté de ne pas honorer « ses engagements », aussi incohérents et contre-productifs soient-ils.
« Troisième mythe : l’austérité concentrée sur la baisse des dépenses au nom du libéralisme »
Antoine Levy rétablit « la vérité » en affirmant que les recettes sont passées en Grèce de 39 % à 47 %, entre 2009 et 2013. Il s’arrête, cependant, en chemin et ne précise surtout pas que cette augmentation des recettes fiscales n’était pas le fruit de l’imposition des armateurs, des entreprises ou de l’Église orthodoxe, toujours aussi épargnés, mais de l’augmentation de 19 % à 23 % de la TVA (une « modernisation » selon lui), et de l’instauration d’une taxe foncière particulièrement injuste puisqu’elle frappait surtout les plus petits patrimoines, dans un pays où beaucoup de ménages sont propriétaires de leur logement.
« Quatrième mythe : Syriza, les premiers à mettre sur la table les sujets difficiles »
Selon Antoine Levy, la fin de la Troïka était programmée, du simple fait des « promesses électorales de Jean-Claude Junker« . Comment comprendre, avec une vision aussi erronée de la réalité, que le bras de fer qui oppose, aujourd’hui, l’UE à la Grèce, a essentiellement pour objet d’obliger la Grèce à rester dans le cadre dicté par la Troïka, avant 2015 ?
Une renégociation de la dette grecque aurait, elle aussi, était prévue. Pourquoi, dans ces conditions, l’Eurogroupe la refuse-t-il au nouveau gouvernement grec ? Parce que ses ministres ne portent pas de cravates ?
Le pourfendeur des « mythes » ne considère pas que la dévastation sociale subie la Grèce soit digne d’un quelconque intérêt. 27 % de la population active au chômage, une mortalité infantile en hausse de 42 % depuis 2009, une baisse du salaire minimum de 22 %, une diminution du même ordre du montant des retraites, 25 % de la population sans aucune couverture sociale, tout cela ne mérite pas une seule ligne de sa part. Ce ne sont, après tout, que des souffrances humaines et un « septième mythe », de cet acabit, aurait été encore plus difficile que les autres à démonter.
« Cinquième mythe : un plan de relance qui sauvera la croissance »
Aucun bilan n’est tiré du cercle vicieux austérité-récession pendant 6 ans, de la diminution de 26 % du PIB de la Grèce…
Le seul argument d’Antoine Levy se résume aux prévisions de croissances de 3 à 4 %, en 2015 et 2016, faites par la Commission européenne. Cette dernière s’était pourtant trompée, avec une rare constance, dans ses prévisions de croissance depuis 2009 : de 4,7 %, par exemple, dans ses prospectives pour l’année 2013 ! Quant à l’investissement, il était, en 2014, toujours inférieur de 67 % à celui de 2009.
Si la croissance était sauvée (Antoine Levy prend ses précautions) ce ne serait de toute façon pas grâce à Syriza, mais bien grâce aux politiques qu’avait imposé la Troïka. Pourquoi, dans ces conditions, les politiques d’austérité et de réformes structurelles ont-elles produit de tels désastres, économiques, financiers et sociaux dans toute l’UE et tout particulièrement en Irlande, en Espagne, au Portugal et en Italie ? Question subsidiaire pour les libéraux et pourtant fondamentale : à qui profite la croissance quand elle pointe prudemment son nez : aux profits ou aux salaires et à l’emploi ?
« Un dernier mythe : enfin un gouvernement démocratique ! »
Antoine Levy emploie, de nouveau, le même procédé polémique que lorsqu’il s’attaquait à son « premier mythe ». Personne, à gauche, n’a jamais prétendu que les gouvernements dirigés par le PASOK ou Nouvelle Démocratie n’étaient pas arrivés au pouvoir démocratiquement. Il se trouve, simplement, que les électeurs grecs ont tiré les leçons des politiques imposées par la Troïka et ont refusé de continuer dans la même voie.
Antoine Levy oppose la démocratie en Grèce à la démocratie dans l’UE qui serait « un accord de volontés souveraines« . Sans doute oublie-t-il les référendums de 2005 en France et aux Pays Bas ? Sans doute oublie-t-il, également, que l’UE avait repoussé, avec horreur, l’idée de Georges Papandréou d’organiser un référendum en 2011 et que le Parlement grec l’avait alors proprement éjecté pour répondre aux exigences de la droite européenne, alignée derrière Angela Merkel ?
Et, même s’il existait une opposition entre deux formes de démocratie, ne faudrait-il pas essayer de trouver un compromis ? C’est ce que propose le gouvernement grec qui se heurte à une extrême réticence des dirigeants de l’UE à prendre en considération la volonté exprimée par le peuple grec. Antoine Levy, toujours aussi peu conséquent, se garde bien de faire la moindre proposition de compromis entre ces deux formes de démocratie qui, selon lui, s’opposerait.
L’auteur des « 6 mythes persistants » affirme que le gouvernement grec actuel est « tenu par la continuité de l’Etat de respecter les choix de ces prédécesseurs ». Peut-être croit-il, sans se soucier le moins du monde du droit international, que les accords passés par ces « prédécesseurs » avec la Troïka auraient la force contraignante d’un traité ? Pourquoi ignore-t-il, délibérément, une autre donnée élémentaire du droit international : un Etat a le droit souverain de restructurer ou d’annuler unilatéralement sa dette publique. Il serait pourtant indispensable que cette donnée essentielle, pour la Grèce mais aussi pour l’Union européenne, particulièrement la Zone euro, soit sérieusement prise en compte.
Antoine Levy oublie, enfin, que les « règles » de l’UE et de la zone euro sont à géométrie variable, selon qu’un pays est « puissant ou misérable », selon qu’il s’incline avec respect ou non, devant les dogmes libéraux. Bien des « règles » ne sont pas respectées par d’autres pays que la Grèce, et non des moindres.
L’Allemagne ne respecte pas le traité européen qui affirme qu’une dette publique ne peut être supérieure à 60 % du PIB. La dette publique de l’Italie dépasse les 100 % de son PIB. La France ne respecte ni la règle des 60 %, ni la « règle d’or » fixée par le TSCG d’un déficit public de 0,5 % du PIB maximum en 2017, puisque c’est maintenant un déficit de 3 % qui est prévu à cette date. La BCE acceptait, en février 2013, que l’Irlande ne lui verse pas le montant de la dette qu’elle aurait dû rembourser à cette date, mais refuse, en 2015, la même facilité à la Grèce, au nom d’une réglementation qui n’a pourtant pas changée. La Commission européenne se permet de dicter sa loi, sans le moindre respect du traité de Lisbonne et de la « Charte des droits sociaux » de l’UE, aussi bien dans la fixation du salaire minimum grec que dans la détermination des règles de négociations salariales… Une paille que tout cela !
Antoine Levy reconnaît, pour terminer, même si c’est pour en tirer des conclusions erronées, que la « légitimité de Syriza s’assortit d’une responsabilité historique ». Il serait difficile de ne pas être d’accord avec cette affirmation.
[1] Site Michel Husson- Note n° 86 – 11 mars 2015.