Le préfet de police de Paris a décidé, mercredi 22 juin, d’interdire la manifestation du 23 juin contre la loi sur le travail. Les blessés lors des défilés précédents donnent le sentiment que la France, qui a fait figure de modèle en matière de maintien de l’ordre, est aujourd’hui débordée dans la gestion des foules. Et que se révèle une situation où le policier prend le pas sur le politique. Entretien avec le sociologue Fabien Jobard.
- Le préfet de police de Paris a finalement décidé, mercredi 22 juin, d’interdire la manifestation de jeudi contre la loi sur le travail. Après une journée de discussions avec les syndicats et d’atermoiements du pouvoir politique, la décision a été annoncée mercredi matin dans un communiqué de la préfecture (il est à lire intégralement ici). «Après examen attentif, ces propositions alternatives (les centrales syndicales ont proposé plusieurs parcours – ndlr) ne permettent en aucune façon de répondre à la nécessaire sécurité des personnes et des biens , ni aux exigences de mobilisation maximale des forces de police et des forces mobiles contre la menace terroriste qui se situe à un niveau élevé imposant des sollicitations exceptionnelles sur le territoire national. Dans ces conditions le Préfet de police considère qu’il n’a pas d’autre choix que d’interdire la tenue de la manifestation», indique le communiqué.
Dans la journée de mardi, le ministre de l’intérieur avait réitéré son appel aux syndicats à renoncer à une manifestation, leur suggérant d’organiser un « rassemblement statique », vu le « niveau de menace extrêmement élevé avec un niveau de sollicitation extrêmement fort depuis plusieurs semaines des forces de l’ordre » mobilisées « sur l’Euro » et « aux frontières dans un contexte migratoire particulier » ainsi que « dans le cadre d’opérations de maintien de l’ordre ».
Après des blessés graves lors des manifestations contre la loi travail ou entre supporteurs lors du premier tour de l’Euro 2016, cette crispation est-elle le signe que la police française, qui a longtemps fait figure de référence en matière de maintien de l’ordre, ne sait plus gérer les protestations politiques et les foules ?
Éléments de réponse avec Fabien Jobard, chercheur au CNRS, Centre Marc-Bloch (Berlin), coauteur avec Jacques de Maillard de Sociologie de la police. Politiques, organisations, réformes (Armand Colin, 2015) et, avec Olivier Fillieule, d’un article publié sur le site La Vie des idées, intitulé « Un splendide isolement. Les politiques de maintien de l’ordre ».
Interdiction d’organiser une manifestation le 23 juin prochain, blessés graves lors des manifestations contre la loi travail, affrontements violents entre hooligans… La police française est-elle dépassée en matière de gestion des foules ?
Ce que l’on peut dire, c’est que l’histoire rattrape la police par le col. Le hooliganisme, dont l’Euro 2016 signe le retour, fut dans les années 1980 la locomotive d’un basculement des polices européennes vers l’action préventive : on identifie, on fiche, on partage les fichiers à l’échelle européenne, on empêche les éléments jugés dangereux de sortir de chez eux, avec des assignations à résidence ou des obligations de pointer au commissariat le plus proche, ou bien on les empêche de quitter le territoire (et pour eux on ré-érige des frontières intra-européennes). Quelques décennies après le Heysel, la violence supporteuriste avait quasiment disparu.
Que disait alors Bernard Cazeneuve en 2015 devant la commission d’enquête parlementaire formée après la mort de Rémi Fraisse ? Entonnant l’argument du saut qualitatif des manifestations en France (« de nouvelles formes de contestation sociale… d’une extrême violence… qui posent des problèmes inédits »), il déclare « étudier la possibilité d’interdire à des manifestants violents multirécidivistes de manifester sur la voie publique ». Ce « à partir de cette expérience encadrée par le droit » qu’est… l’interdiction de stade contre les supporteurs estimés dangereux.
Le préfet de police, à Paris, fait part de ses doutes. Le défenseur des droits est hostile. Le rapporteur de la commission parlementaire (socialiste) adopte la proposition destinée à nourrir une proposition de loi, mais le président (écologiste) la refuse.
Mais en novembre 2015, l’état d’urgence permet à Bernard Cazeneuve d’assigner 24 militants à résidence, peu avant la COP21. En mai 2016, lors des manifestations contre la loi travail, une cinquantaine de personnes se voient interdire de paraître dans différents lieux, ce que le tribunal administratif qualifie nettement d’interdiction de manifester – sans toutefois casser plus de 10 arrêtés. Et en cette veille de manifestation du 23 juin, c’est cette fois l’interdiction de tout un rassemblement qui est envisagée.
Ironie ou ruse de l’histoire : au moment même où la violence des hooligans se manifeste à nouveau, on applique à des contestations sociales, des manifestations politiques, la logique préventive anti-hooligans, en arguant de son efficacité ! Sans compter bien sûr qu’assister à un match de foot n’est pas une liberté fondamentale. Certes, l’élévation de la liberté de manifester au statut de liberté fondamentale fut très tardive en France, puisqu’elle ne date que de 1995, alors qu’elle se trouve depuis 1949 dans la loi fondamentale allemande. Mais domestiquer la protestation politique en interdisant les manifestations ou assignant des contestataires à domicile sur le modèle de la réponse au hooliganisme soulève une difficulté constitutionnelle majeure.
L’État est-il en train de bâtir un parallèle entre la violence à proximité des stades de football et la protestation politique ?
Disons que les violences des hooligans et leur gestion par les polices européennes rappellent très opportunément le paradoxe bien connu des juristes : la répression, c’est la liberté, la prévention, l’oppression. La « prévention », qui relève de ce que l’on appelle la « police administrative », revient à prendre des mesures au préalable, pour empêcher l’événement, avant que tout délit ne soit commis. Dans le cadre d’une manifestation, quel meilleur mécanisme d’empêchement des violences que celui d’interdire aux gens de se rendre sur les lieux ? Alors, il ne s’agira jamais d’interdire « aux gens » bien sûr. Mais regardons de plus près.
Si je reprends les personnes que visait M. Cazeneuve devant la commission parlementaire, il est improbable qu’une telle disposition législative vise seulement les « manifestants violents multirécidivistes ». On trouvera en effet bien peu de personnes au casier national judiciaire maintes fois condamnées pour violences au cours de manifestations. Et celles et ceux visés par les arrêtés du printemps 2016 sont bel et bien des militants contestataires de l’ordre et des pouvoirs établis qui, loin d’être des « manifestants violents multirécidivistes », sont plus prosaïquement… connus des services de renseignement. Documentée par la surveillance policière (ou les récits de soi sur Facebook et autres), la simple participation à des actions contestataires non conventionnelles (occupation d’une agence Pôle emploi, bousculades dans la salle des pas perdus de tribunal, sit-in, die-in, et bien sûr toute dégradation, destruction, violence contre les biens et les personnes) devient motif à interdiction préalable.
Il y a quelques années, je m’étais intéressé au « maintien de l’ordre » dans les régimes autoritaires, en RDA plus précisément. Ce qui était fascinant dans ce pays, des années 1960 à la fin des années 1980, c’est que la « répression » s’exerçait essentiellement par la prévention ; la prévention des troubles, de la déstabilisation, des menées anti-socialistes ou ennemies. Le vocabulaire ne manquait jamais, mais le quotidien de la surveillance était toujours le même : l’écoute, le fichage, l’assignation à domicile, l’éloignement. Le but était que la voie publique ne laisse jamais paraître la moindre banderole, ne laisse jamais entendre la moindre parole contestataire.
Cette histoire est importante. Car nous vivons en France dans une société dans laquelle, sur le long terme, la violence dans les rapports humains décline, et donc l’intolérance à la violence augmente. Dans une société comme la nôtre, voir tous les jours à la télévision le spectacle de violences de toutes natures, des massacres de populations festives aux violences supportéristes ou protestataires, en passant bien sûr par les violences des forces de l’ordre elles-mêmes, est éminemment nocif. Entendre des discours qui toujours évoquent des « violences intolérables », des « violences extrêmes », des « nouvelles formes de violences radicales », et j’en passe ; qui mêlent sans mesure des destructions de biens ou des simples dégradations, toutes couvertes par les assurances (une loi le prévoit explicitement), et des massacres à grande échelle, perturbe le sens commun.
Dans une société où la violence réelle est résiduelle et intolérable, une telle sur-exposition aux images et aux discours de violence favorise l’idée que tout risque de violence, et il faut dire : tout risque de toute violence, doit être étouffé, et qu’il revient à la puissance publique de l’empêcher absolument.
Voilà le danger que portent toutes ces propositions qui sont fondées sur l’idée que, au fond, dès lors qu’il y a risque de violence, il y a déjà rupture du contrat social ; et peu importe que l’on soit hooligan ou manifestant. Plus que les violences elles-mêmes, si diverses, si inégales, leur spectacle permanent fait peser sur la société française le spectre d’une police administrative étendue, assise sur une opinion publique saturée des images et des discours de la violence, à qui l’on ne donne plus que le choix entre des manifestations violentes parce qu’on ne sait plus ou on ne veut plus les maîtriser, et des manifestants interdits de manifester. L’incantation permanente à la « violence extrême » (dans un billet pour Mediapart il y a 2 ans j’évoquais cette « violencextrême » toujours prononcée en un seul mot et d’un seul souffle) s’incarne ensuite dans tous ces projets, désordonnés mais constants, d’extension de la police préventive.
La France semblait être un modèle européen en matière de doctrine et de pratique du maintien de l’ordre. Comment a-t-elle pris du retard ? Pourquoi a-t-elle notamment manqué la politique dite de « désescalade » mise en place dans de nombreux pays européens, l’Allemagne en premier lieu ?
La police française a été innovante en matière de maintien de l’ordre et a géré la contestation de mai-juin 68, puis des années 1970, avec une doctrine neuve et sûre : présence dissuasive et distante, contact permanent avec les organisateurs, évitement puis gradation de la force, unités spécialement dédiées au maintien de l’ordre et très bien entraînées… Puis le modèle s’est figé. Je ne sais pas exactement pourquoi, même si, en 1995 déjà, quand, avec Olivier Fillieule, on conduisait une campagne d’entretiens avec les responsables policiers du maintien de l’ordre, on sentait un certain désarroi, notamment face aux groupes mobiles de « jeunes violents », comme ils disent – comme quoi le problème n’est pas neuf.
Ce qui est certain, c’est que la police française a raté quelques trains, notamment dans l’échange avec les polices européennes. J’ai le sentiment que police et gendarmerie se sont trop longtemps repues d’un prestige international ancien ; parce que des délégations étrangères séjournent au centre d’entraînement de la gendarmerie mobile à Saint-Astier, le monde entier envierait le « modèle français de maintien de l’ordre ».
Pendant ce temps, ce modèle changeait partout ailleurs, avec notamment une révolution autour de la conception de la foule. Au lieu de la considérer comme un élément un et indivisible, l’idée a été de la considérer comme un ensemble de groupes distincts, pour mieux diviser la foule, la fractionner, l’individualiser, non bien sûr sans un certain cynisme, mais aussi avec un meilleur étagement de la force employée.
Vous évoquez l’Allemagne et ses politiques de « Deeskalation ». Il est clair que le contraste avec la France est manifeste, et d’ailleurs la presse internationale, présente à l’occasion de l’Euro 2016, le signale à son tour. Cela dit, les stratégies du maintien de l’ordre sont toujours le produit d’histoires nationales singulières. Il y a quelques décennies, les confrontations avec les polices allemandes étaient vraiment très violentes. Ces polices ont lentement rompu avec les manières de faire des années 1950, où la contestation de rue était vue, en pratique, comme le prolongement de l’agitation communiste de la période 1918-1933. De l’autre côté, pour les militants des années 1970, la République n’était que le cache-sexe d’un État allemand demeuré fasciste, qu’il fallait amener à la confrontation afin qu’il révèle son vrai visage, sa vraie nature. Nés dans les années 1950, ces contestataires voyaient (non sans raison) dans le personnel politique allemand une formidable machine à recycler les anciens cadres nazis, si bien que la violence de rue jouissait d’une légitimation à la fois pratique et idéologique.
Les nouvelles générations qui protestent dans les années 1980, notamment le mouvement écologique et féministe, n’ont plus le même rapport à l’État et à la violence. D’abord parce que tout au long des années 1970, peu ont adhéré à la violence terroriste issue des mouvements de gauche. Ensuite parce que, précisément, l’État a su maîtriser cette violence terroriste sans basculer dans l’état d’exception permanent : la vraie nature de la République fédérale fut en réalité démocratique.
En outre, après la chute du Mur, les militants de gauche affrontent une violence d’un autre genre, qui est la violence d’extrême droite. Dans le courant des années 1990, l’extrême gauche juge sans doute moins nécessaire de se battre contre la police que contre les néonazis. Dans les années 1990 et 2000, et à nouveau aujourd’hui avec l’agitation entretenue autour des réfugiés, les attaques contre les foyers de demandeurs d’asile ou les militants antifascistes se comptent par centaines – et les morts par dizaines. Le rapport de la gauche radicale à l’État et à la police s’en trouve pour le moins changé, ce qui facilite les politiques de désescalade engagées par les divers gouvernements locaux.
En France, l’histoire est différente. La jeunesse de nos banlieues fait l’objet d’une attention continue et brutale. La tentative de créer une police de proximité s’est soldée par un échec en rase campagne. En somme, la droite portée par Nicolas Sarkozy a construit une formidable hégémonie culturelle sur la manière de voir la police en France. Celle-ci est nécessairement virile et chevaleresque, faite de force et de bravoure. C’est une police-forteresse, une police du « dernier rempart », celle qu’on appelle aux États Unis The Thin Blue Line : si la police cède, la société s’écroule.
Cette rhétorique est omniprésente. On s’en rend compte depuis l’intérieur même de l’institution. Les policiers qui consacrent leur temps à faire de la médiation dans des conflits conjugaux ou de voisinage, le policier réserviste de la police nationale qui fait un travail de délégué à la cohésion police-population (DCPP) ou l’officier qui décide d’ouvrir une permanence d’écoute au sein du commissariat ou bien de faire des réunions avec les parents d’élèves dans les collèges… Ils et elles ne peuvent s’inscrire aujourd’hui dans aucun récit. Ils traversent l’institution comme des ombres.
Aucune autre police possible n’est imaginable, aucune autre police n’est possible. Une hégémonie culturelle pure et parfaite, en somme : on ne pense plus l’institution que dans la langue qui a été fabriquée par les politiques à des fins de conquête du pouvoir, et qui est aujourd’hui la seule disponible à tous les locuteurs.
Que peut-on dire de l’armement de la police française et notamment de certaines grenades qui ont causé un mort à Sivens et des blessés graves à Paris ? Est-il comparable à ce qui existe dans les autres pays européens ?
Il ne faut pas fétichiser la question des armes. Une grenade de désencerclement lancée de manière opportune et sur ordre de l’autorité légitime peut être une réponse utile et proportionnée à un danger ou une menace. On entend souvent dire que la police française pourrait davantage utiliser les canons à eau, comme elle l’a fait lors des protestations contre le CPE en 2006, ou lors de la manifestation du 14 juin dernier contre la loi travail. Mais, en Allemagne, où le recours aux canons à eau est plus fréquent, un manifestant a perdu définitivement la vue sous l’action d’un canon à eau. Lors des protestations contre la construction d’une nouvelle gare à Stuttgart, en septembre 2010, la puissance du jet a été telle que ce manifestant a perdu ses deux yeux. Tout dépend donc des conditions d’emploi de telle ou telle arme, qui doit toujours être proportionnelle au danger encouru.
Je me permets toutefois de signaler, au passage, une vraie différence entre l’Allemagne et la France. Les responsables policiers ont été condamnés par la justice et le pouvoir politique, en l’occurrence le ministre-président du Bade-Wurtemberg, a pris ses responsabilités en payant le dédommagement civil du manifestant énucléé. On est là dans une autre culture juridique, où les responsables politiques et policiers prennent acte des décisions de justice.
Les violences policières sont-elles la marque d’un pouvoir politique fort qui exige de la police de ne pas se retenir pour mater la protestation sociale, ou au contraire d’un pouvoir politique faible ?
Plutôt la marque d’un pouvoir politique faible. Mais il s’agit de ma part d’une intuition plus que d’une certitude. Pour répondre à la question, il faudrait pouvoir observer en salle de commandement, là où se rencontrent le préfet et les chefs policiers, c’est-à-dire le politique et le technique.
Je fais l’hypothèse que les violences qu’on a pu observer, les flottements tactiques, où on nasse les manifestants sans trop savoir pourquoi, où on observe des dérives individuelles, avec des compagnies ou des sections laissées à leur libre arbitre – je pense notamment au jet de cette grenade de désencerclement à Paris, qui a blessé gravement un manifestant – sont la marque d’un pouvoir politique affaibli par rapport au pouvoir policier.
Sur quoi étayer cette hypothèse ? La relation entre police et politique est une histoire à la fois ancienne et complexe en France. Pour donner quelques points de repère : la chute de la IVe République a été directement provoquée par les manifestations policières du 13 mars 1958, durant lesquelles les policiers entreprennent de marcher sur le Palais Bourbon, avec des slogans très anti-parlementaires, en sachant qu’ils sont soutenus à l’intérieur de l’Assemblée nationale par les troupes de Poujade et une fraction de la droite UNR. Le syndicat de police obtient, sur un coin de table, des avantages catégoriels substantiels qui ramènent les policiers dans leurs commissariats ; mais on date de cette manifestation le moment où les parlementaires comprennent que le régime ne peut plus être sauvé et où l’option De Gaulle apparaît la seule crédible, en dépit de toutes les incertitudes qu’elle porte.
En octobre 2001, après que Jean-Claude Bonnal, tout juste sorti de prison, tue deux policiers, les importantes mobilisations de policiers et, pour la première fois, de gendarmes, dans une période de cohabitation tendue, scellent le sort du gouvernement de gauche et la campagne de 2002, lors de laquelle le thème de l’insécurité devient omniprésent. Lorsque Sarkozy arrive au ministère de l’intérieur, il obtient d’amples moyens pour les policiers, restaure la puissance des syndicats et fait en sorte que la police acquière une puissance considérable. Il se dit « premier flic de France », une formule reprise ensuite par tous ses successeurs. Une formule qui signifie, si on l’écoute attentivement, que le politique n’est plus extérieur à l’institution policière, mais qu’il fait partie d’elle.
« Oui, être le premier flic de France, c’est décider, c’est assumer, et c’est être aux côtés des forces de l’ordre », disait en tribune Manuel Valls, le 30 septembre 2013. Sous une allure affirmative et tranchante, cette déclaration signe que le ministre de l’intérieur se voit comme celui qui accompagne les policiers et non comme celui qui les dirige. Sous des tonalités martiales, une déclaration de subordination.
Alors, dans un moment d’agitation sociale aiguë, où les policiers sont surmenés et astreints à des missions dures, longues et pénibles, ils savent qu’ils sont en position de force vis-à-vis du politique. On ne leur fera pas avaler la première réforme venue. Il faut bien prendre la mesure de ce qui se joue. Après Charlie, la police a été présentée comme l’incarnation de la nation, dans un geste de sacralisation qui n’est pas sans rappeler le « Poilu » après la Guerre de 14. Après la guerre, l’armée pouvait être critiquée. Mais le Poilu non. La police après les attentats n’a pas été épargnée par les critiques, mais le policier mythologique est intouchable.
Cela fait plus d’un an que les policiers voient le politique leur rendre hommage sur hommage, se lever en leur honneur, observer des minutes de silence, etc. Alors, après Charlie et les meurtres répétés des leurs, les policiers ne comprennent très sincèrement pas qu’on puisse s’en prendre à eux. Ils et elles voient les autonomes qui les attaquent et veulent leur fracasser le crâne comme des déviants totalement obliques à la société, comme des gens qui ont rompu avec la société.
On comprend dans ces conditions que lorsque Valls explique qu’il n’y a pas « de consigne de retenue », c’est la seule chose qu’il puisse dire de toute façon. Il ne s’agit pas d’une inclination personnelle envers la force et l’affirmation virile. C’est le résultat d’un processus continu, décuplé par les attentats, d’élévation symbolique de la police, et de dépréciation du politique – et ce par le politique lui-même.
« Tout le monde déteste la police », affirme la tête de cortège des manifestations contre la loi travail. Est-ce davantage vrai aujourd’hui qu’hier ?
C’est totalement faux, et plus encore aujourd’hui qu’hier. Les Français aiment leur police. Deux tiers d’entre eux disent « avoir confiance » ou « totalement confiance » dans leur police, et cette proportion est montée à quatre cinquième depuis Charlie. Mais ces deux tiers d’approbation de fond sont l’un des scores les moins élevés d’Europe de l’Ouest. Et un tiers des Français estiment que les policiers ne traitent les gens que « rarement » ou « très rarement » « avec respect ». C’est l’un des scores les plus élevés d’Europe de l’Ouest.
Sur les slogans en circulation, on remarque un certain renouvellement. À l’ancien mais durable « CRS=SS » succède celui que vous évoquez. C’est un slogan qui, à mon avis, vient d’Allemagne, qu’on a vu là-bas apparaître sous la forme de banderoles ou de petits autocollants. Sauf qu’en Allemagne, bien sûr, il est décentralisé. On a ainsi « Ganz Berlin hasst die Polizei », « Ganz Stuttgart… », « Ganz Hamburg… », ou avec une touche ironique de bien plus petites villes (« Ganz Schweinfurt hasst die Polizei » !). Puis « Die ganze Welt hasst die Polizei », ce qui est devenu chez les Français « Tout le monde déteste la police ». Ce doit être un produit de l’internationalisation des mouvements contestataires, notamment via les sommets européens ou mondiaux, et de la circulation des slogans, notamment ceux qui visent la police. C’est vrai aussi pour ACAB (All Cops Are Bastards) qu’on ne voyait guère en France jusque-là…



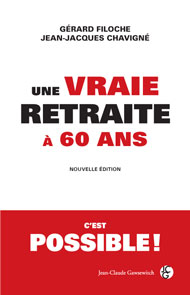






3 Commentaires
Je ne vois pas l’intérêt de ce long pensum sinon d’essayer de noyer le poisson…
Le pouvoir politique n’est pas seulement affaibli face au pouvoir policier, il est aujourd’hui méprisé par une majorité des français.
Les mots qui suivent sont un peu hors sujet mais je profite de l’occasion : Il faudrait que le parti socialiste (et la gauche toute entière) se désolidarise du pouvoir pour redevenir crédible avant 2017. Je pense que Monsieur FILOCHE, que je salut ici respectueusement, est du même avis. Mais je pense aussi qu’il est aujourd’hui dangereux de mettre le feu à une poudrière.
Quand aux slogans « CRS SS » et « tout le monde déteste la police » il est dommage d’entendre cela dans ces manifs, mais ils visent justement le pouvoir en place.
Cordialement Dom. BOUVARD
Bonsoir à tous,
En complément de l’entretien publié par notre camarade Gérard Filoche, je vous invite à lire l’article intitulé « Pourquoi la Loi Travail et les interdictions de manifester révèlent une radicalisation de l’oligarchie néolibérale », disponible à l’adresse suivante : http://www.bastamag.net/Loi-Travail-un-texte-qui-revele-l-ampleur-de-la-radicalisation-du
Solidairement.