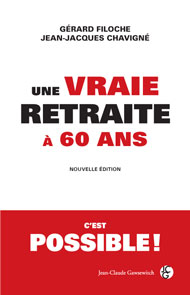Surmultipliant son offensive contre les droits démocratiques et sociaux de la majorité écrasante des salariés, Macron, après les retraites à 64 ans, de plus en plus autoritaire et brutal, se sent autorisé à programmer des dizaines de nouvelles mesures anti droit du travail.
Il accomplit avec méticulosité le programme du Medef, et au-delà, puisque non seulement il baisse drastiquement le coût du travail mais il oeuvre à détruire le salariat en tant que tel, en l’ubérisant pour mieux démanteler sa protection sociale.
Comme quoi les libéraux se servent à fond sans scrupule de l’État et ça se concilie très bien avec les politiques néolibérales les plus brutales. Ils ne reculent devant rien en matière d’autoritarisme et de répression policière. Sans ses forces de l’ordre, Macron serait déjà chassé depuis longtemps.
Toute sa technique est de mentir et de truquer les chiffres à une échelle de masse, affirmant que c’est le jour quand c’est la nuit, qu’il fait chaud quand il fait froid, qu’il crée des emplois quand il en supprime, que tout va bien quand la misère monte, cette violente contre-propagande lui étant nécessaire pour masquer la brutalité de son action.
1
Attaque contre le chômage et les chômeurs
A la différence de Hollande qui voulait chaque mois annoncer l’inversion de la courbe du chômage, Macron ne s’est pas gêné : il a changé la méthode de calcul, remplaçant les chiffrages de la DARES, de Pole emploi par ceux du BIT pour lequel le seul fait de travailler une heure dans le mois suffit à n’être plus chômeur. En se limitant à la « catégorie A » et en excluant les catégories B, C, D et E, évidemment le chômage affiché a « baissé » autour de 7 % au lieu de 11%. D’autant que la moitié des chômeurs ne sont pas indemnisés, les radiations se font en masse et les lois Macron Borne ont rendu plus difficile les critères pour accéder à l’indemnisation et ont réduit la durée de celle-ci.
En fait Macron expulse les salariés du salariat puis les chômeurs du chômage.
En mentant sur le taux réel de chômage, en imposant 7,4 % au lieu de 11,4 %, Macron y trouve non seulement un intérêt politique d’affichage, mais il fait fonctionner utilement sa loi de spoliation qui prévoit que si le chômage est inférieur au seuil de 9 %, la durée d’indemnisation est abaissée de 25 %.
Dans la vie réelle, il y a toujours 6 millions de chômeurs officiels (hors Mayotte). Et la part de la population active non occupée est autour de 17%.
Ensuite, il faut étudier la part des « nouveaux emplois » que Macron Lemaire affirment avoir récemment créés pour constater que ce sont des « sorties de chômage » mais ce ne sont plus des emplois salariés. Une note de l’INSEE donne les clés pour le calculer : elle pointe qu’un chômeur sur 5 au sens du BIT n’est pas inscrit à Pôle Emploi, en donnant l’exemple de jeunes sans indemnisation. François Ruffin s’appuie sur Eurostat pour démontrer que la France est championne, avec la Hongrie et l’Estonie, de la création de l’emploi non-salariés, type auto entrepreneurs : 2,4 millions.
Ce qui veut dire que le salariat recule sans doute de 90% vers 88, 87 voire 86% des actifs. On est autour de 30 millions de salariés parmi les actifs, mais autour de 3,5 millions d’indépendants soit 12%, 13%, 14% parmi les actifs (l’artisanat en France c’est environ 1,5 million d’unités légales 4 sur 10 (38%) dans la construction, 15% dans l’industrie 13% services aux ménages et 12% du commerce) il y a 1,2 million de patrons avec au moins UN salarié.
Mais on vérifie que cela signifie extension de la pauvreté puisque 5,3 % des salariés sont pauvres contre 16,6 % des indépendants.
2
Le grand remplacement du salariat
Quelle sorte d’emploi Macron veut-il avec son nouveau logo « France travail » ?
Dans un débat en commission de l’Assemblée nationale face à François Ruffin, le ministre du travail, Olivier Dussopt a tombé le masque. Il souligne que la divergence avec François Ruffin qui défend le statut du salariat, c’est que le gouvernement est « pour la présomption d’indépendance ». Il s’agit cette fois clairement posé du choix préférentiel, essentiel, historique contre l’emploi salarié et pour l’emploi non salarié, la fin des statuts.
Depuis la première loi Macron de 2015, celui-ci ouvrait la voie au remplacement du contrat de travail par un contrat commercial de gré à gré. Macron proposait de modifier le Code civil pour que dans le cas d’un conflit pour ce type d’emploi, ça n’aille plus vers les prud’hommes mais vers les tribunaux d’instance. Ensuite Macron défendait (notamment dans son livre « Révolution ») une « société sans statuts », une « société post salariale » en supprimant notamment les cotisations sociales. Jusque-là le choix de l’ubérisation n’était pas aussi franchement avoué, mais là, Olivier Dussopt tranche explicitement contre l’avis qui, depuis, a été voté en septembre 2021 par la majorité du Parlement européen en faveur de la « présomption de salariat ». Et Dussopt ajoute qu’il « souhaite que ça aille plus loin ». C’est clairement un choix de civilisation inconnu et impensé jusque-là : on a la preuve complète, formelle de la politique suivie par Macron depuis 8 ans, c’est ainsi que tout se décrypte.
A travers les lois anti Code du travail El Khomri Pénicaud de 2016 à 2017, de la loi anti chômage, des attaques contre tout ce qui provient des cotisations sociales, il s’agit bien de « Révolution », ou plutôt de « contre-révolution », c’est la plus grande attaque historique contre le coût du travail en remettant en cause le statut même du salariat. La volonté déclarée, persistante, d’un « grand remplacement » du salariat par une main d’œuvre sans protection sociale, sans retraite, sans horaires, sans droits, ni loi du travail.
Ça se développe récemment dans de nouveaux détails : car Dussopt a signé un décret le 17 avril qui facilite la « reconnaissance » des démissions par l’employeur et non plus par le salarié. Jusque-là aucune démission ne pouvait se présumer ni être « implicite » maintenant il suffit que le salarié soit « absent » de son poste quinze jours et le contrat est présumé rompu.
Refusant que l’abandon de poste puisse être assimilé à une démission présumée, FO a déposé le 3 mai 2023 un recours devant le Conseil d’État. La confédération lui demande de faire annuler cette disposition de la loi Marché du travail de décembre 2022, rendue effective par le décret du 17 avril. C’est une aberration juridique créée dans le seul but de restreindre encore un peu plus les droits des demandeurs d’emploi. Jusqu’alors, après un abandon de poste, un salarié risquait d’être licencié pour faute mais il pouvait percevoir une indemnisation chômage. Désormais, il peut être présumé démissionnaire et ne bénéficie dans ce cas que d’un délai très court pour justifier son absence auprès de l’employeur.
La loi n’introduit que quelques exceptions, liées par exemple à des raisons médicales ou à l’exercice d’un droit de retrait. Le salarié a aussi la possibilité de contester la rupture de son contrat de travail en saisissant les prud’hommes qui ont, en théorie, un mois pour se prononcer. Mais par exemple, un salarié hospitalisé et isolé n’aura pas la possibilité de réagir dans les délais impartis.
FO attaque aussi devant le Conseil d’État le questions réponses rédigé par le ministère du Travail, qui veut laisser croire que le licenciement ne serait plus possible. Ce qui n’est pas le cas.
Pratiquement tout le droit du licenciement (y compris les droits issus de la convention 158 de l’OIT) a été mis à bas, notamment lorsque les soignants ayant refusés de se faire vacciner ont été « expulsés » sans procédure, sans condition ni indemnités.
Les droits des IRP (institutions représentatives du personnel) ont été massivement bafoués : on est passés de 425 000 salariés mandatés à moins de 200 000. Il ne reste que 4600 médecins du travail en poste, 1600 inspecteurs du travail, et les procédures prud’homales sont réduites à 40 % de ce qu’elles étaient encore il y a 15 ans. C’est bel et bien l’ensemble du statut du salariat qui est visé.
3
L’attaque contre le principe même des salaires
Dans la Macronie, il n’est jamais question de salaire net et de salaire brut encore moins super brut. Il n’est question que de pouvoir d’achat, de primes, de compléments, d’indemnités, d’allocations, de chèques compensatoires, d’aides. Quand il y a un problème, l’état envoie un chèque de 100 euros individualisé pour payer l’essence à la place des patrons qui n’ajustent pas les salaires. Quand il y a inflation, Macron dénonce volontiers les « forces de la spéculation » mais n’agit pas contre elles, il suggère des compensations, des « paniers de la ménagère », des « primes Macron » éphémères et aléatoires mais jamais des hausses de salaire. Le but est clairement de supprimer progressivement les cotisations sociales sur les salaires.
Le projet de loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel (ANI) relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise a ainsi été présenté en conseil des ministres le 24 mai 2023 : c’est l’un des premiers textes annoncé de la séquence post-retraites, censé à la fois « apaiser les relations avec les syndicats, et donner des gages aux Français en matière de pouvoir d’achat dans un contexte chamboulé par l’inflation ». En vérité, il s’agit de remplacer des éléments de salaires par un système d’intéressement aux bénéfices qui n’implique aucune cotisation sociale.
Toute la propagande vise à détruire le salaire brut, sa fonction, son existence,
Et par là même à casser la Sécurité sociale telle que nous la connaissons encore. Cela fait partie de la « baisse du coût du travail » selon eux : ce n’est plus aux patrons de payer la protection sociale, mais à l’état, à l’impôt.
La façon dont Gabriel Attal a mené son éphémère campagne contre les fraudes fiscales et sociales a donné le ton : il a placé les cotisations sociales sur le même plan que les impôts, alors qu’ils s’opposent. L’impôt n’est pas pré affecté tandis que les cotisations le sont. L’impôt va au budget de l’état tandis que les cotisations sociales vont au budget séparé de la protection social. L’impôt va à l’état public collecté par le fisc, la cotisation sociale avec un collecteur privé Urssaf va à l’organisme privé qu’est la Sécurité sociale (normalement conçue pour être gérée à part avec des élections à part). Le but était de développer une propagande contre la fraude sociale mise sur le même plan que la fraude fiscale, dénigrant ainsi le prélèvement volontaire (salaire brut mutualisé) et sa gestion séparée : jusqu’au point d’envisager une seule carte d’identité nationale et « vitale ».
4
Dussopt apprend aux patrons à contourner le code du travail :
Des révélations qu’on peut qualifier de scandaleuses ont été faites : le ministère du Travail forme des employeurs… à déjouer ses contrôles. Des cadres de l’administration animent des formations payantes (845 euros) dispensées par un organisme privé. Le but de ces formations : est d’indiquer aux employeurs les façons de parer aux actions des 1600 inspecteurs du travail…
Selon la description du stage, il s’agit de « se défendre en cas de contentieux ou de procès-verbal dressé par l’inspection du travail ». Une publication de la société Lamy-Liaisons les organise et une responsable d’Unité de contrôle pour le compte de la DRIEETS Île-de-France, les anime. Ce qui effraie, c’est que le directeur régional, interpellé, réponde « qu’il ne voit pas de problème ». Le seul souci, selon lui, est l’intitulé de la formation, qu’il a demandé à la société organisatrice de modifier. Mais cette formation ne se résume pas dans sone titre : « Contrôler les temps de travail et de repos des collaborateurs, pour éviter les sanctions et prouver le nombre d’heures effectuées… voilà un véritable casse-tête ! (…) Dès lors quels dispositifs mettre en place ? Quelles précautions prendre ? Comment se défendre en cas de contentieux ou de procès-verbal dressé par l’inspection du travail ».
« Que des avocats dispensent à leurs clients employeurs une telle formation pour éviter les contrôles de l’inspection du travail, c’est logique, selon Simon Picou, inspecteur et responsable CGT. Mais là, il s’agit d’un agent du ministère du travail. L’image renvoyée est celle d’une administration qui se range au côté des employeurs. Imagine-t-on des policiers expliquer les recours ou les astuces pour faire sauter des contraventions à des chauffards ? Ou des agents de l’administration fiscale expliquer à des employeurs comment éviter les contrôles ? »
5
La fausse semaine de quatre jours
Le ministre des Comptes publics Gabriel Attal annonce le lancement d’une expérimentation de la semaine de quatre jours dans la fonction publique. Pendant un an, les agents de l’Urssaf de Picardie pourront travailler 36 heures en quatre jours plutôt qu’en cinq. « Je crois que beaucoup de Français aspirent aujourd’hui à travailler différemment. La semaine de 35 heures en quatre jours, que 10 000 Français expérimentent déjà dans des secteurs économiques très variés comme le recyclage industriel ou l’informatique, cela peut être moins de temps passé dans les transports, moins de stress, et au final, plus de bien-être au travail« , baratine Gabriel Attal dans L’Opinion.
Mais hormis que c’est de l’affichage « expérimental » pour 2025… et qu’on est très loin d’une loi concernant la durée du travail de 30 millions de salariés, on observe tout de suite qu’il s’agit de 36 h soit de 9 h par jour et d’une remise en cause des 35 h pas du tout d’une marche vers les 32 h telles que nous les revendiquons – avec la NUPES notamment. Quid de la durée de travail quotidienne ? Quid des heures supplémentaires, de leur majoration et de leur contrôle ? Le Monde alerte sur le fait que « les horaires journaliers doivent rester « supportables ».
6
La mise en cause des CDI :
Sans cesse, des voix de LREM, LR et RN s’expriment non seulement contre les 35 h et mais aussi contre le CDI : au Medef ils n’en ont jamais assez idéologiquement et leur ADN est de détricoter ce qui reste du contrat de travail.
Leur propagande actuelle vise massivement à dénigrer « les jeunes qui ne veulent pas de CDI », « ne veulent pas bosser ».
La vérité est qu’il y a 13 demandes d’emplois pour une seule offre, et que les métiers dits « en tension », restauration, hôtellerie, saisonniers, bâtiment, transports, le sont d’abord en raison de leurs trop bas salaires et de leurs trop longues durées du travail.
Quand ils le peuvent 41,2% des jeunes de 15 à 24 ans se salarient en emploi à durée indéterminée.
Dans la pratique 85 % des emplois salariés sont et restent en CDI entre 25 et 54 ans.
Les Macroniens et le Medef sont en contradiction parce que leur volontarisme idéologique les pousse à promouvoir indépendants, stagiaires, alternance, apprentissage, travailleurs détachés, immigrés vulnérables, intérim et CDD, mais les besoins réels des entreprises ce sont des salariés formés, expérimentés, fiables, stables, compétents, assez polyvalents, et éduqués pour produire.
Pour eux, c’est insurmontable en fait : ils réussissent à pousser les indépendants, ils grignotent les CDI, ils rognent les contrats de travail, mais ils ne parviennent pas à mettre en place des lois pour changer le système CDI. Ils le veulent depuis des années, Macron, Borne et Dussopt les annoncent pour la rentrée 2023, il faut se préparer, mais rien n’est joué.
Aux syndicats et la NUPES défendre la reconstruction d’un droit du travail.
Statut d’emploi et type de contrat selon le sexe en 2022 Insee
en %
| Statut d’emploi et type de contrat selon le sexe en 2022 (en %) |
| Statut d’emploi et type de contrat |
Femmes |
Hommes |
Ensemble |
| Indépendants |
10,0 |
16,0 |
13,1 |
| Salariés |
90,0 |
84,0 |
86,9 |
| Emploi à durée indéterminée |
74,5 |
70,4 |
72,4 |
| Contrat à durée déterminée |
9,9 |
6,4 |
8,1 |
| Intérim |
1,5 |
2,8 |
2,1 |
| Alternance, stage |
3,0 |
3,6 |
3,3 |
| Sans contrat ou contrat inconnu |
1,0 |
0,8 |
0,9 |
| Ensemble |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
- Lecture : en 2022, 74,5 % des femmes en emploi sont salariées en emploi à durée indéterminée.
- Champ : France hors Mayotte, personnes vivant en logement ordinaire, en emploi.
7
Pénibilité et mort au travail :
Fin mai, il y a déjà 120 morts au travail recensés en 2023 et cela augmente. La France est devenue championne des accidents du travail mortels en Europe deant la Hongrie et la Bulgarie. Particulièrement parmi les enfants, depuis que De Villepin en 2006 a rétabli le travail des enfants à partir de 14 ans, et le travail du dimanche et de nuit à partir de 15 ans. Les lois protectrices spécifiques aux enfants ont été supprimées par Rebsamen en 2015. Un accident du travail sur deux n’est pas déclaré par les patrons.
Les chiffres sont effrayants : autour de 600 accidents mortels, de 700 suicides liés au travail, 4500 handicapés du travail, 650 000 accidents avez arrêts, et il est quasi impossible, faute de volonté du patronat et du pouvoir, de dénombrer les centaines de milliers de maladies professionnelles, reconnues et dissimulées, réparées, et non réparées.
Un enfant de 14 ans et demi a été broyé dans un pétrIn de boulanger à Mulhouse et un senior de 68 ans « auto-entrepreneur » forcé s’est tué en chutant d’un toit à Versailles !
La presse quotidienne régionale relate de temps en temps, en coin de page, ces tragédies : chutes, enfouissements, écrasements, effondrement de charges, des vies supprimées, mutilées, gâchées au travail. Là, un éboueur. Là un livreur de repas à vélo (il y déjà eu 10 tués.) Là un ouvrier sur sa machine dangereuse. Là, un accident de tracteur. Là, un bucheron ou un élagueur. Le plus fréquent étant dans le BTP.
Lorsqu’un jeune comme Danish Ahmedi, réfugié afghan, 23 ans, perd la vie sur un chantier à Orgères, en Ille-et-Vilaine, le Télégramme titre : « Quelle bêtise de mourir comme ça pour un Smic », une enquête pour homicide involontaire est ouverte… » et puis on n’en parle plus…
Les accidents du travail ça ne fait jamais la « une » des journaux télévisés. C’est un tabou. Il n’y a pas de plaque commémorative, ni monuments aux morts sur les lieux, on y meurt et puis on est oubliés.
Déjà l’espérance de vie recule, déjà l’espérance de vie en bonne santé recule, mais les conséquences du recul de l’âge de la retraite pour des salarié·es âgés déjà surexposé·es vont être catastrophiques.
Plusieurs manifestations syndicales ont eu lieu en France le 28 mars dernier : à Paris, quelques 200 personnes ont répondu à l’appel des syndicats et d’associations devant le ministère du Travail pour protester contre « l’omerta » lié à ce fléau. « Le travail tue » « on ne veut pas mourir au travail ». A Lyon dans une action symbolique, l’eau de la fontaine des Jacobins est devenue rouge, une mare de sang symbolisant les mort·es au travail. Et ensuite a eu lieu une grande manifestation interprofessionnelle pour demander une retraite pour les vivants !
Le 28 avril, lors de la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, les représentant·es CGT se sont succédés pour dénoncer le manque de moyens alloués à la prévention des risques professionnels. Parmi les mesures proposées lors du débat : réfléchir à nos leviers d’action pour stopper l’hécatombe, améliorer la prévention des risques, visibiliser la violence du travail, sanctionner réellement les patrons délinquants. La création d’un tableau de maladies professionnelles sur les pathologies psychiques, des sanctions contre le non-respect des normes de prévention, la création de postes d’inspecteurs du travail, et surtout… le retour des CHSCT.
Les morts au travail ne sont pas une fatalité
La réalité, en France, en 2023, c’est que moins d’1/3 des procès-verbaux des Inspecteurs du travail relevés à la suite d’accidents du travail donnent lieu à des condamnations. Et les condamnations sont dérisoires. La délinquance et la criminalité patronale ont de beaux jours devant elle : face à la caméra, des inspecteurs du travail témoignent de leurs difficultés à obtenir des sanctions pour des infractions à la sécurité : @santetravailmag et dans l’émission @Cdenquete de France 2 https://sante-et-travail.fr/securite-limpuissance-
En fait le ministère Dussopt n’a rien engagé de sérieux contre cette hausse de la mort et des maladies au travail, ni pour les jeunes ni pour les seniors. Même pas « d’index » ! Pas de rétablissement des CHSCT ! Pas davantage d’inspection ni de sanction. Macron, qui ne veut pas entendre parler de « pénibilité liée au travail », par son idéologie libertarienne, ne veut ni contrôler, ni sanctionner les entreprises.
8
Jusqu’à supprimer l’eau chaude aux salariés :
La macronie est totalement étrangère à l’idée donner des pouvoirs aux salariés, sa vision est totalement celle du chef d’entreprise qui ne veut pas d’entrave. Ni démocratie au Parlement, ni démocratie à l’usine. Conception et exécution viennent d’en haut.
Voilà pourquoi il faut réclamer contre eux, le rétablissement des CHSCT qui furent la principale institution de prévention de la santé, de l’hygiène, et de la Sécurité au travail. (Cf. avis Filoche, adopté par le CES en 2001, publié au Journal officiel).
Au lieu de cela, incroyable mais vrai, Dussopt se moque jusqu’à la caricature de l’hygiène des salariés et dans les détails, puisque c’est par décret de ses services (indifférence ? incompétence ? cynisme ?) en date du 24 avril 2023, qu’il permet « pour des raisons de sobriété énergétique » aux employeurs de couper l’eau chaude dans les locaux professionnels :
9
L’apprentissage :
Macron, Borne, Dussopt se vantent d’un « million d’apprentis » c’est vrai, ça et les 2,4 millions d’auto entrepreneurs, ça abaisse les chiffres du chômage ! Ils suppriment de facto les lycées professionnels. 600 000 élèves exclus des lycées, enfermés dans un apprentissage borné, aliénés par une spécialisation précoce, privés de culture générale, seront plus tôt et davantage soumis aux patrons et donc moins payés. Ils ne pourront être cultivés ni polyvalents et ils revendiqueront moins.
Toute l’année 2023 le gouvernement fidèle au transfert de l’argent public vers le privé, paie les patrons extrêmement cher pour les prendre : 6000 euros par an par apprenti.
Il y a un effet pervers à ces primes d’état : en 10 ans, il y a doublement du nombre d’apprentis en « diplôme ingénieur », triplement du nombre d’apprentis en « licence » mais – 15 000 apprentis en « CAP » !! Quand l’état paie la MO, les employeurs recrutent les apprentis déjà formés !
En bas de l’échelle, l’apprentissage est vidé de son sens. Il n’y a plus de formation des maitres. L’idéologie est celle du XIX° siècle : « -J’en ai bavé dans mon jeune temps pour apprendre à bosser, toi aussi ! »
L’exploitation sur le tas remplace toute formation théorique et culturelle.
Les jeunes sont si mal payés (25% du smic la première année, 55% la deuxième année, 85% du smic la troisième année) qu’ils s’en vont et deux sur trois ne finissent jamais leur apprentissage. Cela ne débouche donc même pas sur des embauches durables ni des salaires décents.
En voilà 9.
Le 10 c’est du grand art :
il consiste à obliger les « RSA » à travailler gratis et ce contre tous les droits de l’homme.
Article 2 de la Convention 29 de l’OIT de 1930 «Le terme travail forcé ou obligatoire désignera tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré (.)»
Alors que seulement 50 % des ayants droits touchent le RSA, c’est encore trop pour Macron, au lieu de garantir un retour à l’emploi, il propose de stigmatiser les allocataires, et de sanctionner ceux qui refuseront le travail obligatoire qui va leur être imposé (sans droits associés, validation de trimestres retraite par exemple..)
Et, record de record : cela consiste à faire travailler 11 h par jour et 48 h par semaine 45 000 « bénévoles » aux jeux Olympiques de 2024.
Ils auront une formation, une discipline, des chefs d’équipe, ils ,seront subordonnés, leurs frais de déplacements ne seront pas remboursés, juste un repas sur le pouce. En ces temps de chômage, de misère, d’inflation, ils ne seront pas payés, ce sera pour la gloire olympique au nom du « sport »d’élite. Ces 45 000 pigeons n’en tireront aucun avantage car leurs tâches seront ingrates. Tout un édifice juridique a été bâti, une pseudo « charte des volontaires » Cela économisera 1% des dépenses somptueuses prévues aux JO qui ont un budget à 8,5 milliards minimum, qui ont un chef qui se paie 273 000 euros, et qui vont générer d’autres milliards pour les sponsors. C’est une sorte de couronnement que de réussir dans une machine à cash de dizaines de milliards, d’obtenir encore mieux que des ubérisés : des victimes qui vont renoncer d’elles-mêmes à leurs salaires. travailler dur pour rien ! Dans l’échelle de l’escroquerie, du détournement et de la destruction des droits, on peut dire que c’est un summum, une apogée du macronisme.
» Nous continuerons dans le numéro d’été n° 306 de D&S, à vous faire découvrir les méfaits au présent et futurs de la macronie contre les droits du travail.
Gérard Filoche le 6 juin 2023
Lire blog gerardfiloche.fr « reconstruire le code du travail en dix points »