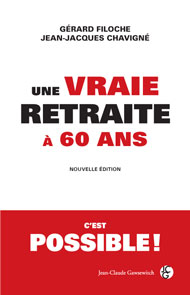Salariat et code du travail
Le salariat n’a que sa force de travail à vendre. Le patronat achète cette force de travail. Le salaire est l’enjeu de cet échange. Le salaire, c’est à la fois le salaire net et le salaire brut et super-brut [1]. Avec le salaire net, on vit mois après mois. Avec le salaire socialisé, qui inclut toutes les cotisations, on vit toute la vie. Le niveau du salaire dépend en permanence des rapports de force entre salarié et employeur. Et ce rapport de force trouve son incarnation dans les droits du travail.
Sommaire
- 1. Crier « vive l’entreprise » ne veut rien dire
- 2. Le travail n’enrichit personne, il permet de vivre ; ce qui enrichit, c’est l’exploitation du travail des autres.
- 3. Quand le travail menaça de coûter plus cher que le capital, le capital sut lui imposer un salaire maximum. L’inverse se fait encore attendre.
- 4. De plus en plus, les travailleurs ont un statut
- 5. Droit du travail et droits humains
Si vous avez un mauvais droit du travail, votre salaire, votre durée du travail, vos conditions de travail et votre emploi sont fragilisés. Si vous avez un bon droit du travail, votre niveau de salaire est plus élevé, votre durée du travail est plus basse, vos conditions de travail sont meilleures, et votre emploi mieux garanti.
L’entreprise n’est pas un dancing, c’est un lieu d’exploitation de la force de travail. Même un « bon » patron ne peut faire autrement que d’exploiter ses salariés, sinon son entreprise meurt. Dans la société capitaliste, il faut absolument qu’elle dégage des marges et bénéficie du partage généralisé de la plus-value. Aussi humain que soit le patron, il faut qu’il participe à cette exploitation de l’homme par l’homme, sinon il ne peut rester patron.
1. Crier « vive l’entreprise » ne veut rien dire
« L’Entreprise », ça n’existe pas, c’est comme crier « vive les poissons », il y a des requins et des sardines. En France mille entreprises produisent presque 50 % du PIB et ce sont elles, et leurs dirigeants qui décident de toute l’économie, des investissements, des innovations, des licenciements, du chômage. Sur 1,2 million d’entreprises existantes. 200 000 PMI, PME, ETI sont à 80 % des sous-traitantes des « mille ». Enfin, un million, les TPE, ont moins de 10 salariés. Dans le partage de la production et des « marges », ce sont les requins, les « gros » qui gagnent : les plus petits patrons « sardines », sont dominés, pillés, tout comme leurs salariés.
Le partage des fruits du travail des salariés des entreprises, des prix, des profits et des dividendes se fait soit de façon régulée et civilisée, soit de façon sauvage et brutale.
L’existence d’un Code du travail, fort, précis, contrôlé, appliqué est là pour que le partage se fasse de façon ordonnée : une économie où ce partage s’effectue harmonieusement est elle-même plus forte dans « l’intérêt général ».
Ce sont les salariés les mieux formés, les mieux payés, les mieux traités qui produisent le plus. C’est mieux quand l’État de droit, l’ordre public social, les lois de la république l’emportent sur le marché sauvage. D’ailleurs, la tendance réelle en France, contrairement à de fausses idées reçues, est au développement des CDI et à leur allongement : 85 % des contrats sont des CDI et même 95 % entre 29 ans et 54 ans, la durée moyenne des CDI s’est allongée de 20 % dans les trente dernières années.
La non-existence d’un Code du travail ou la faiblesse de son contenu permettent la surexploitation, le creusement des injustices, les vies désarticulées et brisées : une économie dérégulée, flexibilisée, sans statut ni protection, ni respect pour les salariés, est aussi rongée par les inégalités et subit crise sur crise.
C’est moins bien même du point de vue de la production, quand le chômage gangrène, que le partage du travail ne se fait pas, que la souffrance des salariés est plus grande, qu’ils sont traités de façon moins digne : mais c’est ce type d’économie qui permet des « marges » plus grandes à la finance. Spéculer aujourd’hui rapporte plus que d’embaucher. La finance fait gagner plus que l’emploi. L’absence de règles, de contraintes, de contrôle, convient encore mieux au banquier qu’à l’industriel.
Donc, ils vantent la dérégulation et l’organisent. Emmanuel Macron s’est prononcé pour « une société sans statut », sans statut privé, c’est-à-dire sans code du travail et sans statut public, c’est-à-dire sans statut de la fonction publique.
De tout temps, ceux d’en haut, 1 %, ont tout fait pour s’accaparer au maximum les fruits du travail de 99 % des actifs. Ceux d’en haut ne sont pas des humanistes, des altruistes, des partageux, ils en veulent toujours plus.
2. Le travail n’enrichit personne, il permet de vivre ; ce qui enrichit, c’est l’exploitation du travail des autres.
À travers l’histoire, « ceux d’en haut » ont toujours essayé de gagner le plus possible. Ce qu’ils perçoivent ne « ruisselle » jamais sur « ceux d’en bas », au contraire ils pompent, ils siphonnent.
En France, la rémunération de Carlos Ghosn atteint 7,25 millions d’euros, pour l’année 2015, (sans compter les 8 millions d’euros perçus pour la direction de Nissan). Celle de Carlos Tavares a doublé pour atteindre 5,24 millions (pour polluer et tuer par ses pots d’échappement truqués). Les résultats dont il se prévaut ont pour source principale le licenciement de 8 000 salariés de l’entreprise, en 2013. Le sommet est, cependant, atteint par Olivier Brandicourt, à la tête de Sanofi : 16,6 millions de rémunérations. Le PDG du groupe Capgemini, Paul Hermelin, voit sa rémunération augmenter de 18 % et atteindre 4,43 millions d’euros. La rémunération des 40 patrons du CAC représente, 4,2 milliards d’euros, au total, en moyenne, 240 fois le Smic, pour chacun de ces dirigeants.
Nous, nous voulons travailler mieux, moins, tous et gagner plus. Nous voulons un emploi et un salaire pour toutes et tous. C’est possible, car le travail est une comète en expansion infinie, il y en a pour tous s’il est socialement partagé. Il faut travailler 32 h, un jour ce sera 28 h, 24 h…
Ce n’est pas parce qu’il y aurait trop de main-d’œuvre qu’il y a du chômage. Il est arrivé qu’il n’y ait pas assez de travailleurs et que les employeurs bloquent cependant les salaires.
La « peste noire », arrivée en Angleterre, en août 1348, anéantit en 14 mois un tiers de la population. La valeur de la main-d’œuvre monta, tandis que celle du capital baissait. L’augmentation des salaires ruraux fut estimée à 48 %. La « gentry » ne le supporta pas. Le roi Edouard III publia, le 18 juin 1350, une sorte de « code du travail » contre « la malice des servants ». « Toute personne, homme ou femme, âgée de moins de soixante ans, qui n’a aucune occupation définie, aucune fortune particulière, aucune possession foncière, devra travailler quand elle en sera requise, et accepter les gages usités en 1346 ou dans les cinq ou six années précédentes, sous peine de prison ». « Les selliers, pelletiers, corroyeurs, cordonniers, tailleurs, charpentiers, maçons, tuiliers, bateliers, charretiers et tous les artisans et ouvriers ne doivent demander que les gages de 1346, sous peine de prison ». Les salaires des manants furent bloqués par la terreur. Pas de « concurrence libre et non faussée ». Peine de mort pour celui d’en bas qui réclame un trop haut salaire en temps de crise !
3. Quand le travail menaça de coûter plus cher que le capital, le capital sut lui imposer un salaire maximum. L’inverse se fait encore attendre.
Pourtant, les lois sont ce qu’en font les humains. Il n’y a pas de fatalité surnaturelle. On peut remplacer la main aveugle du marché par la main visible de la démocratie. On peut imposer un « salaire maximum » tout comme on peut augmenter le « salaire minimum » : c’est une question de rapport de force, de volonté, de choix politique. C’est toujours la politique qui l’emporte sur l’économie, en 1348 comme en 2018, et non pas l’inverse.
Ce que le capitalisme appelle compétitivité, concurrence, ce n’est pas seulement la recherche du profit, c’est celle du profit maximum.
C’est pour cela qu’ils parlent de « la main aveugle des marchés » : c’est pour faire croire qu’il y a des lois économiques incontournables, des fatalités dans l’organisation de la production, des échanges imposés qui décident du sort des humains et du partage inégal des richesses qu’ils produisent.
Le capital mondialisé du XXIe siècle pille tellement le travail que 87 hommes possèdent plus que la moitié de l’humanité. Rien ne les a encore sérieusement arrêtés à ce jour, la recherche du profit maximum fait que 3 hommes possèdent plus que les 48 pays les plus pauvres.
Dans une étude, trois chercheurs de l’Institut fédéral de technologie de Zurich ont mis en évidence l’extrême centralisation du pouvoir capitaliste : selon eux, « les multinationales forment une structure de nœud papillon géante et une grande part du contrôle est drainée par un cœur tissé serré d’institutions financières ». Ils identifient 43 060 firmes transnationales (Trans National Corps ou TNCs), selon la définition de l’OFCE, et calculent que « à eux seuls, les 737 détenteurs prépondérants « maîtres du monde » cumulent 80 % du contrôle sur la valeur de toutes les TNCs ». Ils en tirent la conclusion que « le degré de contrôle du réseau est bien plus inégalement distribué que la fortune ». En particulier, « les acteurs du haut de la liste détiennent un contrôle 10 fois plus important que ce qu’on attendrait sur la base de leur fortune ».
Pour ces trois chercheurs, la centralisation du pouvoir capitaliste ne s’arrête pas là : 147 TNCs « via un réseau complexe de relations de propriété » possèdent 40 % de la valeur économique et financière des 43 060 TNCs. Enfin, au sein de ce conglomérat de 147 multinationales, 50 « super entités » concentrent l’essentiel du pouvoir. Parmi ces « super entités » : Goldman Sachs, Barclays PLC, JP Morgan Chase & Co, Merrill Lynch, Bank of America corporation, mais aussi (en Europe), UBS AG, Deutsche Bank AG, et (en France) AXA en 4eposition, Natixis, Société générale, BNP Paribas.
Un tel réseau financier « densément connecté devient très sensible au risque systémique » et c’est au final un nombre extrêmement restreint de fonds d’investissements et d’actionnaires, au cœur de ces interconnexions, qui décident de restructurer les grands groupes industriels et de spéculer sur l’immobilier, le pétrole ou les dettes des pays du Sud, ou contre la zone euro…
Une lutte mondiale oppose le pouvoir de ce capital très centralisé à la force montante du salariat. L’OIT (agence des Nations unies qui regroupe les représentants des gouvernements des employeurs et des salariés de 185 États) estime qu’il y a un milliard de salariés de plus dans les trente dernières années et le salariat a atteint 50 % des actifs, 2,5 milliards des emplois dans le monde. 40 % des travailleurs de la planète bénéficient d’un contrat permanent à temps plein, même si le chômage de masse (201 millions de personnes) plombe la situation, et si des contrats à court terme et à horaires irréguliers sont encore plus nombreux.
4. De plus en plus, les travailleurs ont un statut
La protection sociale progresse dans le monde, souligne l’OIT : car les systèmes de retraite ou d’assurance maladie sont souvent appuyés sur des systèmes contributifs et des cotisations salariales. « Les pays émergents, à fort taux d’emploi informel, ont intégré cette nécessité d’une meilleure couverture sociale pour faire face à la crise et assurer leurs propres leviers de croissance, comme en Chine, au Brésil et en Amérique latine en général, en Afrique aussi dans certains pays comme l’Ethiopie ou l’Afrique du Sud »
En France, en 1945, il y avait à peu près 45 % d’indépendants et 55 % de salariés. Les « indépendants », patrons, commerçants, agriculteurs, artisans, professions dires « libérales », ne voulurent pas s’affilier à la Sécurité sociale des salariés, la croyant trop fragile. Mais ce sont eux qui ont perdu, 90 % des actifs sont devenus des salariés et il ne reste que 10 % d’indépendants, ce qui pousse le « RSI » à la faillite.
Tous les jours, la propagande commente « la fin du salariat ». Certes, l’impact du chômage et de la multiplication des mesures juridiques de casse du droit du travail peut contribuer à augmenter à nouveau le nombre d’indépendants « tâcherons » journaliers » , mais cela ne jouera que de quelques points… Toutes les contre-révolutions idéologiques, juridiques, ne peuvent renverser une tendance qui a produit 90 % d’actifs salariés depuis 7 décennies.
La France n’est pas en train de devenir une « start up » comme le fantasme Emmanuel Macron.
Ce n’est pas encore demain qu’un drone remplacera un cycliste « Delivroo » pour vous servir vos croissants frais au petit déjeuner. La « vieille économie » des grands groupes industriels, du CAC 40, des 58 grandes multinationales françaises, règne de façon incontestable. Les secteurs dynamiques du commerce mondial ont changé entre la décennie 1990 et le début du XXIe siècle. Certains secteurs de la nouvelle économie, qui avaient tiré les exportations mondiales durant la décennie 1990, croissent moins vite que l’ensemble du commerce depuis 2000. Deux secteurs de haute technologie restent en revanche dynamiques : la pharmacie et les composants pour l’audiovisuel et les télécommunications. En ce début de XXIe siècle, ce sont ainsi les grands secteurs des biens d’équipement, de l’automobile et de la chimie qui tirent la croissance du commerce mondial. Ce maintien et renforcement des secteurs de la prétendue « vieille économie » est le résultat de deux bouleversements de l’économie mondiale : l’éclatement de la bulle Internet d’une part, et l’insertion rapide de certains pays émergents dans les échanges mondiaux d’autre part.
Du travail il y en a pour tous s’il est partagé, c’est une cométe en expansion infinie. La machinisation, l’automatisation, l’informatisation et la numérisation, dans la mesure ou le travail est partagé, créent plus d’emplois qu’elles n’en ont supprimé : il y avait 9,5 millions de salariés du privé lors des 40 heures du Front populaire de mai juin 1936, environ 11,5 millions lors de mai 68, et 17,5 millions en 2002 lors des 35 heures pour tous. En 70 ans, malgré une guerre mondiale et deux guerres coloniales, on a produit plus, gagné plus, doublé le nombre d‘emplois, et travaillé moins. Pourquoi cela ne continuerait-il pas ? Il ne tient qu’aux rapports de force sociaux que les nouveaux emplois soient remplacés, partagés, en quantité et en qualité. Il n’y a rien de fatal à ce que les progrès technologiques ne nourrissent que la finance d’en haut et ne soient pas partagés entre ceux d’en bas.
La France, pays recordman d’Europe des milliardaires, n’a jamais été aussi riche, et ses richesses aussi mal distribuées. Pourtant rien ne l’empêche, ni la mondialisation, ni l’Union européenne. Ce n’est pas l’Union européenne qui empêche d’aller chercher les 80 milliards de fraude fiscale, ni de taxer les 500 premières familles françaises qui détiennent 450 milliards, ni les 600 milliards d’avoirs français dans les paradis fiscaux, ni d’imposer valablement les 58 multinationales qui blanchissent 100 milliards au Luxembourg (Luxleaks) : si le taux d’imposition de Lionel Jospin (à l’époque, la droite se plaignait de la trop grande « cagnotte publique ») avait été conservé jusqu’à nos jours, il n’y aurait pas de déficit du budget de l’État.
La fiscalité et le droit social sont du ressort des gouvernements français, pas de l’Union européenne, ni de la mondialisation.
Ce ne sont pas l’Union européenne ni la mondialisation qui expliquent ce qui se passe dans une des plus grandes branches, la restauration. Car c’est bien là qu’il y a les durées du travail les plus longues, les salaires les plus bas, le turn over le plus important, les maladies professionnelles les plus nombreuses, la convention collective la plus faible, les contrats les plus flexibles, la précarité la plus fréquente, le travail dissimulé le plus important, la fraude la plus intense, et pourtant ni les 850 000 salariés, ni les usagers n’en ont profité, ni en salaires, ni en emplois, ni en conditions de travail, lorsque la TVA fut abaissée pendant cinq ans à 5,5 %. C’est le patronat et l’inaction de l’État qui sont en cause.
C’est aussi faute de contrôle public s’il n’y a pas plus d’embauche dans le bâtiment, et s’il y a 450 000 « travailleurs détachés », en dépit du droit français. Les « majors » du BTP s’enrichissent, tous chantiers confondus, dans une cascade de sous-traitances, qui nuit à l’emploi comme aux salaires, mais pas aux milliards de « marges » créés.
Doit-on parler de la grande distribution, un secteur aux profits prodigieux, qui supprime des emplois, et précarise les employés, des sous-traitants, des producteurs, et reçoit des aides du CICE, alors que ses « marges » sont infinies ?
C’est en faisant respecter les durées légales du travail en France, par exemple dans les transports routiers, qu’on créerait 40 000 emplois du jour au lendemain avec le même volume de fret : les disques de contrôle existent, il ne manque que les contrôleurs du travail, ils coûteraient moins cher, seraient efficaces et permettraient même de « taxer » la pollution des gros « poids lourds », sans recourir à des portiques provocateurs inutiles et coûteux.
C’est aussi faute de contrôle s’il y a un milliard d’heures supplémentaires non déclarées, non payées, non majorées, et c’est l’équivalent approximatif de 600 000 emplois. On voit même ainsi, de façon provocatrice, qu’à l’intérieur même du pays, il y a des marges de manœuvres considérables si, au lieu de céder au Medef sans contreparties, on impose une politique d’emploi, de contrôle des entreprises, de réduction du temps de travail, d’interdiction de la précarité, de partage des salaires et des richesses !
Et Airbus qui dispose d’un carnet de commande sur 10 ans de 10 milliards d’euros et qui supprime 1134 emplois ? S’il y avait un contrôle public des licenciements boursiers et abusifs de ce type tout en imposant une réduction du temps de travail à 32 h nous sauverions des millions d’emplois.
Et le contrôle public sur ces grands groupes sauveraient des vies humaines par milliers : car PSA imite Volkswagen, Fiat-Chrysler et triche, truque, fraude scandaleusement avec ses pots d’échappement sachant pourtant que les « particules fines » tuent 48 000 personnes par an chez nous.
Mais évidemment cela aurait un résultat, c’est la baisse des fameuses « marges », des dividendes dont les patrons et les actionnaires sont si friands au détriment de toute la vie de nos concitoyens.
Même les recommandations du « Conseil de la Commission européenne » concernant le « programme national de réforme de la France pour 2017 » et « portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de la France pour 2017 » daté du 22 mai 2017 ne formule pas autant d’exigences contre le Code du travail que n’en formule le Medef et n’en envisagent les « Ordonnances Macron » de l’été 2017.
Et chacun sourira en sachant que le Code du travail allemand est plus « gros » (1,7 kg) que le code du travail français, que les conseils d’administration en Allemagne sont composés à 50 % de salariés, que le seuil de déclenchement pour les délégués du personnel est à 5 outre-Rhin et pas à 11 comme en France, ou bien que l’intérim y est interdit dans le bâtiment pour raisons de sécurité.
Pour s’en sortir en France en matière d’emploi, il ne faudrait pas moins de lois ni moins de contrôles, il en faudrait davantage.
Il est trop facile souvent de remettre les responsabilités sur l’Union européenne et sur la mondialisation, alors que c’est le patronat français « bien de chez nous » qui est à l’origine de nos maux. Les 9 millions de citoyens en dessous de 900 euros, le salaire médian à 1700 euros, les 6,6 millions de chômeurs toutes catégories confondues, c’est un mal français qui peut en partie se résoudre, avec une politique adaptée conduite ici même.
C’est en cela que l’absurdité politique, économique, juridique, sociale, est tout entière dans la poursuite acharnée, aggravée, entêtée, par Emmanuel Macron des lois El Khomri, Rebsamen, Sapin, Bertrand, Larcher, Fillon, et de la « recodification » voulue par le Medef depuis sa « refondation » de 1999-2001.
Cela fait 15 ans que le Medef veut une sorte de revanche réactionnaire contre ce qui est issu de la Seconde Guerre mondiale, du programme du Conseil national de la résistance, des « Jours heureux ».
Depuis la démission sur le perron de l’Hôtel Matignon le 10 octobre 1998, de Jean Gandois, alors président du CNPF, ils avaient annoncé une « guerre contre les 35 heures » et promis de nommer « des tueurs a la tête du Medef » pour la mener. Ces tueurs ont été le baron Ernest-Antoine Seillière, Laurence Parisot, puis Pierre Gattaz, mais ils mènent, pensent-ils le combat final contre le Code du travail, grâce à leur nouveau poulain, Emmanuel Macron. Tout pourrait se résumer dans l’article 1 la loi El Khomri : c’est celui qui remet en cause historiquement, théoriquement, juridiquement, fondamentalement un siècle entier de code du travail.
5. Droit du travail et droits humains
Le code du travail est né en 1910 après la catastrophe de Courrières du 10 mars 1906 dans le Pas-de-Calais. Lors de cette tragédie, 1099 mineurs avaient perdu la vie au fond des puits. La veille, le patron avait été mis en garde par un agent de sécurité, un feu couvait dans les galeries, il n’en a pas tenu compte. Le lendemain, le patron a exigé la reprise du travail sans recherche s’il y avait des survivants. Le 30 mars, 14 mineurs abandonnés a leur sort, sont ressortis, pourtant, par leurs propres moyens des galeries. Le choc émotionnel « plus jamais ça » avait été tel qu’on avait décidé de créer le Ministère du travail pour qu’il échappe aux exigences du Ministère de l’économie.
Aussi, lorsque le Président Hollande annonça en septembre 2015 qu’il allait « adapter le droit au travail aux besoins des entreprises », c’était une contre-révolution conceptuelle. Elle n’avait rien de « moderne » et rien à voir avec la « crise » : c’était le retour au XIXe siècle, bien avant 1906, aux débuts du salariat post-esclavage, quand il n’y avait ni lois ni cotisations sociales.
Ca n’a rien à voir non plus avec l’emploi : François Hollande l’avoua le 21 février 2016 en précisant que cette loi « n’aura pas d’effets en termes d’emploi avant plusieurs mois. Mais il s’agit d’installer un nouveau modèle social » Il ne pouvait mieux reconnaître que le chômage était un prétexte.
Cent ans durant, le Code du travail a été construit pour que les droits des humains au travail échappent aux exigences aveugles du marché, de la rentabilité, de la compétitivité.
En fait, les lois du travail sont – et doivent rester – universelles en ce qu’elles sont attachées aux droits humains, quelle que soit la taille de l’entreprise, sa spécificité, sa branche. Elles doivent l’emporter sur les « contrats », sur les « accords », sur les « dérogations », les « exceptions » et non pas l’inverse. C’est ce qui est garanti par la Déclaration des droits de l’homme de 1948, par la charte européenne des droits fondamentaux des humains de 1999, par des conventions de l’OIT comme les n° 81 ou 158.
S’il existe une « Organisation internationale du travail », c’est pour que ces droits humains s’étendent universellement et non pas pour qu’ils soient rabougris, de dérogation en dérogation, au niveau des besoins de chaque employeur, entreprise par entreprise.
En résumé, par la loi El Khomri et les ordonnances Macron, le choix fondamental est dorénavant d’adapter les humains à l’entreprise et non plus les entreprises aux humains. C’est la lutte des classes entre le salariat et l’actionnariat. Le salariat est attaqué puissamment et se voit dans l’obligation d’agir tout aussi massivement.
Notes
[1] Le salaire brut inclut le salaire net et les cotisations sociales dites salariales ; le salaire super-brut inclut en plus les cotisations sociales dites patronales. L’ensemble des cotisations sociales constituent le salaire socialisé.
À propos de l’auteur
Gérard Filoche est un ancien inspecteur du travail, syndicaliste et militant de la gauche du Parti Socialiste (D&S).