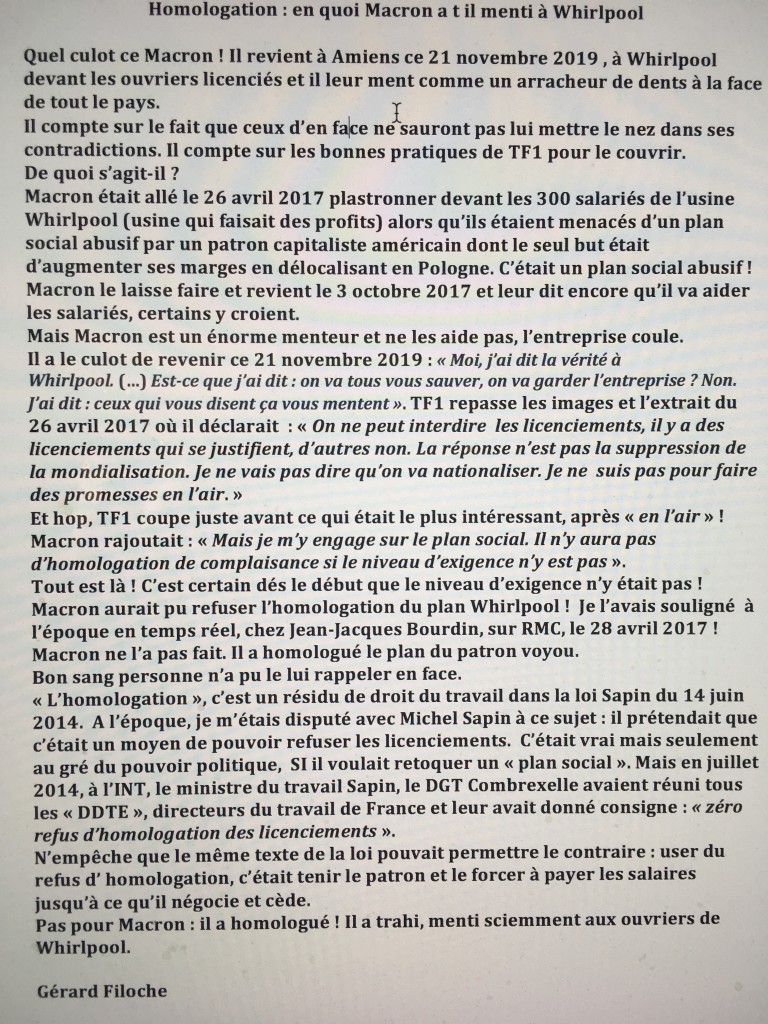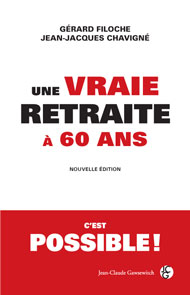C’était le titre le plus neutre en « une » que le Monde avait trouve en fin octobre 2003 ! Ce jour-là, en 2003, l’armée bolivienne avait tiré à la mitrailleuse lourde contre une manifestation de paysans – faisant autour de cent morts…
Ce fut la cause de la chute précipitée du président de grande coalition libérale droite-gauche, le « socialiste » De Lozada obligé de partir se réfugier avec toute sa famille à Miami… laissant son second, Carlos Mesa essayer de privatiser à son tour, entre 2004-2005, les immenses ressources de gaz naturel récemment découvertes.
Résistant victorieusement en dépit de toutes les pressions, de tous les pièges, en trois ans de lutte sociale, le peuple bolivien a repris son avenir en main contre les multinationales Bechtel, Trade Development Agency, Repsol-YPF, British Gas, BP Amoco, Exxon, transnationales qui forment le groupe « Pacific LNG » mais aussi contre Suez, la Lyonnaise des eaux, Vivendi.
C’est un des rares triomphes dans le combat anti mondialisation.
Carlos Mesa soutenu par le monde libéral entier, a perdu à son tour le 6 juin 2005.
C’est le 18 décembre 2005 que la gauche, le « Mas », l’indien aymara Evo Morales, fait sans précédent, l’emporte nettement aux élections présidentielles… C’est une révolution plus grande et plus forte que toutes les anciennes tentatives guérilleristes (cf. tome 1) qui ont si longtemps ruiné l’avant-garde sociale de ce petit pays de 9 millions d’habitants.
Cela tranche, pour moi, des années de débat théorique, avec des vies en jeu, sur la lutte armée en Amérique latine. Finie la théorie du « foco », de la guerre révolutionnaire sans parti ni syndicat, de la « collecte pour des armes en Bolivie en 1971 », du « texte 30 » de Daniel Bensaïd, oui, il était possible de gagner comme les indiens en Bolivie viennent de le prouver, bien sur, ce n’est pas le socialisme, mais des pas concrets en avant, oui.
Mais il y a peu de chances qu’on nous permette de comprendre, en France, ce qui se passe là-bas : aucun média ne semble prendre la voie de la réflexion sur ce qui avance en commun au Venezuela, en Equateur, en Argentine, au Chili, en Uruguay, et en Bolivie…
Le « Monde » du 25 décembre 2005, recommence 2003 et présente en 2005, les choses ainsi : « En Bolivie, le pouvoir sera bientôt entre les mains des cocaleros (cultivateurs de la feuille de coca) ». Calomnie, mépris de classe.
Pourquoi occulter, dénaturer ce qui se passe ainsi en Bolivie depuis des années ? C’est parce chaque bataille sociale de ce petit pays pauvre nous concerne : elle concerne la lutte contre la mondialisation libérale, pour des services publics, pour les retraites, l’eau, le gaz…
gerard filoche en 2003 (repris dans mon tome 2, a paraitre en mars 2020)
In Le Monde,
2003 : «La Bolivie change de président»
2005 : « Les cocaleros au pouvoir… »
Mais en fait, le mouvement social antilibéral bolivien est fantastique ! Il combat la mondialisation libérale. C’est un exemple et un espoir pour nous aussi en Europe.
« La Bolivie change de président » c’était le titre neutre en « une » du Monde fin octobre 2003 ! (« plus inodore, tu meurs… » nous l’avions dénoncé dans D&S n°109 octobre 2003 ) Ce jour-là, en 2003, l’armée bolivienne avait tiré à la mitrailleuse lourde contre une manifestation de paysans- faisant autour de cent morts… Ce fut la cause de la chute précipitée du président de grande coalition libérale droite-gauche, De Lozada obligé de partir se réfugier avec toute sa famille à Miami… laissant son second, Carlos Mesa essayer de privatiser à son tour, entre 2004-2005, les immenses ressources de gaz naturel récemment découvertes.
Résistant victorieusement en dépit de toutes les pressions, de tous les piéges, en trois ans de lutte sociale, le peuple bolivien a pris son avenir en main contre les multinationales Bechtel, Trade Development Agency, Repsol-YPF, British Gas, BP Amoco, Exxon, transnationales qui forment le groupe « Pacific LNG » mais aussi contre Suez, la Lyonnaise des eaux, Vivendi.
C’est un des rares triomphes dans le combat anti mondialisation libérale.
Carlos Mesa soutenu par le monde libéral entier, a perdu à son tour le 6 juin 2005.
Le 18 décembre 2005 la gauche, le « Mas », l’indien aymara Evo Morales, fait sans précédent, viennent de l’emporter nettement aux élections présidentielles… C’est une révolution plus grande et plus forte que toutes les anciennes tentatives guérilleristes qui ont si longtemps ruiné l’avant-garde sociale de ce petit pays de 9 millions d’habitants.
Mais il y a peu de chances qu’on nous permette de comprendre, en France, ce qui se passe là-bas : aucun média ne semble prendre la voie de la réflexion sur ce qui se passe de commun au Vénézuela, en Equateur, en Argentine, au Chili, en Uruguay, et en Bolivie…
Le « Monde » du 25 décembre 2005, recommence 2003 et présente en 2005, les choses ainsi :
« En Bolivie, le pouvoir sera bientôt entre les mains des cocaleros
(cultivateurs de la feuille de coca) »
Pourquoi occulter, dénaturer ce qui se passe ainsi en Bolivie depuis des années ? On va le voir, ci-dessous, c’est parce chaque bataille sociale de ce petit pays pauvre nous concerne : elle concerne la lutte contre la mondialisation libérale, pour des services publics, pour les retraites, l’eau, le gaz…
Bolivie :
Superficie : 1 099 milliers de km2
Population : 8,5 millions (2001)
PNB : 8,1 mds de dollars (2001)
PNB/hab : 950 dollars (2001)
Croissance : 1,2 % (2001)
Budget. Education : 4,9 % du PNB
Service de la dette : 31,1 % des exportations
Mortalité infantile : 60 pour mille naissances
Espérance de vie : 63,1 ans
Indice de Développement Humain : 114e rang mondial sur 173 pays
IPF : 55e rang mondial sur 173 pays
Budget Défense : 300 millions de dollars (2001)
Armée : 31 500 actifs
Encart :
Le gaz vient d’être partiellement privatisé en France. Ses prix ont augmenté de 4 % et il est envisagé jusqu’à 13 % de hausse et 6 000 emplois en moins pour complaire aux nouveaux actionnaires. Le coût du gaz et l’électricité augmenteront davantage au détriment des usagers français comme cela a été le cas, avec fraude spectaculaire aux fameux principes de la « concurrence » pour le téléphone. Les salariés d’Edf-Gdf se verront reprendre leurs acquis, leurs retraites, leur compagnie se lancera dans des spéculations, le service public régressera. Tout le monde le sait : mais les libéraux n’ont que faire de l’intérêt général, et ne sont guidés que par le profit maximum immédiat, sans plan, ni vision à long terme.
Voilà ce que les boliviens espèrent s’épargner, en contrôlant leurs ressources hydrocarbures, leur exploitation, en empêchant le pillage pour le compte des multinationales.
Ce combat là-bas est le notre !
Le trésor du gaz : privé ou public ?
La Bolivie, deux fois grande comme la France, était dirigée depuis toujours par une infime minorité blanche, secouée de coups d’état permanents, malmenée par vingt ans de dictatures brutales et corrompues, et autant de réformes néolibérales qui ont fermé les mines d’étain, ruiné les paysans, détruit retraites et systèmes sociaux, accru les inégalités. Deux tiers des Boliviens vivent sous le seuil de pauvreté, plus de la moitié des habitants n’ont pas accès à l’électricité, ni à l’eau.
Mais une découverte fabuleuse a tout changé depuis 1997 : d’immenses gisements de gaz naturel (deuxième en Amérique latine) ont été identifiés et peuvent faire sortir ce pays de l’ornière, à condition, bien sûr, d’être exploités dans l’intérêt collectif des boliviens. Les multinationales américaines, britanniques et françaises se sont ruées sur ces nouvelles ressources et ont entrepris de s’en emparer, déclenchant en retour un soulèvement populaire, profond, répété, conscient de l’importance de les conserver au service de tout le peuple…
C’est cette volonté populaire qui vient, en trois ans, de gagner dans les rues puis dans les urnes, c’est un mouvement profond et mûr qui vient de loin (cf. chronologie ci-jointe) : il a conduit de multiples combats pour défendre les mines d’étain, les retraites, l’économie mixte, les « guerres de l’eau », et maintenant les hydrocarbures, les deux « guerres du gaz »…
Il a résisté en 2003 à une sanglante répression, et depuis, il a chassé deux « présidents », gagné un référendum, et enfin la présidentielle. Ils savent dire « non » quand il faut, cela devrait plaire aux français !
La prochaine conquête – une vraie assemblée constituante – pourrait être décisive.
D’autant qu’une Bolivie rompant avec le modèle néolibéral disposerait d’atouts non négligeables en Amérique latine actuelle. Lula et Chávez ne cachent pas leur sympathie pour le Mas. Le Brésil – qui importe bonne part du gaz bolivien – et le Venezuela seraient des partenaires de choix pour développer ce secteur. Evo Morales, se rend vendredi 30 décembre 2005 à Cuba pour son premier voyage à l`étranger. De chez Fidel Castro, le futur président Morales se rendra ensuite dans plusieurs pays européens, notamment la France et l`Espagne. Il ira ensuite en Afrique du Sud, où il rencontrera l`ancien président et prix Nobel de la paix Nelson Mandela. A compter du 13 janvier, il se rendra aussi au Brésil, avant d’entrer en fonction le 22 janvier 2006.
La soif d’hydrocarbures des économies capitalistes peut les amener à composer avec le nouveau pouvoir d’Evo Morales dans le but de l’affaiblir, de le diviser, de la corrompre. Déjà les multinationales pilleuses annoncent plaintes et procès, sabotages aussi. Un boycott du type de celui subi par Cuba peut-il se produire ? L’exemple vénézuélien témoigne que ce n’est pas si facile : l’’or noir fait sert de boussole idéologique à la politique Bush. Mais de Quito à Santiago, Buenos Aires, Caracas, une ère nouvelle s’ouvre, menaçante pour les chefs Etats-uniens, et l’histoire a démontré qu’ils étaient capables de tout depuis très longtemps pour maintenir leur « ordre » en Amérique latine, coups d’état, assassinats, blocus, sabotages…
Evo Morales et Alvaro Garcia Linera, Felipe Quispe, le Mas et le Mip, Jaime Solares et la Cob :
« Evo » Moralés est un Aymara des haut-plateaux andins, il a grandi parmi les indigènes quechuas et les petits Blancs du Chapare tropical, il est né à la lutte sociale parmi les paysans, déjà député. Il était déjà arrivé deuxième de la présidentielle de 2002 avec 21 % des voix. Il symbolise l’espoir de tous les laissés-pour-compte du pays. L’immense majorité est d’origine amérindienne et habite la campagne où les immenses banlieues des grandes villes, principalement dans l’ouest du pays. Ce sont eux qui ont chassé les présidents Gonzalo Sanchez de Lozada en octobre 2003 et Carlos Mesa en juin 2005. Au grand dam des 20 % de Boliviens qui se partagent la moitié du revenu national, regroupés, eux, au coeur de La Paz et dans les provinces de l’est (qui menacent artificiellement de sécession). Evo Morales, cultive les valeurs amérindiennes, tout en portant ses vieux t’-shirts du « Che » : on le dit radical, pragmatique, têtu, à l’écoute des masses, hostile à l’ingérence étasunienne et avec le Mas, il a bénéficié, du discrédit des partis traditionnels dont certains sont liés aux nôtres, en France.
Majoritaire au Parlement arbitre du deuxième tour, la droite est divisée. Déjà la coalition qui avait fait tirer à la mitrailleuse lourde sur les manifestations d’octobre 2003 rassemblait tout ce qui était haï et vient d’être chassé. Au point que l’ex-président « Tuto » Quiroga, battu le 18 décembre avait dû s’inventer un nouveau parti « Podemos » (« Nous pouvons ») pour faire oublier son appartenance à l’Action démocratique de… l’ex-dictateur Hugo Banzer. Troisième avec moins de 10 %, l’entrepreneur « centriste » Samuel Doria Medina a déjà assuré Evo Morales de son soutien (à double tranchant),au vu de son avance en voix.
Même le commandant en chef de l’armée appelle les futurs députés à élire le vainqueur du premier tour ! L’amiral Marco Antonio Justiniano sait trop bien qu’un résultat contraire pourrait déboucher sur une grave crise sociale. Face à un Parlement présumé hostile et aux velléités sécessionnistes des riches provinces de Santa Cruz et de Tarijá, la tâche d’un éventuel gouvernement du MAS ne sera donc pas aisée. Le Parlement étant acquis à ses adversaires, Evo Morales ne peut, dans un premier temps, compter que sur la pression populaire. Morales dispose du soutien des organisations de base, syndicats et associations boliviens même si la direction de la Centrale ouvrière (COB), (mineurs), et le Mouvement indigène Pachakuti, dirigé par Felipe Quispe, sont des partenaires conflictifs face à l’hégémonie du MAS.
La COB, dirigée par Jaime Solares, est la plus radicalement engagée dans ce combat pour la nationalisation du gaz. C’est une réapparition de la COB au premier plan de la vie politique bolivienne dans les deux dernières années celle-ci semblant s’être remise de l’affaiblissement numérique qu’ont entraîné les réformes brutales de 1985. Un des éléments permettant d’analyser ce phénomène réside sans doute dans la nouveauté que constitue l’arrivée à la tête de la centrale d’une direction combative, d’autant plus émancipée des enjeux d’appareils politiques que la gauche « politique » n’a plus qu’une existence embryonnaire
En soutien aussi : la centrale syndicale de travailleurs paysans de Bolivie (CSUTCB), le Conseil national des ayllus et Margas (CONAMAQ), les centrales syndicales des peuples indigènes de l’est de la Bolivie, le Mouvement des sans-terre, l‘Assemblée du peuple Guarani, la Fédération des Juntas Vecinales de El Alto (FEJUVE), et des centaines de syndicats paysans de toute la Bolivie La fameuse Coordinadora del Agua de Cochabamba de la « guerre de l’eau », se dit prête,à faire bloc derrière un gouvernement du MAS. Le sociologue et ex-guérillero Alvaro García Linera qui figure sur le ticket présidentiel d’Evo Morales incarne un rapprochement avec les cercles progressistes urbains.
En fait, comme au Vénézuela, le « ménage » peut être fait : proposant de créer une nouvelle démocratie, par la convocation d’une Assemblée constituante, Evo Moralès et le Mas, et le « Mouvement indigène Pachacuti » (Mip) de Felipe Quispe peuvent rénover toute la vie politique bolivienne, redonner la place majoritaire qu’ils méritent aux amérindiens. L’idée de la future assemblée constituante a été largement accepté lors de la crise de juin 2005. A l’instar d’Hugo Chávez lors de son premier mandat à la tête du Venezuela, Evo Morales espère y puiser la légitimité pour transformer en profondeur les institutions. Une « Révolution politique » ou une « décolonisation de l’Etat », selon les termes de l’intellectuel sociologue García Linera, vice-président d’Evo Morales.
Un programme pragmatique :
Théoricien du Mas, Garcia Linera se veut pragmatique : nationaliser les hydrocarbures comme l’ont exigé les citoyens l’an dernier par référendum. Avec les immenses profits escomptés – les exportations de gaz représentent 10 % du produit intérieur brut (PIB) bolivien – l’Etat renforcé devrait « articuler » les trois types de production coexistant en Bolivie, à savoir les économies communautaire, familiale et industrielle. Un équilibre en mouvement, que le sociologue appelle « capitalisme andin-amazonique ». Parmi les projets concrets, il est question de la création d’une banque des technologies, du développement du micro crédit, une loi de promotion des petites et moyennes entreprises (PME) et des coopératives, un plan de lutte contre la spéculation foncière et la titularisation des terres communautaires. Le ticket Morales-Linera propose aussi un système de sécurité sociale de santé, la légalisation et l’assainissement des quartiers périurbains (bidonvilles) et une réforme scolaire garantissant la gratuité, l’égalité de genre et la pluriculturalité.
Pour tout cela, le MAS mise sur les revenus des hydrocarbures et une fiscalité progressive, mais également sur un Etat frugal dans son fonctionnement. Déjà lourdement endettée, la Bolivie perdra les millions versés chaque année par Washington ainsi que les appuis du Fmi, de la Banque mondiale. Le système est tellement « pourri » internationalement (genre projet de constitution Giscard pour l’Europe) qu’il permet de multiplier les procès au nom de la « protection internationale des investissements ». C’est ainsi que les multinationales ont fait procès pour l’eau à Cochabamba et à El Alto. Il faudra aussi que l’Etat trouve les fonds pour développer les infrastructures gazières
Comme au Venezuela, la gauche pourrait aussi être victime de la fronde sans foi ni loi des élites économiques et technocratiques, promptes à saboter un gouvernement défavorable à leurs intérêts. A contrario, le mouvement social possède trop peu de cadres…
Enfin, la droite agité récemment l’hypothèque du séparatisme des riches provinces orientales. Après avoir profité durant des décennies des bénéfices miniers pour développer leur région, les élites de Santa Cruz et Tarija ne veulent plus entendre parler de solidarité nationale. Malgré l’appui croissant des indigènes guaranis à Evo Morales, les plaines de l’Est font figure de refuge pour les clans bourgeois hostiles.
Malgré ces périls, un changement en profondeur de la Bolivie est désormais possible. Le courant progressiste incarné par Evo Morales est fortement structuré, pacifique malgré la répression, s’appuyant sur une base aussi lucide politiquement que parfois incontrôlable, le mouvement social bolivien n’a pas jeté les transnationales Bechtel de Cochabamba et Suez d’El Alto ainsi que deux présidents en moins de cinq ans par hasard ! Ce n’est pas la vieille théorie finalement exangue, de la « lutte armée », ni celle du « foco » guevariste qui comptera mais la prochaine conquête – une vraie assemblée constituante – pourrait être décisive.
Gérard Filoche
Autre article :
(reprise actualisée de D&S n° 108 d’octobre 2003, vous savez la revue mensuelle, 14° année, qui ne parle pas que du droit social français)
Chronologie d’une longue lutte sociale :
De la destruction des mines d’étain aux champs de « coca » :
Le peuple bolivien sait depuis plus de vingt ans de quoi les libéraux sont capables.
Les entreprises publiques boliviennes ont été démantelées à partir de 1985, par le gouvernement de M. Victor Paz Estenssoro qui a promulgué le décret n° 21060, par lequel la Bolivie passait « d’une économie mixte de régime étatique à un néolibéralisme dur et orthodoxe ». A la Corporation minière de Bolivie (Comibol), plus de 20 000 mineurs de l’étain ont été licenciés. Ils n’ont eu d’autre choix que de migrer vers le Chapare et opter pour la seule voie possible : la culture de la feuille de coca.
Les Usa ont alors entrepris d’interdire ces « cultures illicites » dans le Chapare vers la fin des années 1980. Après avoir chassé les ouvriers de leur travail, ils traquaient les paysans qu’ils étaient devenus par la force des choses. Le président de cette époque, Jaime Paz Zamora (1989-1993) refusa de pénaliser la fameuse « coca ». Revendiquant une compréhension historique et souveraine du problème, il organisa la « diplomatie de la coca », sous le slogan « la coca n’est pas la cocaïne ». Cela lui valut d’être durement attaqué par l’ambassade Us. Plusieurs des dirigeants de son parti, le Mouvement de la gauche révolutionnaire (MIR), furent traînés en justice. L’un d’eux, M. Oscar Eid, passa quatre ans en prison pour des liens supposés avec le « narco-trafic », et Paz Zamora lui-même se vit retirer son visa pour les Etats-Unis.
Privatisation des retraites :
Pendant toutes les années 1990, l’ambassade Us organisa des plans divers et variés d’éradication de la coca, auxquels seuls les paysans résistèrent. Le plan » Dignité » dicté par les États-Unis, en 1997, réduisit les plantations de coca de 48 000 à 14 000 hectares, soit un manque à gagner pour le pays de 500 millions de dollars au détriment des «cocaleros», qui sont pour la majorité des anciens mineurs reconvertis par nécessité.
Rien n’a remplacé leur unique source de revenu, dans une campagne où 80 % de la population est sous le seuil de pauvreté.
Le déficit budgétaire, qui était cantonné à 1,9 % du Pib en 1996, devrait atteindre 9,5 % en 2003. Le ralentissement économique qui a frappé toute l’Amérique latine a alors été fatal : les exportations boliviennes, constituées exclusivement de matières premières (soja, zinc, or, plomb, bois et sucre) dépendent des cours mondiaux. Les dévaluations du peso argentin et du réal Brésilien ont ré apprécié artificiellement le boliviano, et diminué d’autant les exportations.
Comme en Argentine, et comme les libéraux l’exigent partout, les retraites ont alors été privatisées. Le basculement d’un système de retraites par répartition à la capitalisation a été catastrophique : le Trésor public n’a plus perçu les cotisations des salariés, reversées brutalement à des fonds privés, mais il a été obligé de continuer à payer les pensions issues du régime antérieur. Résultat: le poids des retraites dans le produit intérieur brut est passé de 3,4 % à 5,1 % en 2003 ! Échec là aussi des fonds de pension !
À la différence des années 1990, le gouvernement ne peut plus compter sur les recettes des privatisations – tout a été vendu – pour se financer. Cette asphyxie financière a poussé l’État, au mépris des résistances populaires, à accélérer le projet d’exportation des nouvelles nappes de gaz naturel qui venait d’être découvertes via le Chili plutôt que par le Pérou sous contrôle de la multinationale Bechtel (liée au vice président états-uniens Dick Cheney)
Le libéralisme n’a fait que ruiner la Bolivie, paysans, employés et ouvriers l’ont appris à leurs dépens et y résistèrent… C’est au travers de cette résistance émergea la figure de M. Evo Morales, dirigeant du Mas (Mouvement vers le socialisme).
La « guerre de l’eau » :
Un important épisode de la résistance antilibérale a été la « guerre de l’eau » comme l’ont appelé les médias, et à laquelle ont participé les habitants de La Paz et de Cochabamba. En avril 2000, les habitants de Cochabamba, regroupés dans la Coordination de l’eau, s’étaient soulevés contre l’entreprise Aguas del Tunari (filiale de la transnationale Betchel), qui gérait depuis 1999 l’eau potable de Cochabamba et y appliquait un tarif usuraire. Dans une ville où le salaire minimum est moins de 100 $ par mois, la facture d’eau mensuelle s’élevait à 20 $ ! Il y eut de violentes manifestations dans les rues. Le gouvernement envoya les troupes et fit un mort, mais le peuple de Cochabamba finit par imposer sa volonté et gagna la reprise en main de la compagnie d’eau (dettes comprises).
Mais après la rupture du contrat le 10 avril 2000, Bechtel a demandé au CIRDI, une des annexes de la Banque Mondiale, de lui accorder un dédommagement de 25 millions de dollars pour son manque à gagner potentiel. Ce que seule une mobilisation internationale a permis de justesse d’éviter.
A La Paz, l’eau est alors passée dans les mains de la Lyonnaise des Eaux et il en était résulté une nouvelle flambée des prix de 2 à 12 bolivianos le mètre cube, une détérioration du service, les règles minimales d’hygiène ont encore moins été respectées : réduction de personnels, maintenance limitée, le quartier populaire d’Alto Lima n’était presque plus desservi. C’était devenu un luxe, vu le coût de l’installation (augmenté de 50 %) d’avoir de l’eau à El Alto. Le Pdg français, Arnaud Bazire osait se plaindre des « mauvais consommateurs » qui ne payaient pas ! « Ils nous parlaient de nouveaux équipements, ils ont juste repeint les tuyaux en blanc » disait un des ouvriers d’entretien de l’époque. A Tucuman en Argentine, c’était Vivendi qui avait augmenté les tarifs de 104 %, avant d’être contraint de quitter la province par la population. (d’après Le Monde diplomatique, Franck Poupeau, mai 2002)
Naissance d’une nouvelle gauche :
Des organisations composées principalement de syndicats paysans, de la Coordination de l’eau, d’organisations non gouvernementales et de « sans-terre » ont réussi à faire reculer, à plus d’une occasion, les mesures du néolibéralisme orthodoxe.
Un leader aymara Felipe Quispe, au début des années1990, avait pris la tête de l’Armée de guerilla Tupac Katari (EGTK), dans l’Altiplano : en 1992, ses principaux dirigeants furent jetés en prison. Félipe Quispe a lui-même passé cinq années dans un centre de haute sécurité, mais, peu après sa sortie, il fut élu secrétaire exécutif de la Confédération syndicale unique des travailleurs de la terre de Bolivie (CSUTB). Il fonda, en 2001, le Mouvement indigène Pachacuti (MIP), à la tête duquel il a participé aux élections de juin 2002 avec le Mas d’Evo Morales (Le Monde diplomatique, Walter Chavez, mai 2003)
C’est cela, la nouvelle gauche bolivienne : ce ne sont plus des intellectuels des classes moyennes ou supérieures érigés en « guides » ou « guérillas » mais des chefs paysans et indigènes qui défendent eux-mêmes leur territoire et leurs cultures ancestrales. À la différence des mouvements de guérilla « intellectuels » et « extérieurs » des années 1960 et 1970, ils revendiquent de participer activement à la vie démocratique : ils ont une plus grande capacité de rassemblement, formulent des revendications pour la société tout entière : baisse des prix, préservation des ressources naturelles, inversion des processus de privatisation.
Aux élections du 30 juin 2002, un avertissement sévère fut lancé aux politiciens corrompus : Gonzalo Sanchez de Lozada n’avait été élu qu’avec 22 % des voix. Le « Mouvement vers le socialisme » (Mas) d’Evo Morales, et le « Mouvement indigène Pachacuti » (Mip) de Felipe Quispe avaient respectivement obtenu 20, 9 % et 6 % (en fait la majorité relative) des voix faisant entrer, pour la première fois, 41 députés indiens et paysans, au Parlement où il a fallu – enfin – reconnaître les langues indiennes – l’aymara (2,5 millions d’indiens le parlent), le quechua et le guarani.
Tous les frères ennemis de la classe politique traditionnelle n’avaient pas hésité à constituer un seul bloc composé du MNR, du MIR, (la « gauche » ! Les socialistes… ) de l’Union civique solidarité (UCS) et du Mouvement Bolivie libre (MBL) soumis aux diktats du Fonds monétaire international pour barrer la route à cette nouvelle gauche du Mas et du Mip. Evo Morales (Mas) aurait pu être élu sans cette coalition menée par un parti membre de l’Internationale Socialiste corrompu jusqu’à la moelle (tout comme son jumeau vénézuélien).
C’est ce « bloc » qui avait mis en place le futur assassin Gonzalez Sanchez de Lozada lequel devait gouverner jusqu’en 2007 s’il n’avait pas mitraillé son peuple avant de s’enfuir vivre mieux en Floride…
Les libéraux et sociaux-libéraux à la mitrailleuse lourde :
Le dimanche 12 octobre 2003, l’armée a tué les gens descendus des hauts de La Paz, comme des chiens… Toute la journée, le « blco » autour de Lozada a fait tirer sans sommation sur tout ce qui bougeait, sur des jeunes jouant au foot comme sur ceux qui manifestaient. Avec des chars et des mitrailleuses lourdes.
65 ou 94 morts selon les sources, des centaines de blessés qui valurent 20 secondes au JT en France. Personne ne s’indigna dans le Monde, ni aux Usa, ni en Europe.
Au nom de l’Union européenne le jeudi 16 octobre, le chef de la diplomatie italienne Franco Frattini s’était contenté d’appeler « toutes les parties à arrêter la violence » renvoyant dos-à-dos massacreurs et victimes.
Le Quai d’Orsay déclarait encore le 17 octobre, alors que les fusillades étaient quotidiennes : « La France, avec l’ensemble de ses partenaires européens, réaffirme son soutien au gouvernement bolivien, démocratiquement désigné, dans ses efforts pour trouver une solution pacifique et constitutionnelle à la crise actuelle. »
Pourquoi ce gouvernement « pacifique et constitutionnel » massacrait-il ?
Il fallait lire entre les lignes ds rares articles internationaux pour le savoir : parce que les libéraux boliviens voulaient privatiser le gaz.
La Bolivie, 114 ° rang mondial dans l’indice de développement humain, 8,7 millions d’habitants, s’étant soudainement révélée la 2° réserve de gaz en Amérique latine, après le Venezuela, les dirigeants voulaient passer par le Chili (ce qui semblait plus coûteux que par le Pérou) pour écouler leur larcin vers les Usa.
La majorité des Boliviens refusaient que les recettes du gaz aillent aux groupes pétroliers sans bénéficier à la population déshéritée touchée à 12 % par le chômage. Des manoeuvres douteuses avaient été démasquées, en cette période, quand le gouvernement avait demandé à l’entreprise Intec de procéder à une étude « impartiale » sur les conditions permettant à la Bolivie d’exporter ce gaz en Californie. Des chercheurs indépendants avaient découvert qu’Intec, financée à hauteur de 386 000 dollars par l’agence américaine Trade Development Agency était non seulement associée à la multinationale Bechtel, mais avait également des liens avec Repsol-YPF, British Gas et BP Amoco, transnationales du groupe « Pacific LNG ». (D’après Walter Chavez, Le Monde diplomatique)
Bechtel était la même compagnie choisie pour la privatisation catastrophique de l’eau de la province de Cochabamba en 1999. Son chiffre d’affaire d’environ 13 milliards de dollars dépasse le PIB de la Bolivie (8 milliards de dollars). Cette même compagnie, en cour à Washington, au sein de laquelle on retrouve Georges Schultz, l’ancien secrétaire d’état de Ronald Reagan, a bénéficié du premier contrat de 680 millions de dollars pour la reconstruction de l’Irak.
Son économie étant pillée par ce genre de multinationale, la croissance bolivienne entre 1995 et 2003 avait été ramenée d’un taux de 5 % à 1 %.
75 % des 8,7 millions de Boliviens vivaient dans une très grande pauvreté. Les 20 % les plus riches -essentiellement les Blancs et les métis – accaparaient 54 % de la richesse nationale tandis que les 20 % les plus pauvres n’avaient que 4 % de cette richesse à se partager. Le peuple, dés 2003, a donc manifesté à La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Patacamaya. « Le gaz nous appartient de droit, le récupérer et l’industrialiser est un devoir », scandaient les manifestants…
Washington a alors déclaré que « les Usa ne reconnaîtraient pas un gouvernement issu de la rue ».
On a déjà entendu cela. C’est toujours le même refrain.
Les deux « guerres du gaz » :
Alors, le peuple est entré en révolution. Oui, ça arrive encore. Il y a des fois où le peuple fait des révolutions, ce n’est pas un gros mot. Le président Sanchez de Lozada a donc fait tirer de sang froid à la mitrailleuse lourde du 12 au 15 octobre.
Mardi 14 octobre 2003, la grève s’est généralisée à d’autres villes que La Paz, notamment Oruro, Potosi et Cochabamba. Le lendemain, elle s’étendait au reste du pays. Deux colonnes d’environ 10 000 ouvriers et paysans, à l’appel de la COB (centrale ouvrière bolivienne), s’étaient mises en marche en direction de La Paz. Plus de 50 000 personnes sont descendues dans les rues pour réclamer la démission du fusilleur Sanchez de Losada. Des barricades ont été dressées. Cinq wagons ont été renversés. Les transports ont été paralysés par des barrages routiers.
De Lozada a réprimé encore et encore : il a même accusé sur Cnn, les manifestants d’être des « terroristes » qui voulaient installer une « narco-dictature ». Les Usa ont osé saluer son « attachement à la démocratie ». Jusqu’au bout l’ambassade Us et l’Europe ont soutenu le fusilleur.
Puis De Lozada a pris peur, s’est enfui lâchement en hélicoptère avec sa famille à Miami, laissant une lettre de démission. Le vice-président Carlos Mesa lui a succèdé.
Mais après Lozada, ce vice-président Carlos Mesa, qui a pris la place le 17 octobre 2003, et devait gouverner jusqu’au 6 aout 2007, n’a eu de cesse de continuer à forcer la main au peuple pour privatiser le gaz. Il a annoncé un referendum mais en essayant de « pipoter » la question pour que les multinationales gardent le contrôle du gaz quel qu’en soit le résultat. Il a également promis une assemblée constituante et annoncé des élections rapprochées, mais tout fait pour en différer la date… De début 2004 à juin 2005, intrigues et coups fourrés n’y purent rien…
Le 18 juillet 2004, le référendum fut organisé dans lequel plus de 70 % de Boliviens se prononcèrent en faveur de la récupération de la propriété des hydrocarbures. Au cours de l’élaboration de la nouvelle loi des hydrocarbures, qui fut approuvée finalement en mai 2005, les partis traditionnels (MNR, MIR, ADN) qui administraient le pays à l’époque de l’imposition du modèle néo-libéral et qui représentaient la majorité au Congrès, imposèrent une norme trahissant l’esprit du referendum, et qui, si elle augmentait les impôts et les royalties jusqu’à 50 %, ne récupérait pas substantiellement la propriété des hydrocarbures.
Le MAS et la CSUTCB-Loayza décident d’appeler à une marche contre la loi. Partie le 16 mai de Caracollo, et arrivée à La Paz le 27, cette initiative va en fait symboliser la radicalisation de la mobilisation en faveur de la nationalisation.
Plus de 40 000 paysans et indigènes répondent à l’appel de ces organisations. Ce succès prouvant la capacité du MAS à rassembler est pourtant mis en cause par certains syndicats de mineurs qui entreprennent de bloquer cette marche, reprochant aux fidèles de Morales de ne pas soutenir la nationalisation. Parallèlement, la situation se radicalise dans l’ensemble du pays, principalement dans l’Ouest andin, puisque dans la plupart des grandes villes telles que La Paz, Oruro, Potosi, Cochabamba et Sucre, ont lieu des grèves générales illimitées à l’appel des Centrales ouvrières départementales (CODs), se joignant ainsi aux militants d’El Alto.
Cette vague de radicalisation n’est pas sans effet sur les militants du MAS, qui, lors de l’assemblée générale tenue dans le centre de La Paz, à la fin de la marche, finissent par exiger eux-mêmes de leur direction la nationalisation des hydrocarbures, obligeant celle-ci à une unité de fait avec le reste de la gauche bolivienne. Dès lors, avec le basculement du MAS, la pression monte d’un cran, et le 31 mai, les mouvements sociaux de La Paz et El Alto encerclent la place Murillo, qui abrite les principales institutions de la République bolivienne, en dénonçant l’illégitimité du Congrès. Celui-ci ne fonctionne plus. Les parlementaires, effrayés par les mobilisations, ne veulent plus siéger à La Paz.
Divisé par la loi sur les hydrocarbures, et alors même que la tension sociale est à son comble à ce sujet, le parlement devait également trancher une autre question sur laquelle tout consensus paraît impossible : l’accord sur les dates de convocation de l’Assemblée constituante et du référendum sur les autonomies. Voulant faire preuve d’efficacité alors que le Congrès est en sommeil, Mesa prend l’initiative, le 2 juin, de promulguer un décret arrêtant au 16 octobre 2005 la date des deux.
La gauche dans son ensemble considère que les autonomies doivent être discutées au sein de la future constituante, sans quoi celle-ci n’a que peu de raisons d’être. Pour la droite de Santa Cruz, les craintes d’une mise à mal de ses intérêts liés au gaz sont confirmées, ce qui scelle sa rupture avec le président. Gauche comme droite exigent la démission de Carlos Mesa, qui finit par mettre un terme à son mandat le 6 juin.
Après un an et sept mois passés au gouvernement, de nombreuses manœuvres et faux départ, Carlos Mesa démissionna définitivement de la présidence de la Bolivie. « Je demande pardon à la patrie, de ne pas l’avoir gouvernée comme il fallait », a-t-il déclaré dans la nuit du lundi 6 juin 2005.
Des élections s’imposaient, elles viennent de donner la majorité attendue par et pour le peuple.
Pour la presse française, il s’agit deux fois d’un simple « changement de président », une histoire lointaine dans un pays pauvre. Où pousse de la « coca ».
Gérard Filoche
Projet Encart D&S 131:
Ca bouge beaucoup en Amérique latine
C’est le quatrième président latino-américain poussé dehors sous la pression de la rue depuis 1997. Les effets de la mondialisation libérale n’ont pas l’air de plaire aux peuples d’Amérique du Sud qui viennent d’élire « Lula » au Brésil et défendent Hugo Chavez au Venezuela.
L’Argentin Fernando de la Rua en 2001, le Péruvien Alberto Fujimori en 2000 et l’Equatorien Abdala Bucaram en 1997 sont ses trois prédécesseurs, écartés de leurs fauteuils par des crises économiques et sociales.
En Argentine, le président de la Rua avait présenté sa démission le 20 décembre 2001 après une semaine d’agitation sociale sévèrement réprimée avec un bilan de 27 morts, de centaines de blessés et milliers de personnes emprisonnées.
Des journées d’extrême violence avaient précédé son départ avec des pillages de supermarchés des banlieues pauvres et d’impressionnantes manifestations au son de casseroles pour protester contre la récession qui durait depuis 43 mois plaçant le pays au bord de la cessation de paiements.
La crise politique qui précipita la chute du président péruvien Fujimori le 19 novembre 2000 avait démarré trois mois plus tôt avec la révélation de cassettes vidéo montrant son bras droit le chef des services secrets Vladimiro Montesinos, en train de corrompre un député.
M. Fujimori quitta le Pérou pour participer officiellement au Forum de coopération économique Asie Pacifique (APEC) au Brunei et devait se rendre au Panama au dixième sommet ibéro-américain. Mais le président élu seulement depuis un an pour un troisième mandat préféra se réfugier au Japon, pays d’origine de ses parents, d’où il annonça sa démission par fax avant d’obtenir la nationalité nippone.
Abdala Bucaram, qui avait accédé au pouvoir en Equateur le 10 août 1996, a été destitué en février suivant par le congrès après avoir été déclaré dans l’incapacité mentale de gouverner. Il était très impopulaire pour avoir mis en place des impôts très élevés sur des services et biens essentiels.
Enfin, au Chili, le monstrueux Pinochet est promis, pour ses nombreux crimes, à un procès tardif et sans cesse remis, tandis qu’une candidate socialiste est en passe de l’emporter…