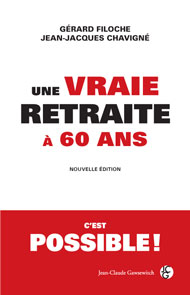Tous les samedis le pouvoir réprime plutôt que de répondre sur le fond aux revendications.
1 décès, 611 blessés dont 260 blessures à la tête, 23 éborgnés, 5 mains arrachées, 4570 Gardes à vue, 3747 condamnations, 697 comparutions immédiates, 216 personnes emprisonnés, plus de 12 000 arrestations ! Et il faut ajouter à cela une campagne de dénigrement, de calomnies, d’insultes sans précédent, un rédacteur en chef allant jusqu’à les traiter les gilets jaunes de « vermines »
…Des journalistes sont visés à Paris, à Toulouse. Les sociétés de journalistes s’en émeuvent, le secrétaire du SNJ (syndicat national des journalistes) explique : « On a rarement vu une telle répression contre les journalistes dans notre pays » (1).
Dans sa « non-allocution », intervention annulée du fait de l’incendie de Notre-Dame, Macron ne répondait pas à l’exigence de justice sociale et fiscale qui secoue le pays depuis plus de 5 mois : aucune augmentation des salaires, des pensions et des minima sociaux ! Pire, il en appelait à travailler davantage. Et voilà que depuis une semaine, les responsables macronistes reprennent les uns après les autres une vieille obsession patronale : augmenter le temps de travail sans augmenter les salaires !
Travailler mieux, moins, tous et gagner plus :
Les salariés travaillent ici autant que dans les autres pays d’Europe, n’ont pas plus de congés ou de fériés qu’ailleurs. Leurs durées réelles du travail ne sont pas plus basses. Ils sont meme les plus productifs au monde. Macron aujourd’hui comme Sarkozy hier se moquent de nous. Ce qui compte pour eux, c’est d’aider les grandes entreprises à maximiser leurs profits et museler la combativité des salariés.
Le 23 avril 1919, une loi légalisait les 8 heures de travail par jour. Aujourd’hui, avec la hausse constante de la productivité du travail, ce sont les 32 heures par semaine qui devraient être d’actualité pour donner du travail à toutes et tous, et en finir avec les temps partiels imposés. Le 1er Mai et toutes les mobilisations sociales à venir seront l’occasion de le rappeler. L’heure est au partage du travail et des immenses richesses pas à l’accumulation des fortunes ni à l’austérité avant un « ruissellement » qui ne viendra jamais.
Créer les conditions d’un sursaut
La magnifique mobilisation des gilets jaunes, et les luttes, nombreuses, se heurtent à un pouvoir politique intransigeant. Sans perspective concrète et immédiate d’alternative majoritaire, la dispersion des forces de gauche amène, selon les sondages actuels pour les européennes, à ce que trois listes de droite soient en tête : LREM, RN, LR ! Les électeurs de gauche sont désemparés, beaucoup risquent de s’abstenir. Pour ces électeurs, tous les responsables des différentes formations sont peu ou prou responsables de cette situation. Nul n’en sortira grandi ! Toutes les postures, arrière-pensées et manœuvres d’appareil ne peuvent que paraître dérisoires dans la situation actuelle.
Conscients de cette situation, les militant.e.s du réseau de la Gauche démocratique et sociale (GDS) se battent pour le rassemblement de la gauche quel que soit le nom qu’on lui donne : comité de liaison, confédération, fédération, front, union…Toute proposition dans ce sens est la bienvenue. Cela fait des mois que nous, GDS, proposons à FI, PG, PCF, EELV, Générations, PS, NPA, LO de travailler en commun. Et de le faire savoir par des actions communes.
Une partie d’EELV déclare s’éloigner à la fois de la droite et de la gauche, une autre partie reste ancrée à gauche. Le PCF est favorable à l’unité mais donne la priorité à assumer son identité. Générations parle d’unité mais se présente seul. Le PS n’est pas clair sur ses choix ni sur le rejet du bilan d’Hollande et l’association avec Glucksman, et Nouvelle Donne. LO refuse. Le NPA refuse tout en cherchant positivement les terrains d’unité d’action. Le leader de FI vient de proposer une « fédération populaire », oui bravo, ca semble un pas en avant, mais c’est présenté par-dessus et en dehors de tous les autres tout en refusant la notion de « gauche » tandis que le PG, Parti de gauche est… à gauche.
Combien de temps ca va durer ainsi ? Les salariés, les citoyens sont unitaires de façon massive. Cette unité peut passer de façon dynamique par dessus les partis, associations et syndicats existants, mais… elle ne peut pas s’en passer. Pour qu’il y ait un front populaire il faut qu’il y ait Blum et Cachin sur la tribune. Pour qu’il y ait unité il faut les preuves que la division est dépassable.
Nul ne gagnera seul. Sans unité pas de victoire possible contre Macron. Avec l’unité la gauche serait en tête aux européennes et le combat pour les revendications des gilets jaunes serait renforcé.
Unité sans exclusive à gauche, il faut d’abord débattre des convergences sur les questions sociales et écologiques. Ne pas ignorer les divergences, mais ne jamais en faire un préalable pour mener des actions en commun sur ce qui est possible. Reconstruire le meilleur programme possible entre les forces concernées, un programme de transition qui ne soit ni social libéral ni gauchiste, un programme au cœur de la gauche pas à ses marges.
Ensemble le 1 er mai ! Ensemble pour construire un front uni permanent et préparer l’après-Macron.
(1) https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2019/04/22/mobilisation-en-soutien-a-gaspard-glanz-defere-apres-une-interpellation-en-manifestation_5453511_1653578.html?fbclid=IwAR0Wn9CBoNZCzyRxB1Q15GhjggGGbmEIGYpjR1fvQmxtT-xPn6o6zB49SB8