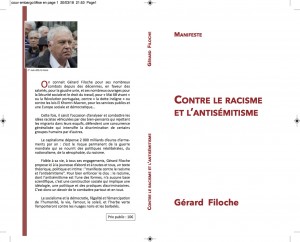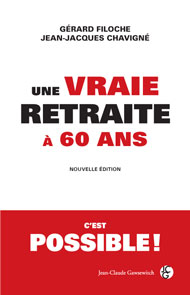Dix millions de pauvres. Ce chiffre a quelque chose de terrifiant. Et cela a commencé bien avant le Covid ! L’Insee note que la pauvreté avait déjà augmenté en 2018 alors qu’elle stagnait depuis 2014 : 14,8 % de la population vivait en-dessous du seuil de pauvreté. Sous Macron, tout s’est aggravé.
Dès 2019, le taux d’extrême pauvreté remontait en France et l’impréparation face au Covid en 2020 a rajouté des centaines de milliers ou de millions de pauvres. Dans la jeunesse notamment. Le taux de pauvreté des 18-29 ans est passé de 8 à 13 % entre 2002 et 2018 ; il fait un bond considérable encore non mesuré en 2020. Faute d’accès au RSA, les 18-25 ans sont affectés de plein fouet par la moindre baisse de revenus.
Faim
Depuis l’arrivée au pouvoir d’Emmanuel Macron, les 2 % les plus riches ont vu leur pouvoir d’achat augmenter, mais les 20 % les plus pauvres en ont perdu substantiellement, en raison du gel et de la désindexation de certains minima sociaux comme l’APL ou le RSA.
Le rapport du Secours catholique sur l’état de la pauvreté en France dès 2019 pointait du doigt la forte dégradation du niveau de vie des ménages et les choix impossibles auxquels ces derniers sont contraints pour survivre, 60 % de cas de loyers ou de factures de chauffage impayés, rupture de liens sociaux, incapacité à envisager un emploi et, de toutes façons, parmi les 300 000 SDF, un sur quatre est salarié.
Médecins du monde souligne que l’épidémie de Covid a fait éclater les inégalités de santé. Sous la pandémie, l’impréparation budgétaire, sanitaire, face au virus aggrave les inégalités sociales. Plus de 50 % des personnes en grande précarité sont infectées.
Fin 2020, plus de 10 % de la population française – soit 8 millions de personnes – a besoin de l’aide alimentaire pour subsister. Elles n’étaient que 5 millions en 2018. C’est le délégué général du Secours catholique, Vincent Destival, qui le dit dans Libération : en moins de trois ans, la politique de Macron a produit 3 millions de nécessiteux de plus.
La faim frappe 25 % de ces 10 millions de pauvres. C’est une fracture alimentaire massive : on mange des pâtes, des omelettes, on saute des repas, et ensuite on va aux Restos du Cœur quand il y en a un. Dans les quartiers populaires, la majorité des familles vivent de travail au noir, parfois de récup’ ou de mendicité, ainsi que des « aides » aléatoires des associations. La cantine, gratuite pour les familles les plus pauvres, est parfois le seul vrai repas de la journée pour les enfants quand ils peuvent y aller. Selon Ipsos, 14 % des Français sautent certains repas et 25 % se restreignent sur la quantité de ce qu’ils mangent. Chez les plus précaires – celles et ceux pour qui le revenu mensuel net du foyer s’élève à moins de 1 200 euros –, les pourcentages atteignent respectivement 38 % et 46 %. En ce moment, « on rencontre des gens qui n’ont pas mangé depuis trois jours », s’alarme Henriette Steinberg, la Secrétaire générale du Secours populaire.
Macron refuse toute hausse du RSA, alors que les associations réclament 100 euros par mois immédiatement et un RSA jeune de 18 à 29 ans. Tout juste s’il a annoncé, le 13 avril, une allocation spécifique ponctuelle de 150 euros, pour les bénéficiaires du RSA et 100 euros par enfant. Mais 36 % de celles et ceux qui sont éligibles au RSA ne le perçoivent pas !
Le 14 octobre, Macron a rajouté le versement d’une autre « aide exceptionnelle » de 150 euros par personne et un complément de 100 euros par enfant à charge pour tous les allocataires du RSA et des APL qu’il avait osé diminué au début de son funeste mandat ! Et encore 150 euros le dimanche 22 novembre. « Pour les familles avec enfants, cela peut être assez substantiel ; mais pour les autres, 150 euros, c’est vraiment l’aumône », assène Véronique Fayet, la présidente du Secours catholique. Et combien vont réellement toucher des 100 et les 150 euros ? Or, les prix augmentent : celui des légumes, de la viande, du chauffage, des loyers, jusqu’au prix des masques qui ne sont toujours pas gratuits et celui des urgences qui vont devenir payantes avec un nouveau forfait de 18 euros.
« L’effort » de Macron est resté bloqué au minimum. C’est à peine s’il a rajouté un milliard accordé aux maires pour faire face au coup par coup à la catastrophique extension de la pauvreté. Au total, le « plan de relance » de Macron (cf. D&S 278) consacre moins de 1 % de ses 100 milliards à la pauvreté.
Quid des « premiers de corvées » ?
Les familles modestes sont aussi celles que Macron avait saluées : ces métiers majoritairement féminins dits « de première ligne » : aides à domicile, femmes de ménage, caissières, aides-soignantes, assistantes maternelles, mais aussi ces cuisiniers, serveurs, chauffeurs, livreurs, agents de sécurité et d’entretien, éboueurs, cueilleurs, vendangeurs… « Quand on voit les fiches de paie des femmes de ménage en sous-traitance… Ce n’est pas digne », accuse François Ruffin.
Mais non seulement l’État ne fait rien pour les bas salaires et refuse toute hausse du Smic et des minima sociaux, mais les « primes » qu’il a parfois promises ont été aléatoires, exceptionnelles et insuffisantes. Les travailleurs de l’ombre, Macron ne les met en lumière que lorsqu’il en a besoin, mais il les éteint vite !
Un exemple ? Après avoir dans un premier temps publié un projet de loi de finances dans lequel aucune revalorisation des « aides à domicile » n’était prévue, le gouvernement a fait marche arrière, mais ce fut pour un modeste amendement proposant de verser 150 millions en 2021, et 200 les années suivantes, pour aider à revaloriser les rémunérations de ces salariés mal payés – dont le confinement a pourtant mis en évidence le caractère indispensable. A contrario, l’État refuse d’agréer l’avenant 43 signé en février 2020 entre les syndicats et les patrons de la branche associative (qui représente 60 % du secteur) et qui prévoyait 15 % d’augmentation.
Les soignants devaient toucher, depuis septembre, 182 euros de plus, au lieu des 300 euros qu’ils réclamaient légitimement. On est très loin du taux de revalorisation salarial nécessaire pour recruter dans la profession et la stabiliser.
Les salariés en chômage partiel (12,4 millions à la date du 11 mai et encore 8,4 millions en novembre) perdent 16 % de leur salaire depuis de longs mois. Cela frappe de plein fouet les capacités de vivre décemment, de survivre et d’aider ; les solidarités familiales et générationnelles en pâtissent.
Le tabou du Smic
Le Smic est déjà bien trop bas. Selon le baromètre de pauvreté du Secours populaire, « le niveau du Smic (1 219 euros) se situe en dessous du seuil de pauvreté subjectif estimé [...] à 1 228 euros. [...] Cela veut dire qu’on n’a pas 9,3 millions de personnes concernées ; on dépasse les 12 millions ! On va aller jusqu’où comme ça ? » Tous les salaires sont trop bas en France, et le Smic devrait être haussé à 1 800 euros.
5,9 % des 30 millions de salariés sont pauvres. Ils ne peuvent se soigner et ne supportent pas le ou les jour(s) de carence retiré(s) de leur salaire quand ils attrapent le Covid. Beaucoup sont obligés de travailler et de masquer leur contagiosité. Et quand c’est le travail qui les contamine, le Covid n’est pas reconnu comme une « maladie professionnelle », ce qui diminue leur protection salariale et sanitaire. Il y a entre 15 et 20 % de précaires, d’abonnés aux CDD, d’intérimaires, de salariés à temps partiels, de saisonniers et de titulaires d’emplois atypiques.
Les « ordonnances de l’état d’urgence » de Macron ont élargi cette précarité et laissé aux patrons la liberté de l’exploiter au maximum, ce qui aboutit à ce que les heures supplémentaires ne soient plus décomptées ni majorées, à ce que les congés payés soient suspendus. Ainsi tous les salariés travaillent plus et gagnent moins. Ce qui évidemment freine l’emploi et fait augmenter le nombre de chômeurs.
« Autoriser les employeurs à augmenter fortement les horaires de travail des salariés en poste causera une nouvelle vague de chômage et le seul rattrapage qui aura lieu sera celui des profits et des dividendes, mais uniquement sur un horizon court », résume Guy Desmarets, auteur de La Déflation compétitive (Ed. Classiques Garnier) cité par Romaric Gaudin dans Médiapart.
Pour 88 % des actifs, non seulement le droit au travail et le droit du travail ont été dégradés, mais il en est allé de même pour le droit des contrats de travail. Macron s’attaque aux conventions collectives elles-mêmes. Quant aux 12 % d’indépendants, la misère les rattrape pour 16,6 % d’entre eux. L’aide forfaitaire de 1 500 euros du gouvernement n’est pas suffisante pour permettre à un chauffeur Uber d’assumer ses charges fixes (la location du véhicule, les 300 euros mensuels d’assurance, les frais d’entretien) et d’avoir un reste à vivre décent.
C’est le cas de tous ces faux-vrais artisans, sous-traitants, prétendus « auto-entrepreneurs ». Macron est l’ami n°1 d’Uber, son programme affiché est de « supprimer les cotisations sociales », de créer une « société post-salariale ». Le gouvernement refuse en conséquence bec et ongles la requalification de ces travailleurs en tant que salariés.
« L’annonce que la crise va faire entre 800 000 et 1 million de chômeurs de plus nous inquiète. Ceux-là, on va les voir arriver en janvier », explique-t-on au Secours populaire. « Nous n’avons aucune visibilité sur la croissance à venir parce qu’on ne voit pas encore arriver les salariés licenciés. Mais on sait qu’ils vont venir et qu’il y aura encore plus de demandes quand leurs allocations chômage prendront fin. »
C’est ainsi que le salariat est miné à la base, aussi bien dans ses salaires que dans ses droits. Les pauvres tirent vers le bas les bas salaires, les bas salaires tirent vers le bas les hauts salaires, les chômeurs servent à saper les défenses de ceux qui ont encore un travail, et Macron, lui, tire contre tous les salariés et les contient par la violence. Car pour casser ainsi de haut en bas toute un système de droits et de protection sociale, il faut cogner fort. Pour faire du Hayek, il faut faire du Pinochet. C’est à cela que sa police s’exerce et que ses lois liberticides tendent. C’est cela que ses discours séparatistes et discriminatoires visent.
100 milliards pour le CAC40 ou pour le travail ?
Pourquoi tous ces discours dominants dans tous les médias sur la religion, le séparatisme, la sécurité ? Pourquoi la violence de la police ? Pourquoi les discours creux ou pervers sur la République et l’ordre ? Pour ne pas parler de social, ne pas parler des pauvres, ne pas parler des salaires, ne pas parler du droit ni de la santé au travail !
C’est pour faire diversion. Pour masquer la guerre sociale, on digresse volontiers sur les religions, le communautarisme, la délinquance, le terrorisme et sur une république mythifiée qui n’a surtout rien de social. Pour faire voter un budget 2021 encore plus libéral, plus orienté vers les cadeaux à la finance parée de toutes les vertus rédemptrices.
Pendant ce temps, derrière la crise sanitaire, l’épargne profite aux riches : 20 % des ménages, les plus aisés, ont thésaurisé 70 % au-delà croissance du patrimoine financier. La baisse des APL, la désindexation de plusieurs prestations (allocations familiales, RSA, retraites) qui progressent moins vite que l’inflation, ainsi que le durcissement des conditions d’accès aux allocations chômage font diminuer en 2020 de 240 euros les ressources des 5 % les plus pauvres, quand les ressources des 5 % les plus riches augmentent de 2 905 euros sous le seul effet des baisses d’impôt. Cette injustice qui fait porter les politiques d’austérité sur les plus fragiles est chaque jour plus difficile à vivre pour les millions de précaires et de salariés qui n’accèdent plus aux biens essentiels comme le logement, l’alimentation, l’éducation ou les loisirs.
Deux problèmes massifs
Le problème majeur de notre société est que nous avions 6,6 millions de chômeurs, en catégories A, B, C, D et E. depuis plus de cinq ans. Sous Macron, les gouvernants ont réussi à manipuler les chiffres ; ils ont changé les critères et sont parvenus à faire croire aux observateurs non informés que le chômage avait baissé autour de 7 % (soit 3,4 millions de chômeurs). En fait, toutes catégories confondues, il est resté supérieur à 10 % et touche 6,5 millions de salariés. Avec ce mensonge, ils ont fait passer en septembre 2019 une casse de l’assurance chômage qui est une véritable « tuerie ». Elle va dominer drastiquement le nombre des chômeurs reconnus comme tels, leurs indemnités et leur durée d’indemnisation. Cela devait s’appliquer au 1er avril 2020. Ils n’ont pas osé le faire à cause de la misère ambiante et l’ont reporté en 2021, mais ils sont bien décidés à ne pas céder.
L’autre problème est que nous avons 14 millions de retraités dont la moitié touchent autour de 1000 euros et ne peuvent vivre décemment. Mais le pouvoir a fait voter en janvier 2020 une casse de ces retraites qui abaissera en moyenne ces dernières de 25 à 30 % et ils s’entêtent dans ce sens, annonçant le recul de l’âge de départ en retraite à 63 et 65 ans, ce qui aura pour effet d’aggraver le chômage des jeunes autant que des « seniors ». Ils masquent que la différence d’espérance de vie entre les 5 % d’hommes les plus pauvres et les 5 % les plus riches s’élève à 13 ans, et que leur « réforme » des retraites servira surtout les cadres supérieurs et les plus riches.
Tout confirme le cap fondamental de la politique macroniste : servir les riches, faire payer les pauvres et les salariés. Et le gouvernement profite de la pandémie pour durcir cette ligne.